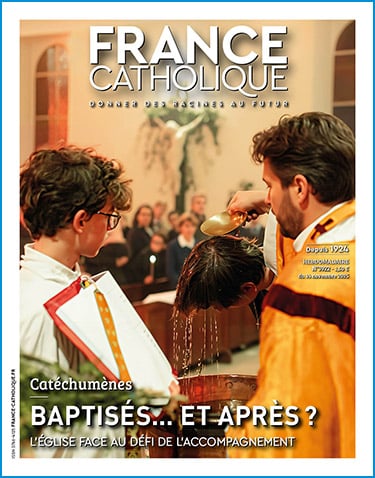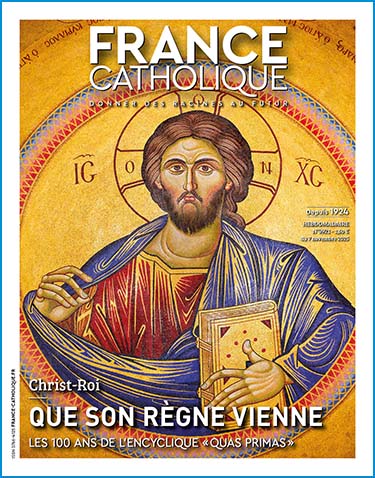19 JANVIER
Le Goff à nouveau… Faut-il souligner qu’il fait partie des sociologues selon mes affinités ? La qualité de l’observation chez lui est en rapport étroit avec des jugements de valeur sérieux qui changent heureusement de certains tropismes idéologiques, trop habituels chez beaucoup de ses collègues. Il a écrit un des meilleurs essais sur Mai 68, et toute étude sous sa signature constitue un éclairage intéressant sur les sujets les plus pointus. La France morcelée, qui regroupe plusieurs articles précédemment parus dans la revue Le Débat, permet de comprendre de quel monde nous sommes partie prenante à partir d’un examen acéré des nouvelles configurations sociales. À quarante ans de mai 68, comme nous sommes encore sous la dépendance de certains mythes de l’époque ! Mais en même temps combien éloignés de l’optimisme d’une génération qui profitait des avantages des Trente glorieuses…
La différence essentielle, montre Jean-Pierre Le Goff, est d’ordre culturel : « les soixante-huitards sont des héritiers rebelles. Ils vont se révolter contre la culture juive et chrétienne, humaniste et républicaine, mais ils ont été encore, qu’ils le veuillent ou non, éduqués dans son creuset. Il n’en est plus de même pour les générations suivantes : le fil a déjà été rompu. Elles arrivent dans ce qui ressemble à un champ de ruines produit par une critique qui ne s’est guère souciée ou s’est montrée incapable de reconstruire. »
La rupture depuis quarante ans s’est donc produite dans le domaine de la culture, et donc de l’école, avec le passage des disciplines autrefois formatrices (littérature, histoire et philosophie) aux sciences humaines réduites le plus souvent à la sociologie et à la psychologie « elles-mêmes instrumentalisées, mises au service d’une pratique qui verse vers l’audit et le management ».
Que ce soit un sociologue qui dénonce un tel basculement conduit à s’interroger sur les contradictions fondatrices de la sociologie. Car le système de questionnement social, en quoi consiste un tel savoir, se trouve radicalement transformé par ses propres paramètres et les valeurs qui les surplombent. Et ce système détermine aussi un type de société particulier associé à un mode particulier de politique : « la technocratie moderniste transforme ainsi la démocratie en un exercice de pédagogie visant à persuader le peuple de s’impliquer dans un processus et une machinerie dont il ignore les fins. »
Autre marqueur de l’évolution sociale : le brouillage des relations jeunes-adultes : « les enfants des baby-boomers ont été éduqués dans une situation paradoxale où les adultes et la société les ont valorisés à outrance en effaçant la différence entre les générations ». Difficile de s’identifier et de se révolter contre le père quand celui-ci prend les traits du copain ou du thérapeute, ou quand ceux qui sont censés faire figure d’autorité vous renvoient votre propre image de jeune révolté en vous incitant à les imiter. Interminables adolescences, explique depuis bien longtemps Tony Anatrella. Le sociologue rejoint ici l’expert en psychiatrie sociale. C’est un des points les plus sensible de toute analyse critique des phénomènes sociaux aujourd’hui. Et il faut la sagacité d’un Jean-Pierre Le Goff pour porter la charge au bon endroit. Je crains, en étant trop rapide, de gâcher un peu le travail. Mais, tout de même, avec son aide il doit être possible de tenter un discernement global.
Avec sa théorie de la génération lyrique pour les baby-boomers, le Québécois François Ricard avait déjà fourni une clé essentielle. Cette génération, nous prévenait-il, aura du mal à vieillir, car elle s’est, dès le départ, bloquée devant le miroir du jeunisme. Elle aurait pu reprendre à son compte cette formule citée par Le Goff : « nous forgerons notre futur quand nos rêves deviendront lois. » Qui s’obnubile d’une telle prétention est condamné à ne jamais sortir de la chrysalide. Pourtant, il faut faire face à un monde qui n’est pas facile, et qui l’est sans doute beaucoup moins que durant les Trente glorieuses, lorsque l’expansion était continue et le marché du travail de plus en plus ouvert.
Il y a ainsi un contraste étonnant entre le caractère impitoyable d’une économie que les politiques ont renoncé à organiser et une vie sociale largement abandonnée au narcissisme adolescentrique. Nous retrouvons là la thématique des livres de Christopher Lasch, avec qui notre sociologue est en total accord et dont il cite quelques propos décisifs. Pour Lasch, ce qui caractérise le narcissisme contemporain c’est trois choses essentielles : « la crainte d’engagements astreignants », le « désir de garder toutes les options ouvertes », « l’aversion au fait de dépendre de quelqu’un ». Le Goff commente : « cette difficulté d’être s’accompagne d’un rapport des plus ambivalents à l’État et aux institutions… Les individus ont tendance à soupçonner d’emblée ceux qui les dirigent d’une volonté de mainmise et de domination, tout en exigeant d’eux qu’ils répondent au plus vite à leurs besoins et les protègent. La difficulté à faire son deuil d’un passé mythifié, à accepter l’ambivalence et le tragique inhérent à l’histoire, la morale de la pureté et des bons sentiments, la posture de dénonciation victimaire sont également autant de traits qui ne sont pas sans rappeler les troubles et la révolte de la période de l’adolescence. »
Conséquence obligée de cette évolution, la psychologisation extrême des rapports sociaux. Les psy sont partout. Chaque épreuve, chaque choc émotionnel réclame leur secours urgent. La Providence universelle contemporaine a nom « aide psychologique ». Et cela pose des questions quasiment insolubles, car les psy non seulement ne sont pas tout puissants mais leur éventuel pouvoir thérapeutique se heurte à tous les syndromes d’une société éclatée où l’autorité est toujours moins visible, où les places et les statuts sont brouillés. Jean-Pierre Le Goff a longuement réfléchi à cette situation qui appelle la plainte continuelle d’hommes et de femmes qui s’estiment victimes de « harcèlement moral ».
On sait à ce propos le succès extraordinaire de l’ouvrage de Marie-France Hirigoyen publié en 1998, Le harcèlement moral (Syros). Cinq cent mille exemplaires furent vendus en France et le livre traduit dans 26 pays. Je l’avais lu à l’époque, à la fois intéressé et circonspect. La réalité des souffrances intimes qui étaient décrites me paraissait certaine, mais j’étais un peu déstabilisé face à ce que Jean-Pierre Le Goff appelle « un changement de paradigme ». Là où hier on parlait d’aliénation ou d’exploitation dans le travail, on s’interrogeait maintenant exclusivement sur les aspects psychologiques des rapports dans l’entreprise, toujours sous la menace de déviations perverses. Mais cette psychologisation ne s’inscrivait-elle pas dans le processus victimaire si habituel dans notre climat ? René Girard a bien montré que dans les réflexes archaïques on flétrissait la victime et que dans la mentalité moderne on cherche à être victime, car rien n’est plus valorisant.
Il y a donc quelque péril à s’engager dans la recherche systématique des pervers qui nous persécuteraient en prolongeant la description clinique par un appel à la judiciarisation du crime de harcèlement moral. Le succès de Marie-France Hirigoyen a amené le législateur à s’emparer du concept et à en faire un crime répréhensible. Mais l’auteur elle-même était consciente de l’ambiguïté possible et des risques d’extension à l’infini de pareils crimes. Elle a tenté de clarifier les choses sans vraiment y parvenir, selon Jean-Pierre Le Goff qui montre comment elle se trouve en porte à faux avec ce que la psychanalyse a révélé à propos des liens complexes qui s’instaurent entre le « persécuteur » et sa « victime ». Il n’est pas pertinent de ramener ces liens à une objectivité qui fait fi de leur intériorisation et des mécanismes inconscients que celle-ci met en jeu. De plus cette « victime » peut se complaire dans un sentiment de culpabilité inconscient. « Les hommes peuvent être les artisans de leur propre malheur et trouver paradoxalement de la satisfaction dans la souffrance, la force qui les pousse à agir ainsi ayant partie liée avec la pulsion de mort. » Impossible donc de délier le harcèlement moral du masochisme moral.
Ainsi la psychologisation extrême des phénomènes sociaux s’opère hors du contrôle de la psychologie clinique et elle s’emballe du fait qu’elle survient « dans un moment marqué par une temporalité désarticulée de l’histoire et une crise des pouvoirs et des institutions qui ont de plus en plus de mal à assumer leurs rôles de référence et de protection. La subjectivité et les rapports interindividuels sont autocentrés. Ils ne sont plus insérés et structurés dans une dimension tout à la fois collective, historique et institutionnelle, mais livrés en quelque sorte à eux-mêmes. Cette désymbolisation ouvre le champ à l’expression débridée des affects et des pulsions. »
J’en reviens donc à mes remarques sur les fondements de la discipline du sociologue. Ceux d’un Jean-Pierre Le Goff ou d’un Luc Boltanski ne sont pas ceux de Pierre Bourdieu et de ses disciples directs. Je ne sais pas si Bourdieu a exprimé un avis sur le harcèlement moral, mais j’aurais peur avec son système d’un souci exclusif du repérage des dominateurs et des dominés, pour soutenir la révolte des seconds contre les premiers, alors qu’il faudrait se soucier de la pluralité des paramètres et de tout ce qui contribue à l’équilibre des groupes humains et à la richesse de leurs échanges à travers le temps de l’histoire. Je ne dis rien du temps de la foi, mais je suis convaincu qu’il a sa place essentielle dans la respiration personnelle et collective. Mais cela nous mènerait trop loin avec des affinements pourtant nécessaires sur ce que la vie intérieure reçoit de la prière, du pardon sacramentel et de la liturgie… Bernanos avait tout prédit et prévu lorsqu’il avait désigné dans une certaine modernité une conspiration contre la vie intérieure.