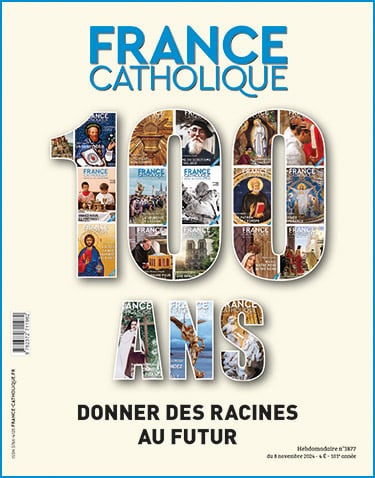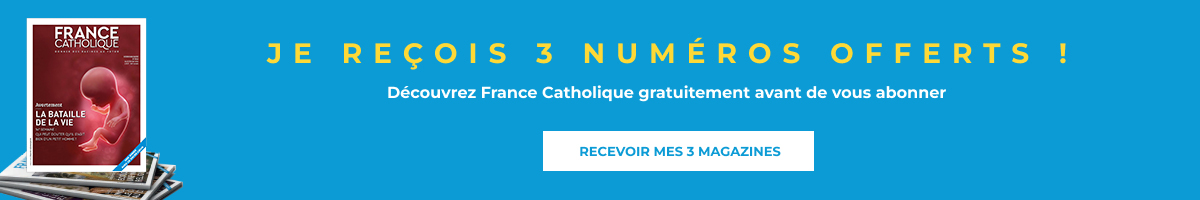23 janvier
Petite ouverture en littérature avec Balzac. Le récit biographique de François Taillandier (Folio biographies) m’a permis de ressaisir l’unité d’une vie et d’une œuvre. J’ai lu Balzac à certaines périodes, mais jamais de façon ordonnée ou systématique, comme peuvent le faire certains accros. Son génie m’a toujours paru indiscutable sans que je perçoive bien sa philosophie personnelle, déconcerté parfois par ses lubies. Sachant son admiration pour ses deux flambeaux, la monarchie capétienne et l’Église catholique, dont il dit qu’ils ont illuminé son œuvre, j’étais moralement assuré qu’il n’était pas du côté révolutionnaire-progressiste sans être tout à fait sûr de ce qu’il était profondément. Si, avec François Taillandier, on se reporte aux convictions et aux idées qu’il a manifestées au cours de sa propre vie, la perplexité se renforce. Et j’en viens à me demander si ce n’est pas à un Honoré de Balzac qu’il faudrait imputer la cause de « l’Église de l’ordre » dans l’acception où on l’impute, à contre sens, à Charles Maurras. Comme l’avait prophétiquement saisi l’abbé Huvelin, il y avait chez le jeune martégual un christianisme d’enfance susceptible de résister aux plus terribles crises intérieures. Balzac c’est autre chose. On cherche vainement cette formation in hymnis et canticis qui aurait inoculé dans les veines les plus secrètes cette sensibilité chrétienne qu’on n’oublie jamais et qui renaît toujours d’une façon ou d’une autre.
Je me souviens d’en avoir parlé avec Pierre Boutang, tandis que je découvrais avec ravissement le grand livre de Philipe Muray, Le dix-neuvième siècle à travers les âges (Denoël 1984). – Il y a des pages étonnantes de Muray, lui disais-je, sur la pensée profonde de Balzac. – Ah, j’aimerais bien les lire, car, en ce qui me concerne, je ne suis jamais parvenu à comprendre le fond du bonhomme… Je ne sais si finalement Boutang a lu ces pages que j’ai sous les yeux et qui m’avaient littéralement subjugué à la première lecture. Boutang n’aurait pu qu’y mordre à pleines dents, lui qui ne cessait de citer le mot de Proudhon : « Nul n’est homme, s’il n’est père. » Et qui y ajoutait une magnifique citation de Kafka propre à désarmer la morgue de tous les contempteurs du paternalisme.
A priori, ce balzacisme de Muray devrait nous stupéfier, car le bâtisseur de la Comédie humaine n’a pas échappé à ce qu’il dénonce lui-même comme la perversion caractéristique du dix-neuvième siècle : le goût pour la magie, les tables tournantes et les fantômes. Mais il prévient l’objection pour l’anéantir : « Ce n’est pas qu’il ne soit pas tenté, comme les autres, et qu’il ne succombe pas. Mais enfin il se livre, lui, à un exorcisme quotidien qui s’appelle sa Comédie. La Comédie humaine, comme il dit. Son problème principal, ce ne sont pas les morts, ni les fantômes, ni les fiancées, ni les enfants. À l’inverse de presque tous ses contemporains qui se rêvent grands-pères ou mères, lui, c’est le père qui l’intéresse comme je vais essayer de le démontrer. » Suivent une vingtaine de pages, serrées, inspirées, que je ne veux pas résumer ici.
Mais je ne puis esquiver le plus important. Si la tentation occultiste est plus que dépassée, déniée, c’est parce qu’en dépit de tout Balzac conclura que « l’unique religion possible est le christianisme » et que, ce faisant, le formidable romancier s’oppose de sa force herculéenne à la syncrétisation du siècle, qui a resurgi si bien ces dernières saisons. Et j’en conclurai qu’il faut beaucoup se méfier des dénonciations de l’Église de l’ordre, car ses défenseurs honnis pourraient être infiniment plus pertinents qu’on ne le dit, et jusque dans leurs insuffisances et leur défaut de foi. Ils ont peut-être repéré dans leur observation clinique du monde quelques vérités essentielles, qui, par-delà leur positivisme superficiel, pourraient concerner le secret même de la création.