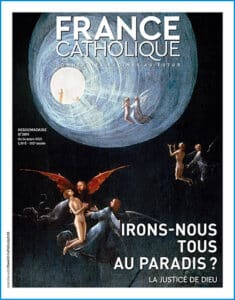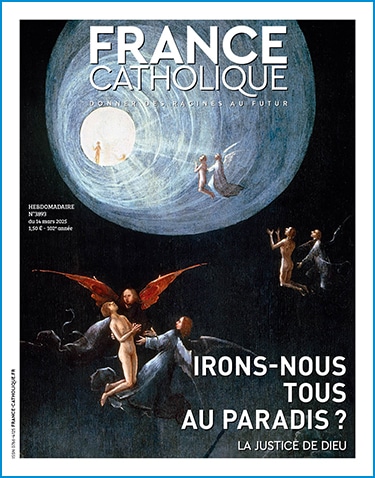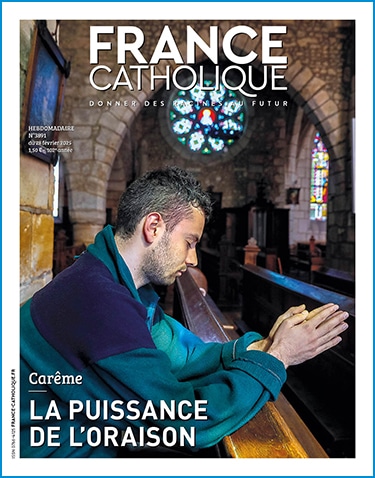26 DÉCEMBRE
Ai-je été trop loin avec mon histoire de cadeaux ? Bien possible. Mais peut-être faudrait-il revenir à une notion du don plus exacte, plus significative. Les dons sont présents à la crèche avec les Mages. Edith Stein, évoquant la gaieté de Noël dans un texte magnifique n’élude pas le sujet : « Lors de la veillée, quand scintille l’arbre de lumière et que s’échangent les cadeaux, le désir inassouvi d’une autre lumière monte en nous, jusqu’à ce que sonnent les cloches de la messe de minuit et que se renouvelle, sur des autels parés de cierges et de fleurs, le miracle de Noël. Et le Verbe s’est fait chair. Nous voilà parvenus à l’instant bienheureux où notre attente est comblée. »
Combien Edith Stein est sensible à la liturgie ! Ces pures merveilles de l’Avent que sont le Rorate caeli de super (que l’Abbé Pierre aimait tant et dont la mélodie, sur Radio Notre-Dame, me bouleverse, et les grandes O, ces antiennes chantées (jadis ?) la semaine précédant le 25 décembre : O Sagesse, O Adonaï, O Fis de la race de Jessé, O clef de la cité de David, O Orient, O Roi des nations. Où les avait-elle entendues pour la première fois ? À Maria Laarch ? Plus tard au Carmel ? où elle a dû les chanter avec ses sœurs. J’adhère à son évocation qui rejoint les sentiments que j’évoquais plus haut. Elle n’a pas peur de parler des « vieilles mélodies, toutes pleines de la magie de l’enfance » Et on devine la plénitude de sa prière dans le chant grégorien : « Dans le cœur de celui qui vit avec l’Église, les cloches du Rorate et les chants de l’Avent réveillent une sainte nostalgie ; et celui à qui s’est ouverte l’inépuisable source de la liturgie entend, jour après jour, le grand précepte de l’incarnation martelé de ses exhortations et ses promesses : Cieux répandez votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le Juste. » (Edith Stein, La crèche et la Croix, Ad Solem).
28 DÉCEMBRE
En cette période, un livre s’impose, celui de l’ami Damien Le Guay. Son sujet ? Saint Joseph ! Les textes évangéliques qui le concernent, d’une étonnante concision, ne s’en imposent pas moins à travers le temps. Il est vrai que le climat actuel n’est guère propice à une réception des textes dans leur sens pourtant le plus éclairé. La mode est au « décodage » de cette Révélation insupportable, et le fameux Da Vinci Code n’est jamais que le type le plus sauvage de ces entreprises de prétendue démystification. Damien Le Guay a choisi le point de vue le plus opposé. Le plus évangélique, le plus orthodoxe, et donc le plus apte à encourir les grincements des habiles. Il ne fait que prendre au sérieux le seul témoignage que nous ayons de l’origine du christianisme, sans jamais vouloir contredire la trame du récit et l’intelligibilité du dessein divin qui s’y affirme. Comme il le dit d’emblée : son code à lui, c’est le code Joseph, parce qu’entrer dans l’intériorité de ce juste essentiel, c’est pénétrer, avec les moyens que les auteurs inspirés nous fournissent, dans l’inépuisable mystère de la venue du Christ parmi nous.
Cela ne veut pas dire que l’écrivain – j’emploie ce terme pour sa justesse – se prive des prestiges de l’imagination. Il est même poète, mais dans l’acception vraie du terme, c’est-à-dire la lecture de la Création et de ses plus subtils langages, sourcier qu’il est de ses secrets. L’inévitable part d’arbitraire que recèle pareille entreprise n’est que projection libre des ressources du réel. Poésie est ontologie. Ici, elle s’exprime en prose, très ciselée, mais sans artifice. Le défunt Julien Gracq était peut-être un des meilleurs artisans modernes de cet usage de la langue, avec une beauté formelle qui sonne juste, retentit avec un accent de vérité jusque dans ses pures inventions. Mais lui ne se risquait pas sur le terrain où Damien Le Guay s’engage résolument. Les écrivains signalés sur la quatrième de couverture (Jean Giono, Jules Supervielle, Jean Grosjean) sont encore plus adéquats pour déterminer sa manière et son objet. C’est dire que ce livre ne se lit pas comme la plupart des essais qui, à cause de mon métier, sont mon pain quotidien. Le contact n’est pas d’abord cérébral, il est retenu, entretenu, soutenu par le grain des mots, dont aucun n’échappe à la perception parce qu’il doit être prononcé, goûté. Quant à la phrase elle-même, impossible de ne pas être pris par son rythme. Voilà de l’écriture, et les noms de Péguy et de Claudel ne sont pas excessifs pour rendre compte de ce bel essai.
Je n’ai rien dit, ou presque, du fond, mais il me faudrait faire de la paraphrase ou me risquer à un condensé qui perdrait le parfum du livre. On ne résume pas une contemplation ou un poème. (D. Le Guay, Le couvre-tête de Dieu, Cerf. Ndlr : cf l’article du P. Francis Volle, dans FC n°3106 du 15 février 2008).
30 DÉCEMBRE
Comme à chaque fin d’année, destination familiale au pied du Vercors dont la masse imposante me fait rêver. Souvenir de Jean-Marie Domenach et du maquis, souvenir du Père de Montcheuil qui y fut arrêté, soignant les blessés, puis fut conduit à Grenoble pour être fusillé… Mais il y a aussi tout un passé préalable de ce massif que mon beau-frère, Patrick Marçais, a exploré pour rédiger un album illustré par les sublimes photos de Fabian da Costa (éd. Curendera). La présence monastique reste attestée par la belle abbatiale de Léoncel, construite par les cisterciens et toujours vénérée par les chrétiens de la région. Dans le TGV qui nous amène à Valence, j’ouvre le dernier lot des livres de fin d’année. Deux auteurs de choix sont au rendez-vous : Marcel Gauchet et Pierre Manent, champions incomparables de la pensée politique contemporaine. Je déchiffre la préface d’un recueil de textes de Manent (Enquête sur la démocratie, collection Tel/Gallimard). Elle est d’une redoutable densité intellectuelle et me pose des questions difficiles qu’il faudra du temps pour démêler. Le chrétien, et qui plus est le catholique – Manent y met, par exemple, en cause le rôle politique de l’Église. « Elle qui entendait gouverner les hommes, et les gouvernait mal » : « il s’agissait assurément d’un gouvernement singulier, gouvernement visible et tangible au nom d’un roi invisible dont le royaume n’est pas de ce monde. Le résultat visible, c’est que l’Église gouverne mal. Plus précisément, elle empêche de bien gouverner, ou, comme Rousseau le dira alors que l’Europe est sur le point d’exploser, elle rend toute bonne politie impossible dans les États chrétiens. »
Pierre Manent distingue entre la colère anti-théologique des philosophes, qu’il ne saurait approuver, et leur jugement proprement politique qu’il reconnaît. L’affaire est trop impressionnante pour qu’on l’élucide trop rapidement. Est-il vrai qu’un pouvoir spirituel s’appliquant au politique a quelque chose de monstrueux ? Oui, peut-être et sans doute. L’Évangile nous met sur la voie en érigeant un principe radical de séparation des domaines. Mais, attention, séparation ne signifie pas, comme on semble le présupposer trop souvent, élision du spirituel. Là-dessus, Manent résume tout d’une formule qui mériterait de rester sous forme d’axiome : « Pour parvenir à une bonne politie, il faut interdire à l’Église de commander, en la laissant libre d’enseigner ». Je m’y rallie de toute ma conviction, tout en me reconnaissant également dans les phrases qui suivent, énigmatiques mais inévitables dans une perspective chrétienne, et notamment augustinienne : « Mais la question de la cité juste, ou de la communion véritable, voire de la nation sainte, reste entière. »
Une petite remarque en passant, à propos de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau est irritant, parfois complètement faux, parfois surprenant de justesse, mais au total incontournable. Beaucoup plus pertinent et intéressant que Voltaire, qui n’atteint jamais sa puissance de problématisation. Dans l’espace linguistique français, ce Genevois est singulier, parce qu’il atteint la profondeur et l’agilité conceptuelle des principaux penseurs politiques. J’ai eu l’occasion de m’affronter à des œuvres aussi diverses que le Contrat social, Émile, et la Nouvelle Héloïse, et je n’en suis pas sorti intact. On pense contre Rousseau, mais jamais sans lui.
Mais pour terminer sur Pierre Manent, du moins très provisoirement, il y a infiniment à retenir de sa provocation sur l’infirmité politique de l’Église et la pertinence infinie de son enseignement. Cela rejoint les réflexions que j’ai consignées ici-même à propos de la confrontation Carl Schmitt-Erik Peterson. La notion de théologie politique est dangereuse et il faut néanmoins garder l’idée d’une indispensable permanence d’une instance spirituelle avec sa puissance de décision dans son ordre à elle.
En ces dernières heures de l’année 2007, il est bon aussi que la prière prenne le pas sur la réflexion. J’y suis conduit, en accompagnant ma famille dans un petit monastère orthodoxe, installé dans une combe du Vercors. J’admire et affectionne la liturgie orthodoxe dans ce qu’elle a en même temps de supérieurement mystique et de familier. Supérieurement mystique dans ses chants, ses répons, ses lectures. Familier dans la participation des familles et des personnes. J’aime voir jusqu’aux plus petits enfants vénérer les icônes, se signer, entrer paisiblement dans ce climat de beauté, de sonorité, de couleurs et d’encens. Dans l’ombre de ma stalle, en toute intimité et discrétion, je m’associe à cette divine liturgie qui me tire de la prose du monde pour me faire entrer dans la proximité des mystères ineffables.
3 JANVIER
Passage du Nouvel An. Pas de temps pour les rétrospectives. Dieu sait pourtant que l’année 2007 a été riche d’événements. Mais ceux que je garde dans mon cœur inspireront, du moins je l’espère – quelques travaux d’avenir et non le regret. Je n’ai pas encore confié à ces pages, les sentiments qu’ont provoqués en moi les propos de Nicolas Sarkozy lors de sa visite à Rome. Elles ont pourtant produit un émoi profond… Mais, depuis, les vœux du Président ont ajouté à sa palette intellectuelle un thème inattendu. Une « politique de civilisation ». Tout le monde désigne le coupable, en la personne d’Henri Guaino, qui rédige la plupart des grandes interventions présidentielles. Il y a un problème Henri Guaino aujourd’hui. Il en irrite plus d’un et son omniprésence dans les médias constitue un motif d’animation des dîners en ville. L’homme m’intéresse à divers égards. Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois. C’était dans un studio de radio, alors que je présentais mon essai biographique sur Jean Guitton. Il connaissait Guitton. Mieux que cela, il l’avait lu avec attention. La culture religieuse était donc partie intégrante de son univers personnel. Voilà une chose que je ne saurais dédaigner.
Que Sarkozy ait fait appel à ce personnage atypique donne à penser. Rencontre improbable ? Ou dictée par la nécessité ? Celle d’avoir avec soi le meilleur « parolier » du moment. Seulement voilà, a priori, Guaino, qui a fait ses premières armes au côté de Chirac (la fracture sociale) et de Séguin, n’est pas du tout libéral au sens où Sarkozy était censé l’être – avec une bonne portion de son entourage. Il croit à la nécessité de l’intervention de l’État en économie. Et il veut maintenir le système de protection sociale que nous avons hérité notamment de la Libération. Il ne conçoit pas une Europe qui démantèlerait l’autorité et la spécificité des nations qui la composent… La campagne présidentielle s’est faite à partir des grandes allocutions préparées par Guaino et admirablement interprétées par le candidat.
Y avait-il pleine connivence intellectuelle entre les deux hommes ou bien demi-entente, compromis provisoire ? Le temps passe, la question n’a pas été dénouée. Il n’est pas sûr qu’elle le sera avant longtemps. La situation politique, les difficultés économiques, les flux de l’opinion, beaucoup de facteurs se conjuguent pour empêcher le Président de sortir de cette configuration qui impatiente les plus libéraux. Je laisserai cet aspect important pour me concentrer sur l’inspiration de fond du discours préparé par Henri Guaino car, tout de même, qu’il y ait un contenu qui fasse réfléchir, ce n’est pas rien ! C’est bien autre chose que la langue de bois chiraquienne ou la dialectique liftée giscardienne. On aura beau me dire qu’il y a un abîme entre le discours et la réalité, les belles idées et la vraie conduite d’un homme dont l’opinion commence à se déprendre pour ses frasques (le président bling-bling cher à Nicolas Domenach) quelque chose en moi résiste. Je ne suis pas fâché d’entendre dire, au sommet de l’État, des choses qui résonnent en moi avec une puissance singulière.