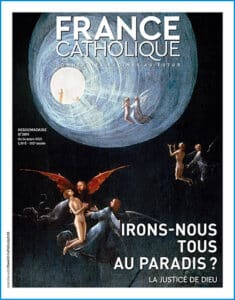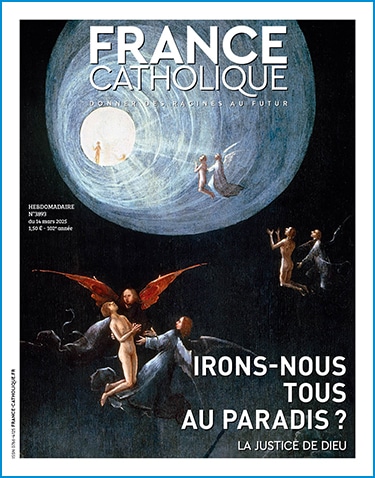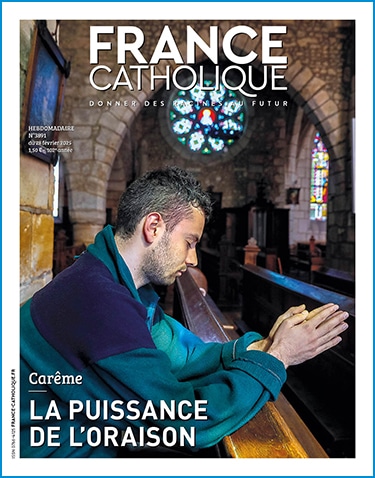31 OCTOBRE
J’ai fait connaissance avec BHL, il y a plus de trente ans. C’était avant la publication de La Barbarie à visage humain, dans les couloirs du premier Quotidien de Paris. Il était surpris qu’un type de mon genre puisse s’intéresser à un ex-maoïste comme Guy Lardreau, alors en pleine recherche post-révolutionnaire, jusque chez les Pères de l’Église. Ce fut le début de rencontres assez régulières, surtout dans son bureau des éditions Grasset. Je pourrais dire que nous étions amis, complices dans son aventure des « nouveaux philosophes » et dans le sillage de Soljenitsyne. L’atteste sa dédicace à mon exemplaire de La Barbarie que je viens de retrouver.
Des souvenirs me reviennent en tête, comme certaines soirées mémorables à Beaubourg où il officiait avec Jean-Marie Benoist, philosophe trop tôt disparu, que j’aimais bien. Je pense aussi à une descente que nous fîmes ensemble sur Aix-en-Provence et qui nous amena jusqu’à Aspremont sur les hauteurs de Nice. Mais avec mon entrée au Quotidien de Paris, en 1980, nos rencontres s’espacèrent. Je n’avais plus le temps de me promener au Quartier Latin. Nous n’étions pas pour autant si éloignés. Il suivait ce que j’écrivais au Quotidien et ailleurs, et je ne manquais aucune de ses publications.
C’est lui qui tint, et je lui en reste reconnaissant, à ce que j’interroge Elie Wiezel à l’occasion de la publication d’un des livres du prix Nobel. Wiesel me toucha en effet par sa cordialité, son désir non affecté de connaître son interlocuteur, mais aussi ses confidences sur sa fidélité juive, l’angoisse de maintenir l’héritage qui l’avait amené à rencontrer le cardinal Lustiger dont la conversion au christianisme le troublait.
Il y eut le tournant de L’idéologie française, qui aurait pu nous séparer. Ce ne fut pas le cas. Pourtant, la querelle était vive. Elle blessa les héritiers d’Emmanuel Mounier, tel Jean-Marie Domenach, un Pierre Vidal-Naquet, furieux, et tant d’autres. Pour ma part, j’étais partagé entre la nécessité d’un travail de discernement indispensable pour rejeter la part maudite dénoncée à juste titre par BHL et le danger de se laisser aller à un manichéisme purificateur et par principe dangereusement simplificateur. Je décelais l’influence de Sternhell et j’en discutais les thèses. Pourtant, certains me reprochaient assez vivement mon indulgence, coupable à leurs yeux. Sur le moment, n’est-ce pas à moi-même encore, que BHL s’adressa pour répondre dans un long entretien au Quotidien, à quelques-unes des critiques qui lui étaient faites ? Ce fut notre dernière longue conversation. Nous ne nous vîmes quasiment plus, nos occupations étant sans doute assez éloignées, bien que je continue à suivre attentivement ses positions, par exemple dans les drames de l’ex-Yougoslavie, et lise tous ses livres, sans toujours en rendre compte, à l’exception de son Sartre, que je persiste à saluer comme un de ses meilleurs essais.
Dieu sait que BHL est un personnage controversé. L’attestent les copieuses biographies non autorisées dont il a fait l’objet. Pourtant, j’ai toujours tenu à rester en dehors des polémiques à son sujet. Sans doute dans le souvenir de notre complicité passée, mais aussi parce que je ne veux pas être manichéen moi-même. Il y a des points où je ne suis pas d’accord avec lui, des choses qui me heurtent, mais je reste sensible à sa générosité, à cette fougue qui l’entraîne, lui, le fortuné de la vie, à prendre la défense des malheureux et des victimes jusque sur les territoires les plus oubliés du monde.
Je conçois qu’il exaspère. Mon « indulgence » tient en particulier à ce fait qu’il demeure pour moi un personnage stendhalien, poursuivant une aventure aux confins de la littérature et de l’histoire, à l’instar d’un Malraux qui a toujours été son modèle.
J’aurais tant à dire sur son dernier essai que j’ai lu, évidemment, comme les précédents. Il m’a plus intéressé qu’American vertigo qui ne m’avait guère convaincu. Justement, à propos des États-Unis, BHL persiste dans d’étranges abstractions dont il fait gloire à la grande nation mais dont je doute qu’elles soient adéquates à son histoire contrastée. Qu’est-ce que cette Amérique sans ses premiers habitants et le sort qu’ils subirent – l’intransigeance anticolonialiste semble amnésique là-dessus – sans la traite et la case de l’oncle Tom, sans même l’épopée du Mayflower, le Sud profond de Faulkner, l’étrange mixte d’idéalisme et de cynisme de ses politiques, toutes les contradictions déjà relevées par Toqueville ?
Qu’est-ce que c’est que cette histoire d’un peuple sans histoire qui aurait défié les pesanteurs en se ralliant au pur artificialisme de la volonté générale de Rousseau ? Je ne reconnais qu’un élément de vérité dans cette théorie. Il est vrai que la naissance des États-Unis d’Amérique correspond à une sorte de commencement absolu de nature contractuelle. Ceci accordé, qui n’est pas mince, je pense plutôt périlleuse, arbitraire et fallacieuse l’idée de construire à partir de là un modèle idéaliste, vertuiste, où seraient promus rousseauisme, kantisme et où la figure du président Wilson viendrait prophétiquement accomplir le rêve américain à l’encontre des résistances de la vieille Europe. Les choses sont infiniment plus compliquées. Rousseau a autant servi la démocratie que le totalitarisme. Kant, malgré son universalisme, n’a pas toujours échappé au racisme, et le président Wilson a précipité le monde dans le cataclysme dont il prétendait le protéger.
Cela dit, la discussion demeure ouverte sur tous les sujets évoqués, notamment sur le face à face Europe/États-Unis qui est une affaire passionnante que je renonce provisoirement à réexaminer car il y aurait trop à dire, même à partir des propositions péremptoires de Bernard-Henri Lévy.
3 NOVEMBRE
Suis-je vraiment cohérent avec moi-même ? D’un côté, je serais assez enclin à reprocher à certains leur dureté intellectuelle, leur façon de casser le monde en deux, de s’en prendre sans cesse, et comme à perpétuité, à un adversaire obsessionnel. D’un autre côté, je suis tout prêt à dresser une oreille attentive au message d’un Michéa et d’un Ziezek, pourfendant une trompeuse neutralité libérale, et réhabilitant même une certaine intolérance. Mais cette dualité est trompeuse, et la duplicité qu’elle pourrait révéler ne tient pas devant la question de fond qui est posée et renvoie à une justesse du regard, une éthique intellectuelle, une rectitude du jugement. Il ne faut pas confondre ce qui relève de l’arbitraire et de l’idéologique avec la nécessité de ne pas s’y perdre dans ses repères pour une appréciation des phénomènes et des valeurs. La difficulté, c’est de ne pas se laisser tromper par ses sentiments, ses phobies, ses tropismes, sur le vrai et le faux, le bien et le mal. Mais surtout ne pas confondre un regard juste et un regard neutre. Ne jamais renoncer à l’aventure humaine, à l’odyssée de la conscience et donc aux grandes querelles. George Steiner (cité par Jean-François Mattéi) : « N’avoir ni paradis, ni enfer, c’est se trouver intolérablement privé de tout dans un monde absolument plat ».
Objection : c’est très beau, ces grandes querelles, mais elles peuvent être aussi à l’origine guerres irrémissibles. Ne convient-il pas de faire confiance aux médiations qui permettent d’échapper à la montée aux extrêmes ? Et n’est-ce pas l’avantage de la démocratie parlementaire – figure essentielle du libéralisme politique – d’intervenir comme espace de discussion, de négociation et donc de possible pacification ? Sans nul doute. Mais n’y a-t-il pas en ce cas, glissement permanent vers la neutralisation des querelles auxquelles on retire leur charge métaphysique ou morale ? C’est pourquoi j’ai été si attentif à un certain nombre d’essais politiques ces derniers mois qui mettaient en évidence ce risque de neutralisation qui fait la fortune des positivistes et des « experts », ces derniers ayant pour compétence de trancher dans l’incertitude des opinions et l’impossibilité de concilier les convictions. Or, il n’y a pas de lien social ou de cohabitation dans une cité sans un minimum d’adhésion à des valeurs communes, sans ce que George Orwell appelait une « commune décence ». C’est à dire « ce jeu d’échanges subtils qui fondent nos relations bienveillantes à autrui, notre respect de la nature et, d’une manière générale, notre sens intuitif de ce qui est dû à chacun » (Jean-Claude Michéa, Orwell anarchiste-tory). Cela va bien plus loin que les prescriptions formelles d’un droit purement procédural. Car la formule d’Orwell concerne en même temps le bon sens des pratiques populaires et aussi la dimension anthropologique et morale qui oblige à mettre le sens de l’autre (Lévinas) au-dessus d’un respect formel de la loi. Autre définition de la décence : « Cette pratique quotidienne de la civilité, de l’entraide et de la réciprocité bienveillante peut-être innée et qui est, en tout cas, le socle nécessaire de toute vie bonne, et la condition indispensable de toute révolte qui voudrait se présenter comme juste. » Et encore : « Un ensemble avéré de manières de donner, recevoir et rendre » où Orwell voyait le seul socialisme concevable. J’avoue que j’échangerais beaucoup de systèmes philosophico-politiques pour cette seule « décence ».
8 NOVEMBRE
Depuis dimanche, je suis revenu à Lourdes pour l’assemblée des évêques de France. Je ne ferai pas, comme l’an passé, un compte-rendu assez précis de mes contacts avec les évêques et des conclusions que je tire des réflexions de l’Assemblée. Pourtant il s’est passé quelques événements notables, dont l’élection à la présidence de l’archevêque de Paris, Mgr Vingt-Trois, bientôt cardinal. Son prédécesseur, Jean-Marie Lustiger, aurait pu prétendre à cette fonction. Qu’il ne l’ait jamais obtenue, doit être considéré comme une énigme fort significative de l’histoire récente de l’Église de France. Faut-il interpréter l’élection de son successeur comme un tournant ? Un de mes amis me rappelait qu’il y a vingt ans, seul un tiers des voix s’était reporté sur Lustiger. Depuis lors, l’épiscopat a changé, comme l’Église en France. Mais il faudrait apporter quelques correctifs à cette idée de changement en rappelant que les cardinaux Decourtray et Billé – pour ne s’en tenir qu’à eux – étaient proches de l’archevêque de Paris, quand ils présidaient l’assemblée. Il n’en reste pas moins que Lustiger-président relevait de l’impensable. Mgr Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes a osé dire qu’en soi cela relevait du scandale…
J’émettrais l’idée qu’entre Jean-Marie Lustiger et l’institution de la Conférence, il y avait dès le départ quelque incompatibilité. Car il s’agissait d’une réalité singulière, générant ses secrétariats, ses modes de fonctionnements, habitudes, non-dits, et jusqu’à son langage. Je me souviens de mon désappointement la première fois où j’ai assisté, comme journaliste, à l’assemblée de Lourdes. J’étais déconcerté par le style des documents de travail dont nous pouvions nous-mêmes bénéficier. Un peu plus tard, le Cardinal me parlerait de « patois » de Chanaan, alors même que nous évoquions des textes qui avaient un intérêt certain. J’ai le sentiment que ça a plutôt bien évolué de ce point de vue.
Autre remarque, à propos de l’accès des journalistes aux travaux de l’assemblée. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent que nous ayions été évincés des séances, car je souhaite la pleine liberté de discussion des évêques, qui me paraissait gênée par la présence d’observateurs censés être plus ou moins les médiateurs de l’opinion publique. On m’a raconté des histoires étonnantes à ce propos… Tel confrère investi de l’aura de son journal et de sa réputation, pouvait parfois jouer un rôle de surveillant, et les regards qui s’assuraient préalablement de sa présence avant une intervention signifiaient qu’on s’adressait autant à lui qu’aux autres évêques. Les mœurs ont changé depuis lors, mais il me semble qu’il ne faut pas se tromper de genre. Nous ne sommes pas à l’Assemblée nationale. Quant à notre mission d’informateurs, elle ne me semble guère être obérée par les dispositions rigoureuses qui ont été prises. Nos contacts personnels nous permettent de savoir ce qu’il en est et les discussions franches que nous avons avec les uns et les autres nous permettent de poser toutes les questions utiles.
Justement, au fil des confidences et même des propos les plus officiels, notre Église de France nous donne les plus vifs sujets d’inquiétude. Que seront nos diocèses dans dix ans avec un clergé réduit à quelques dizaines ou à quelques unités ? Après telle conférence de presse sur le rôle des prêtres et leur insertion actuelle sur le territoire, l’interrogation était portée par tous les journalistes, quelles que soient les sensibilités.
Au sein de ma propre perplexité, j’entrevois quelques ouvertures sur un fond de pénible énigme. Là où se manifeste une vitalité, paroissiale ou autre, l’attrait est certain, avec la fécondité qui s’ensuit. Mais je suis surpris qu’on ne s’interroge pas plus sur le manque de fécondité de tout un réseau pastoral qui subsiste. Ce n’est pas que je veuille engager des procès. J’ai trop connu de ces réquisitoires contre l’institution qui n’ont débouché que sur le néant. Mais c’est tout de même ce qui devrait nous remettre en cause.
Et ne parlons pas des prétendus remèdes ressassés depuis des lustres. L’ordination d’hommes mariés pourrait donner quelque temps l’illusion d’un colmatage des brèches, avec quelques centaines de diacres permanents devenant prêtres. Mais on s’apercevrait vite que ce serait au détriment de la dynamique propre au clergé catholique : avec des hommes jeunes, formés au noviciat et aux longues études du séminaire, c’est la grâce d’une revivification permanente du tissu ecclésial et qui se perpétue à chaque génération. Et c’est elle qui serait sacrifiée dans cette modification qu’on prétend de pure discipline et que je crois, au contraire, consubstantielle à l’Église d’Occident ! Ce serait accélérer par dix la logique du déclin, et ce qu’on nous décrit comme avant-gardiste se révélerait au contraire comme une cruelle déception, à rebours de toute attente prophétique. Cela dit, la situation présente n’est pas facile à vivre et l’on n’ose pas dire que nous sommes de plus en plus dépendants des jeunes Églises ou de la Pologne pour remplacer les prêtres et les religieux qui nous manquent. Certains évêques dynamiques ont déjà fait appel à des communautés nouvelles venues parfois de très loin et leur place n’est pas toujours facile à trouver, avec un clergé diocésain qui a l’impression d’être marginalisé. Je ne veux pas me montrer exagérément pessimiste. Je ne le suis d’ailleurs pas, averti des voies imprévisibles que choisit souvent l’Esprit pour nous prévenir des nouveaux cours de notre histoire spirituelle.
Encore un mot à propos de Lourdes. Avec son courageux évêque, Mgr Jacques Perrier, ses collaborateurs, la ville mariale n’est pas près de s’assoupir. L’ouverture des cérémonies du cent-cinquantenaire des apparitions annonce une année forte pour le sanctuaire qui, à travers les âges, ne perd rien, au contraire, de sa mystérieuse attirance. À chaque fois que j’y reviens, notamment à l’automne, je trouve le site toujours plus lumineux et je suis toujours touché par cette religion populaire qui est bien autre chose qu’un ensemble de pratiques réputées païennes. A Lourdes, les bonnes gens, quel qu’ils soient, riches ou pauvres, apportent toute leur vie, interpelle le ciel, se mettent sous la protection de Marie. C’est cela le miracle permanent.
Justement, j’ai trouvé dans une librairie de la ville un ouvrage de mon collègue Dominique Chivot qui a interrogé une quantité de personnalités sur leur relation avec Lourdes. C’est vraiment très réussi. Tous, si différents soient-ils, ont perçu ce que qui fait l’originalité irremplaçable de ce lieu privilégié. Jean-François Colosimo, théologien orthodoxe, est particulièrement inspiré. Il fait une analyse très fine du « génie » du catholicisme, avec la réponse qu’il donne, au XIXe siècle, à un peuple en attente, et qui ne se retrouvent pas dans les promesses fallacieuses ou démesurées de la science ou du progrès.
(à suivre)