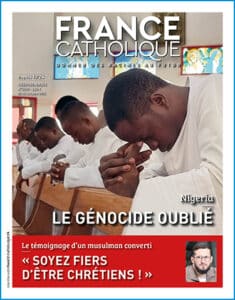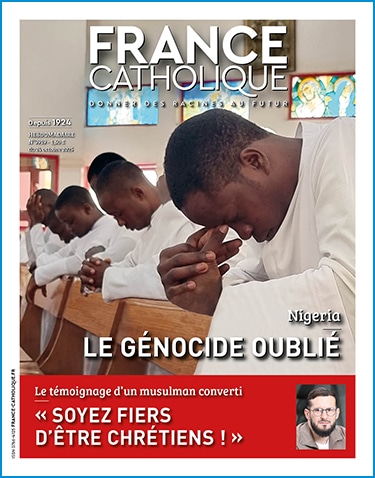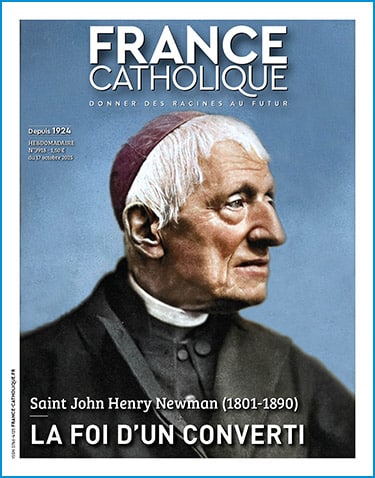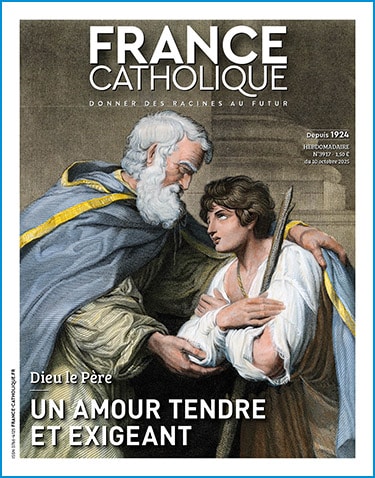20 AOÛT
La lecture de la Trahison achevée, je ne puis que confirmer mes premières impressions. L’ouvrage souffre terriblement d’être à thèse, une thèse passionnément défendue bien que l’auteur se défende de toute passion, et qui veut faire rentrer de force dans sa démonstration les pensées des écrivains auxquels Benda en veut manifestement. Non que tout soit faux. Ce qui vise Nietzsche et Georges Sorel est plutôt bien ajusté. Barrès ? Je n’en suis pas tout à fait sûr, même s’il y a des pentes dangereuses chez lui. Le problème avec l’auteur du Culte du moi, c’est que l’on a affaire à un non philosophe, à un artiste qui se sert des idées plus qu’il ne les sert et dont on serait bien en peine d’établir l’équivalent d’une doctrine. Bien sûr, la polémique anti-kantienne qui fait le fond des Déracinés pourrait donner prise à une critique, mais chez Barrès tout est toujours flottant, y compris et à commencer par son sentiment religieux. Sur Maurras, Benda a à peu près tout faux, les textes allégués sont tronqués, son incompréhension et sa méprise totales. Sur Bergson, son désaccord, qui est légitime, est gâté par beaucoup d’étroitesse. Ne parlons pas de Péguy et de Claudel, fusillés au passage mais auxquels je fais bien plus confiance qu’à lui pour ce qui concerne la théologie.
Le peu que dise Benda sur sa conception de Dieu est révélateur de ses faiblesses philosophiques et du caractère insatisfaisant de son système. D’ailleurs, en dehors de quelques principes assénés, on peine à donner des contours un peu ferme à une pensée qui multiplie les références sans que leur cohérence soit assurée. Le rationalisme hellénique allégué ne suffit pas à fonder un système, il fait bon marché des complicités éventuelles que ses principaux représentants pourraient avoir avec le pragmatisme fatal des clercs dévoyés.
Il y a, néanmoins, lieu de ne pas rejeter entièrement le message de Benda. Si éthéré soit-il, si grevé par l’idéalisme, si proche d’un tolstoïsme qui consiste à corrompre le message de l’Evangile par refus de l’abîme, il n’en désigne pas moins, dans sa conclusion, un danger qui se précise encore plus aujourd’hui. C’est celui d’une humanité parvenue à la pleine maîtrise de sa puissance : « l’humanité atteindra à de grandes choses, je veux dire à une main-mise vraiment grandiose sur la matière qui l’environne, à une conscience vraiment joyeuse de sa puissance et de sa grandeur. Et l’Histoire sourira de penser que Socrate et Jésus-Christ sont morts pour cette espèce. »
23 AOÛT
Suis-je un « multilatéral » du style de Thibaudet ? Sûrement pour une part si je songe à ma faculté de m’insérer dans des communautés diverses sans m’y sentir étranger et en m’y considérant tout à fait libre. Ce qu’on pourrait m’imputer comme dilettantisme, voire relativisme, me paraît au contraire, relever d’une exigence intérieure. C’est du moins ainsi que je comprends les choses. Je n’abdique rien de mes convictions et c’est en pleine clarté que je m’efforce d’exposer aux uns et aux autres ce que je pense. Bien sûr, il importe de ne blesser quiconque et de partir de ce qui peut constituer une base d’accord pour dessiner par ailleurs au-delà ce qui reste en contentieux. Je n’ai nullement la prétention de m’ériger en arbitre de toutes les querelles, ce qui dépasserait mes forces. Au moins puis-je plaider pour plus d’ouverture réciproque et éviter les logiques trop closes sur elles-mêmes. Si je puis offrir plus d’informations pour modifier des jugements trop catégoriques, je n’aurai pas perdu mon temps. Mais il faudrait aller plus loin, en dépassant les crispations et en posant les débats dans leur bonne dimension.
J’écris cela après diverses rencontres et quelques lectures qui m’ont laissé des impressions mitigées. Je pense, ici, notamment, au monde traditionaliste qui peine à trouver ses marques dans une Eglise pourtant mieux disposée à son égard. Il est difficile de trouver sa place dans l’institution dont a été séparé pendant longtemps. Les méfiances réciproques demeurent considérables. Elles s’expliquent par de très mauvais souvenirs, mais aussi par des habitus intellectuels très différents.
J’entends tel représentant d’un courant « de la Tradition » – j’ai des objections, d’ailleurs à cette dénomination – et je tente de comprendre la singularité de son langage et de supputer ses possibilités d’écoute au-delà des cercles où il est d’évidence. Je mesure la difficulté, non seulement eu égard à la sottise médiatique – pensez-donc : la messe en latin ! – mais aussi eu égard aux chrétiens de bonne volonté qui ne s’y reconnaissent pas. Deux thèmes sur lesquels réfléchir sans trop se hâter. Y a-t-il une spiritualité propre à « la Tradition » ? Et qui pourrait toucher les cœurs, provoquer des conversions à l’encontre d’une prédication conventionnelle (je répète les mots entendus) ? Il ne faut pas barrer la perspective, malgré les objections. J’ai eu une très mauvaise impression à lire certains textes cultivant le jansénisme dans ce qu’il peut avoir de plus terrifiant. Secondement, le langage liturgique qui s’exprime dans la forme latine a-t-il une efficacité propre, porte-t-il à une intelligence spécifique des saints mystères ? Je ne l’exclue pas, mais pour des motifs qui ne sont pas ceux allégués lorsqu’on parle du sens du « sacré ». Sans doute y a-t-il un sens recevable à ce terme, selon moi ambigu, celui qui nous contraint à entrer dans une sainte liturgie dont l’ampleur nous dépasse et qui nous entraîne bien au-delà de nos pauvres sentiments. Le banal, le mièvre, le bien-pensant, l’idéologique ne conviennent en rien, il faut les laisser à la porte. Le latin facilite-t-il ce passage ? C’est possible, mais plutôt que de tabler sur l’étrangeté et tout ce que la phénoménologie du religieux nous a décrit (Eliade, Otto) et s’applique aux dieux des païens, c’est la culture propre aux textes chrétiens que je retiens : leur poésie supérieure, leur beauté indiscible. Qu’on le veuille ou pas, un seul Salve Regina, le seul Christus factus est pro nobis de la Semaine sainte nous hissent à un sommet inégalé de l’expression chorale.
25 AOÛT,
Comme tout le monde, j’ai suivi l’actualité de l’été et si je n’y ai pas fait écho ici, ce n’est pas indifférence mais idée que je n’avais rien de notable ou de bien personnel à y ajouter en fait de commentaire. Certains sujets dépassent d’ailleurs ma compétence, telle la tempête sur les marchés financiers. Je tente simplement d’y comprendre un peu quelque chose. Quand à l’actualité présidentielle française, qui a excité tant de mes collègues, je ne dirais qu’elle m’amuse, elle provoquerait plutôt ma perplexité. Je ne vais pas m’aviser de défendre tout ce que j’ai toujours contesté et même dénoncé : la politique spectacle, l’actualité people, la domination des communicants, etc. Mais ce qui me titille tient à cette connivence entre les plus dénonciateurs de mes collègues et l’objet de leur courroux. Après tout, Nicolas Sarkozy peut prendre les vacances qu’il désire, là où ça lui chante. Le principal est que les intérêts de l’Etat soient protégés et que le pays soit mené sur de bonnes voies. On me répond que le style de vie présidentiel n’est pas étranger à la façon dont on gouverne et qu’on ne peut pas fréquenter impunément les plus fortunés en pratiquant leur mode de vie. On finit par adopter leur vision du monde et leur échelle des valeurs, au mépris du commun des citoyens. Ce n’est peut-être pas faux. Mais n’est-ce pas l’éthos reconnu, privilégié, popularisé par l’ensemble des médias, y compris les plus élitistes culturellement ? Comment s’étonner de ce qu’un président en qui se reconnaît largement l’opinion (voire les sondages) vienne illustrer sur la scène des télé, des magazines et des commentateurs ce qu’on ne cesse d’ériger en modèle du bonheur, de la réussite et de la gloire ? D’un côté, on fabrique un monde avec les enfants de la télé et leurs mythes, on se repaît du stars système, on donne à rêver avec les images de l’intimité ensoleillée des privilégiés et on se plaindrait, d’autre part, d’un président qui évolue naturellement dans ce décors ! Il y a là quelque illogisme.
Mais, bien sûr, la rentrée va nous changer tout cela, avec les réformes entreprises, les décisions douloureuses, les économies qui fâchent. Les représentants de l’opposition me paraissent souvent, pour le moment, un ton en dessous des éditorialistes dans leurs critiques. Leur prudence est liée au climat de l’opinion qui ne leur est pas favorable, mais aussi à leur propres incertitudes programmatique.
28 AOÛT
La rentrée… bien sûr. Littéraire, elle se manifeste par l’envoi des premiers livres qui seront en librairie en septembre. Le premier reçu de Parole et Silence concerne le Péché Originel. Maria Besançon, bibliste, entend montrer qu’Adam est tout à la fois « l’homme qui a fait entrer la mort dans le monde » et l’intercesseur qui veut porter la faute avec « la mission de protéger le pauvre pécheur ». Mes premières incursions me donnent un avis bienveillant sur ce travail qui tend à approfondir de l’Ecriture sans vouloir l’édulcorer. Bibliste et non dogmaticienne, Maria Besançon sert l’intelligence de la foi par les seules ressources de l’investigation de la Parole révélée. Elle répond ainsi à mon sentiment selon lequel cette parole a encore infiniment à nous livrer après des siècles et des siècles d’exégèse. Ceux qui pensent que la thématique du péché originel est obsolète, ne serait-ce qu’à cause des données de l’anthropologie scientifique, en sont pour leurs frais.
L’anthropologie scientifique est dans l’impossibilité radicale de nous dire quoi que ce soit de pertinent sur la vocation divine de l’humanité, sur les origines du mal moral, sur les péripéties d’une humanité divisée à cause de sa conscience blessée. En même temps, les formules dogmatiques n’épuisent pas le mystère, elles sont des invitations à le penser dans ses dimensions insondables. C’est Pascal qui parle des mystères inconcevables. Il nous renvoie ainsi à ce qui est hors de nos prises. Mais en ajoutant que sans eux nous sommes inconcevables à nous-mêmes, il ne bloque pas la recherche. Il l’ouvre au maximum. Les textes de l’Ancien Testament constitue une source inépuisable de recherche anthropo-théologique qui nous permet d’avancer dans cet inconcevable qui est le fond de nous-mêmes.
A première vue, Maria Besançon traite dans une autre perspective la question abordée par Marie Balmary, dans Adam ou la traversée de l’Eden (Grasset), livre qui m’avait inspiré une critique assez radicale parce qu’il me paraissait nier l’événement du péché et ses conséquences. Mais il y avait quelque chose de juste dans cette perception d’une expérience d’humanisation accomplie par l’humanité en ses jours fondateurs. L’épreuve du mal et de la mort, si cruelle soit-elle, n’interrompt pas une aventure qui se poursuit avec ce Dieu qui propose son salut au-delà de la désobéissance qui a tout troublé. Là où Marie Balmary laisse à penser que la désobéissance était non seulement inévitable mais fondatrice, indispensable à l’apprentissage de la vie humaine, il me semble que Maria Besançon n’élude pas la catastrophe initiale, la transgression gravissime de la faute. Mais elle n’ignore pas que l’histoire commencée se poursuit : « A cause du péché d’Adam, la mort est entrée dans le monde, mais le règne sacerdotal qu’il a suscité de Dieu dans son offrande sera l’enclôt qui protégera, affermira, dans une alliance avec Dieu, les fils d’Adam. C’est dans cette alliance qu’adviendra l’Avénement de la descendance de la femme. Ce rejeton, en face de la même bête, aura la même inspiration venant de la même source, mais en Esprit vivifiant (1 Co 15,46). C’est lui qui cultivera le sol maudit, fera fructifier, pour Dieu les terrestres du sixième jour. C’est lui qui accomplira en perfection l’ébauche de l’expiation de l’homme pour acquérir en Dernier Adam, selon la même figure, le statut du grand prêtre qui scelle pour toujours l’alliance avec Dieu. Nous découvrons donc que ce qui semble, à première vue, source de malédiction contient aussi la bénédiction. »
Si le livre de l’Ecclesiaste déclare qu’Adam est le plus grand de tous et si Paul affirme qu’il est l’image de celui qui devait venir, il faut convenir que le premier homme n’est pas le réprouvé, qui tel le serpent, serait marqué de la seule malédiction. Certes le péché est inscrit dans son devenir, mais il n’y est pas enfermé comme dans son unique destin. Le salut est son horizon : « c’est la vie et la mort que j’ai placé devant toi, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie… » (Deutéronome 30, 19). Ainsi, la vérité de Marie Balmary est restituée, sans que la rupture du péché ait été, bien au contraire éludée. Quoi qu’on dise, la culture humaine, tant qu’il y aura des hommes et des femmes, se reconnaîtra dans la thématique du péché dit originel comme dans une des plus troublante, ne serait-ce que pour y reconnaître la blessure de l’origine, la plus commune et la plus énigmatique.
30 AOÛT
Voilà un auteur qui aurait provoqué l’irritation et le rejet de Julien Benda, parce qu’il contredit complètement la tradition rationaliste et engage la pensée dans une aventure où toutes ces catégories sont déniées et délaissées. Je pense à Michel Henry, un des plus grands philosophes du XXe siècle dont je n’ai pas lu tous les livres avec l’attention suffisante. Il est presque scandaleux de ne pas avoir pris le temps d’une lecture approfondie de l’Essence de la manifestation, alors que l’intérêt que je prenais à son œuvre, surtout celle de la dernière période, aurait commandé une recherche du côté de l’émergence d’une phénoménologie tout à fait originale. Mais, journaliste, et prisonnier d’une actualité papillonnante, je ne puis toujours être à la hauteur des exigences d’une vraie ascèse intellectuelle, au sens de discipline méthodique pour une recherche de longue haleine. Ce n’est pourtant pas faute de désir et de bonne volonté.
Déjà, la rentrée qui s’annonce me vaut la réception d’une multitude d’essais que j’absorbe souvent avec passion (au moins sept lu ces derniers jours). Un universitaire, un philosophe de métier, donne sans doute moins prise au dilettantisme et aux dernières parutions que l’homme du journal quotidien. Et pourtant, j’essaie de poursuivre ma tâche le mieux que je peux, m’employant à distinguer les questions importantes, celles sur lesquelles, il faut d’urgence intervenir en offrant le meilleur éclairage. Pour revenir à Michel Henry, un auteur de cette dimension réclame la longue distance, la patience de soirée de lecture. Mais il arrive qu’une percée synthétique vienne, comme un don un peu miraculeux, nous introduire au secret d’une recherche, au cœur de l’intention fondatrice d’une démarche. C’est bien le cas du recueil d’entretiens qu’a publié en 2005 Sulliver, un éditeur établi à Arles en Provence. Pourquoi n’ai-je reçu ce volume que deux ans après sa parution annoncée et quelle délicate attention me vaut ce beau cadeau ?
Je l’ai goûté avec reconnaissance, car j’ai pu ainsi reprendre conscience de l’ampleur d’un projet, d’un travail, d’une œuvre. Sur l’essentiel, j’acquiesce, même si quelques objections me viennent en tête. La principale question concerne la révolution intellectuelle que nous impose le philosophe. Rendrait-elle caduque tout ce qui a précédé ou tout ce qui existe encore avec cette pensée de la vie transcendante ? Sûrement pas. Pour cette première raison qu’elle surgit d’une élaboration qui a son lieu d’élection dans la philosophie, son histoire, ses courants et leurs dissonances. La pluralité est nécessaire, ne serait-ce que pour faire apparaître l’originalité de la recherche et de son objet. C’est grâce à une discussion serrée avec Husserl et Heidegger que Michel Henry précise la nouveauté de sa perspective phénoménologique. S’il est encore plus polémique à l’égard de Hegel et de Sartres, c’est pour mieux définir la différence essentielle d’une pensée de l’intériorité.
Quant à la nature de cette différence, on pourrait la définir comme le déplacement qui va de la conception de l’intériorité comme pensée à sa conception comme vie concrète, subjectivité vivante. J’ai un peu de réticence à exclure la pensée objective, même si je perçois bien la force de l’affirmation de Michel Henry. C’est l’affectivité qui recueille la primauté, ce qui ne me gêne pas puisqu’au demeurant le mouvement porte à rejoindre la révélation chrétienne du Dieu-amour, ainsi que la thématique de l’Incarnation. Réflexion à mon sens irréfutable sur la chair : « Une subjectivité impressionnelle, affective, beaucoup plus profonde que la subjectivité intellectuelle, qui se borne à former des représentations et des concepts ».
Il existe une façon de donner à la pensée objective une fonction qui la désincarne, la soustrait à la subjectivité vivante. Michel Henry excelle à le montrer, mais son plus grand mérite est de renvoyer à cette pensée affective sans laquelle le monde est sans couleur, sans saveurs, j’oserais même dire sans substance au sens où le sujet n’a de réalité que dans l’affectivité qui le constitue et lui donne présence à lui-même. Sur tout cela, le philosophe est parfaitement convainquant. Reste qu’il y a dans cette démarche une récusation du logos grec qui me gêne un peu et même beaucoup. Pourtant, la différence du logos johannique d’avec lui me semble incontestable. Ce qui me trouble, c’est l’écart avec un hellénisme dont Benoît XVI a dénoncé l’abandon dans sa conférence de Ratisbonne. Je laisse pour le moment l’affaire en suspens, n’ayant pas les moyens de la résoudre.
J’ajouterais qu’une des vertus de Michel Henry est de bousculer les certitudes toutes faites. Un des meilleurs exemples est la façon dont il comprend Marx contre le marxisme et nous impose une ressaisie complète qui défie toutes les lectures, même celle de Raymon Aron, à laquelle j’ai depuis longtemps adhéré. Il y a donc, qu’on le veuille ou non, un avant et un après Michel Henry, que seule la profondeur d’un travail considérable permet de comprendre. Je n’ai rencontré l’homme qu’une fois, et c’est sa modestie et sa simplicité qui m’ont le plus impressionné. Vraiment, il ne se la jouait pas ! Il était à cette ultime période où la méditation de saint Jean s’imposait à lui comme l’achèvement obligé de sa recherche. Et c’est dans la plénitude de sa trajectoire d’une évidente cohérence que nous avons à considérer désormais son legs intellectuel.
Michel Henry, Entretiens, Sulliver, 160 pages, prix : 22 euros.