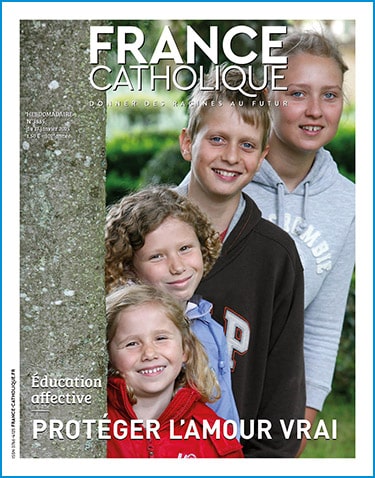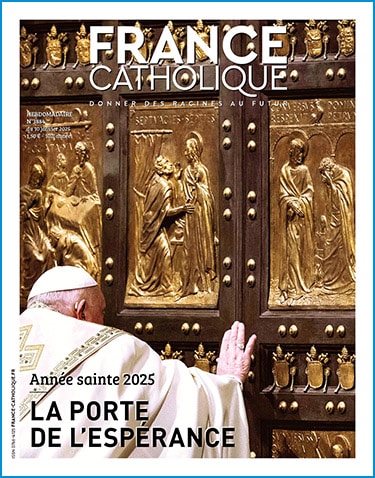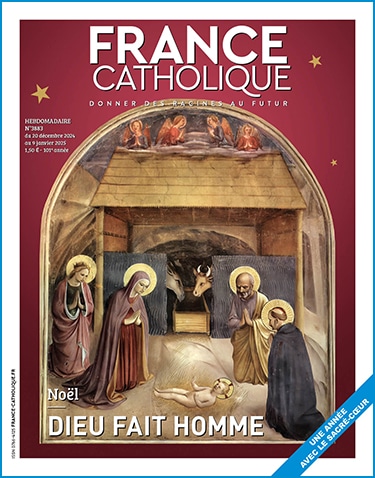A en croire Herbert Marcuse, qui est, comme on sait, le prophète des casseurs, Automation et Contestation seraient les deux mamelles de la société future sous le signe d’Eros. La contestation commencerait pas casser la société actuelle, puis l’automation se chargerait peu à peu de tout le labeur de l’homme, lequel, enfin oisif, pourrait consacrer sa vie aux seules activités humaines dignes de ce nom, à savoir, celles de la « libido » (a).
La société « libérée » aura ses flics
Les sociologues, les économistes, les moralistes ont sans doute leurs idées sur cette aguichante Utopie (1).
Il faut le reconnaître, Marcuse a prévu qu’on lui chercherait des poux dans la tête de ce côté. A maintes reprises, il a donc dénoncé d’avance toute analyse scientifique de son « message » : la science et la raison sont des « instruments d’oppression ». Si mon système ne tient pas debout, tant pis, puisque pour l’instant le but n’est pas de proposer un système cohérent, mais de casser celui qui existe. Cassons d’abord, on verra après.
Donc, je reconnais me mettre dans un mauvais cas en avançant quelques objections : puisque je n’accepte pas sans murmurer le « paradis » du cuisinier chinois (b), je me classe d’emblée parmi les « oppresseurs » qu’il faudra « opprimer ». Ce M. Marcuse est terrible. Il veut nous rendre heureux en dépit de nous. Hâtons-nous donc de profiter de ce qui reste de liberté « bourgeoise » si nous voulons nous livrer encore à l’activité réactionnaire appelée « réflexion ».
La première question qui vient à l’esprit est celle de savoir par quel miracle l’automation libératrice pourra se réaliser si l’on commence pas casser la société. Marcuse semble se faire une idée bucolique de l’automation : c’est une fleur des champs ; il lui suffit, pour pousser, d’être arrosée par l’eau du ciel et réchauffée par les rayons du printemps. Nous pensions pourtant que le hardware, c’est-à-dire la part de « quincaillerie » de l’automation (les semi-conducteurs, les ferrites, les câblages, etc.), c’est de l’industrie, et de la plus complexe. Et que la fabrication d’une mémoire d’ordinateur met en jeu à peu près tout l’ensemble des industries et des sciences humaines, chimie d’abord, magnétisme, électronique, et par voie de récurrence, toutes les autres sciences et industries de proche en proche. A peu près tout le labeur des hommes a collaboré à ce minuscule cristal qu’un spécialiste d’IBM insère parmi des milliers d’autres dans son réseau et qui tient sur l’ongle de mon petit doigt. Ce labeur, comment l’exécuter dans une société préalablement clochardisée et dérationalisée ? « Cassons d’abord, nous verrons bien. » Certes, nous verrons bien. Mais, s’il vous plaît, avant de sauter dans ce trou où vous me promettez la « libération », permettez que je jette un coup d’œil.
Et il n’y a pas que le hardware. L’ingénieur en software, qui réfléchit à l’utilisation de la machine, est l’être le plus rationaliste qu’ait jamais produit aucune science. Du moins l’est-il dans son travail. Nous connaissons en Amérique des mathématiciens hippies, mais ce sont des hippies pour rire. Ils vivent leur temps libre dans la « commune », conformément à l’idéal de promiscuité, de farniente et de pop’ music qui est le leur. Mais pour faire leur travail, ils viennent chaque matin dans la « société », parmi les « cochons ». Car, seuls, les « cochons » maintiennent en état de marche la machine sociale qui leur paie leur travail. Que les « cochons » soient un jour mis hors d’état de nuire par la grâce de M. Marcuse (un peu aidé par ses « flics »), et ces mathématiciens hippies perdront leur travail et leur fin de mois.
La science ne saurait décider
Ce ne sera pas grave, certes, puisque le travail des « cochons » est « aliénant ». Mais l’automation chère à Marcuse, où diable se fera-t-elle alors ? Je me livre aux activités « répressives » (et même « sur-répressives », tant qu’on y est), de la réflexion, je n’arrive pas à voir comment une société préalablement détruite pourrait libérer les hommes du poids de leur travail en le confiant à des machines. Des machines faites comment, et par qui ?
Mais, enfin, admettons : les machines se font quand même grâce à quelque miracle d’Eros, divinité puissante à qui l’on ne saurait trop demander. Autre miracle : ces machines marchent, s’entretiennent et se réparent seules. Admettons. Qui va décider de ce qu’elles devront faire et comment sera réparti le produit de leur travail ? Jean-Jacques Salomon, qui n’est qu’un modeste technicien de l’OCDE où il dirige la division des politiques de la science, vient de montrer, dans un livre épais et bien documenté (3), toute la complexité des rapports qui lient entre elles la science et la politique. Modeste technicien, disons-nous, car il n’avance rien que documents à l’appui. Il ne dispose pas des bienheureuses facilités du prophète. Il ne nous dit pas : « Fermez les yeux et sautez, Eros fera le reste ». Et la leçon de son livre est sévère.
Nous ne pourrons pas indéfiniment, montre-t-il, nous en remettre aux solutions techniques. La science ne peut répondre qu’aux questions qu’on lui pose. Et poser les questions, c’est faire des choix de nature politique et morale. Il existe une réponse technique à la question : « Comment exterminer tous les Juifs aux moindres frais ? » Cela peut se calculer. Ou à la question : « Quelle part devrait être prélevée du produit brut des pays surdéveloppés pour supprimer la faim dans les pays pauvres ? » Cela aussi se calcule, si les détails sont bien définis. Mais, montre J.-J. Salomon, la science ne saurait décider si ces questions ou d’autres doivent être posées. Et refuser de décider, c’est encore décider, car c’est choisir de laisser s’aggraver les désordres établis.
Ainsi, la science ne nous libérera pas des choix moraux. Elle ne nous délivrera pas de nos responsabilités.
Quant à savoir si nous assumerons ces responsabilités que la science n’est pas en nature de prendre, c’est une autre histoire. Constater que le bateau qui prend l’eau ne se réparera pas de lui-même est une chose, retrousser ses manches pour le réparer en est une autre. On peut très bien continuer à jouer aux cartes, quitte à proclamer que le capitaine est un incapable. On peut aussi saborder ce navire déplorable à la faveur d’une tempête. Eros, c’est sûr, viendra avec ses petites ailes nous apporter un beau bateau tout neuf au moment de la noyade, puisque Marcuse nous l’a promis.
Aimé MICHEL
(1) François Perroux, professeur au Collège de France : François Perroux interroge Herbert Marcuse (Aubier, 1969).
(2) H. Marcuse : la Fin de l’Utopie (sic). Le Seuil, 1968.
(3) J.-J. Salomon : Science et Politique (Le Seuil, 1970).
Notes de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 28 parue dans France Catholique – N° 1269 – 9 avril 1971.
(a) Sur Marcuse voir aussi la chronique n° 9, L’hormone de la contestation, parue ici le 24 août dernier. La thèse de La fin de l’utopie, analysée dans cette chronique, était déjà présente dans ses deux livres précédents et plus connus, Eros et civilisation (1958) et L’homme unidimensionnel (1964). Dans la chronique suivante Le sexe et la société apaisée, Aimé Michel nuance son propos en approuvant certains diagnostics de Marcuse tout en récusant ses traitements. Il voit dans l’obsession pour le sexe un symptôme de ce que la société est malheureuse.