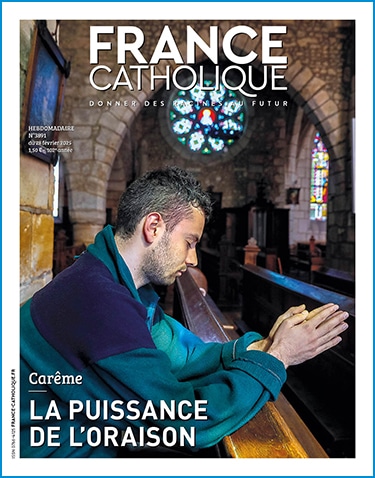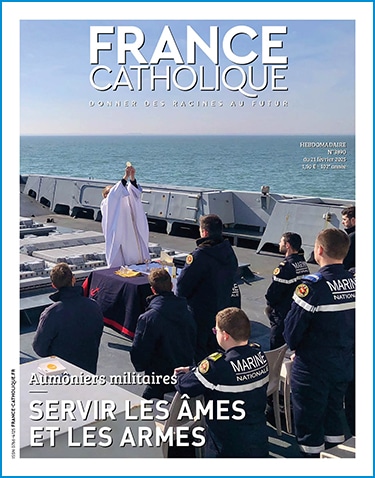Il faut en prendre conscience : bien qu’elle n’ait probablement été ni préparée ni voulue, bien qu’elle effraie les protagonistes, la grande confrontation entre l’Est et l’Ouest, entre régimes libéraux et régimes socialistes, est maintenant engagée, et nul ne peut plus l’arrêter1.
C’est la première guerre de l’histoire qui ne se livre pas avec des armes. C’est aussi la première dont les épisodes ne sont ordonnés nulle part et échappent complètement à la volonté des hommes. C’est la première enfin où il n’y ait ni combattants, ni généraux, ni plans, mais où, bien au contraire, ceux qui détiennent une autorité cherchent (en vain jusqu’ici) comment tout arrêter, comment obliger les choses à prendre un autre cours, comment échapper à la machine révoltée.
Seulement, voilà : c’est le cours lui-même des choses qui emporte les faibles actions humaines, c’est la machine qui, par le jeu de ses ressorts inaccessibles, a pris pour nous les décisions et les conduira impitoyablement à terme. Où, comment ? Jamais les hommes n’ont paru si impuissants devant les forces aveugles (ou providentielles) de l’histoire.
[| * |]
A cette guerre, dont nous n’avons vu jusqu’ici que les tout premiers signes, nous donnons le nom de crise. En quoi consiste-t-elle ?
Essentiellement en ceci que l’économie (à la suite d’un incident, le changement pourtant inévitable des cours de l’énergie) a soudainement cessé de se conformer aux lois connues. Cela a commencé à l’Ouest, dans les pays à économie libérale. Comment lutter contre le cancer proliférant des devises ? Comment maîtriser l’inflation ? Comment faire face à ce phénomène sans précédent, la récession dans la montée des prix : la stagflation ? Où trouver des substituts aux remèdes qui jusqu’ici marchaient et qui soudain sont impuissants, comme celui, cynique mais qui avait toujours eu son effet, de réduire l’emploi pour tempérer les pressions revendicatives ?
Pas de réponses ! Personne ne sait ! Moyennant des mesures draconiennes, on arrive à tempérer un peu ici ou là telle vague de la tempête, mais la tempête elle-même, point ! Elle continue de plus belle, elle s’étend, elle prend de nouvelles formes, inattendues !2
[| * |]
Et à l’Est ?
Une idée fausse et malveillante apparaît souvent dans notre presse : c’est l’Est qui tire les ficelles ; notre crise est manigancée par les chefs des États communistes pour en finir avec le capitalisme (variantes : avec la complicité des Arabes ; avec celle des syndicats).
Cette idée est fausse et absurde pour une raison bien simple ; c’est que les régimes communistes sont bien plus gravement menacés que nous si la crise dure et s’aggrave encore quelques années. C’est que leur économie construite de A à Z sur la planification centralisatrice n’a aucun moyen de faire face à des remous imprévisibles ni d’y échapper.
Vis-à-vis de la crise, l’Occident est dans la situation du cow-boy juché sur un cheval fou et tentant de le dompter ; il transpire, il a peur, à chaque instant il risque de chuter et de se rompre le cou. Mais l’Est ! Sur le cheval fou, l’Est est ligoté, paralysé, incapable de bouger le petit doigt, réduit à recommander son âme à Dieu, à qui il ne croit pas !
Sans doute la question est-elle : l’Est est-il sur le cheval fou ?
Mais il y est ! Exactement comme nous ! L’économie de l’Est comporte un chaînon essentiel, celui de ses échanges avec nous. Voyez son désir anxieux, sans cesse répété, de développer les échanges commerciaux ; lisez l’analyse de Melik Agourski (« Les systèmes socio-économiques actuels et leurs perspectives » dans Des voix sous les décombres, le Seuil, 1974) ; voyez surtout les premiers signes du désordre manifesté là-bas. Il n’a pas pour l’instant la même forme qu’ici, chômage, faillites, récession. Son atteinte est plus profonde, plus essentielle et, s’il dure, plus fatale ; il désorganise et sape les plans, qui font toute vie du pays.
Déjà les balances intérieures des changes sont faussées jusqu’à l’absurde entre pays socialistes ; les prix réels, les bilans réels des trusts d’État ne correspondent plus à aucune réalité. Le désordre profond s’installe encore plus ou moins masqué par la toute-puissance de l’État, mais insupportable à la longue. Pour faire face à ses importations vitales, l’URSS a augmenté entre autres matières premières son pétrole vendu aux autres pays de l’Est, exactement comme ont fait les pays arabes, créant chez eux d’insolubles problèmes de prix de revient.
En Occident, la crise est douloureuse à la base, au niveau de la population. A l’Est, elle mine l’assise même du pouvoir, elle brise peu à peu ses ressorts. Le gouvernail et le moteur, pour prendre une autre image, cessent de répondre à la main du pilote.
[| * |]
Il faut se défaire de certaines idées. Ce n’est pas par hasard que l’URSS a, comme on dit, « voté Giscard ». Elle a un besoin désespéré d’ordre économique international. Ses Ponomarev, je veux dire ses théoriciens, peuvent bien continuer de réciter mécaniquement les vieux catéchismes révolutionnaires. Les vrais responsables, eux, tremblent à l’idée d’un monde capitaliste longuement livré au désordre.
[| * |]
Voilà donc les deux mondes affrontés, contre leur volonté, face à un problème unique qui, pour eux, sonnera l’heure de vérité. Avec ses remous imprévisibles, la crise éliminera le moins apte. Ou plutôt, de façon moins simple, elle les changera tous les deux plus ou moins profondément. Si l’épreuve dure, si elle empire, celui qui ne peut pas changer n’y résistera pas. Et ce n’est pas un des moindres paradoxes de ce combat dans un tunnel que de voir nos révolutionnaires jouer l’aggravation de la crise, y pousser de toutes leurs forces pour faire choir les régimes libéraux. A force de secouer ici le cocotier, ils seront peut-être l’instrument de la révolution dans les pays de l’Est.
Aimé MICHEL
(*) Chronique n° 214 parue dans France Catholique-Ecclesia − N° 1495-1496 − 8-15 août 1975.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS
- Cette première affirmation, développée dans la suite de la chronique, apparaît comme une prévision singulièrement juste. En 1975, quand cette chronique a été écrite, Brejnev était au pouvoir en URSS depuis onze ans et devait le rester encore sept ans, jusqu’en 1982. L’Union soviétique pouvait alors paraître au faîte de sa puissance en dépit des difficultés de son agriculture (elle dut recourir à des importations massives de blé, jusqu’au quart de la récolte américaine en 1972, voir la chronique n° 104, Software et politique, parue ici le 1er juin 2010). Comme Aimé Michel l’avait bien vu, celui qui ne pouvait pas changer n’a effectivement pas résisté,
- Cette seconde affirmation est également remarquable. Les problèmes économiques n’ont cessé de se poser sous des formes toujours nouvelles, obligeant à des adaptations rapides et forcées. Ce qui est nouveau depuis la crise pétrolière de 1973 ce n’est pas la nécessité de s’adapter à des situations toujours nouvelles, c’est le rythme des changements. Cette accélération du rythme en économie est la conséquence de l’évolution des techniques, évolution continue depuis les origines de l’homme. Son accroissement d’allure exponentielle voire hyperbolique l’a rendue perceptible, depuis quelques générations, au cours d’une vie humaine. On est ainsi conduit à replacer les faits économiques contemporains dans la perspective de très long terme dessinée par le géologue André de Cayeux (voir par exemple la chronique n° 236, Teilhard de Chardin et les temps déchiffrés, parue ici le 12 décembre dernier), l’anthropologue André Varagnac (voir la chronique n° 210, Les marchés de l’immatériel, parue ici il y a trois semaines), ou l’économiste Pierre Grou (voir par exemple sa contribution à l’ouvrage de J. Chaline, L. Nottale et P. Grou, Des fleurs pour Schrödinger. La relativité d’échelle et ses applications, Ellipses, Paris, 2009). Leur réflexion, si elle ne permet pas de prévoir l’avenir, a du moins le mérite de replacer les désordres économiques actuels dans un cadre intelligible, fournissant ainsi un antidote au poison de l’absurdité sans espoir qu’ils distillent.