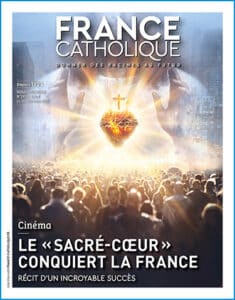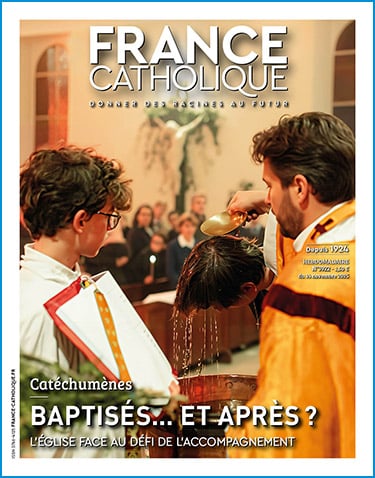En 1248, alors qu’à la tête d’une septième croisade dont on attend merveille, Saint Louis cingle vers la Terre sainte, il ne sait pas grand-chose de cet « Orient compliqué », peu fait pour les idées simples et la candeur d’un saint… Une escale à Chypre le met au contact d’une première réalité qu’il ignorait : la présence sur l’île d’une très forte colonie maronite – chrétiens du Liban – originaire du Mont Liban et qui a choisi de rejoindre un territoire encore sous contrôle des Occidentaux. Ce n’est point par lâcheté que ces gens sont partis mais afin de mettre leurs familles en lieu sûr. Le roi le comprend bientôt en constatant la soif de combattre des guerriers maronites et leur désir de lui apporter leur aide et leur connaissance du terrain.
Que ces hommes n’aient pas ménagé leur sang, un chiffre en atteste : sur les 5 000 combattants chrétiens fournis par le Liban, seuls 102 regagneront Chypre… Saint Louis aurait signé, le 24 mai 1250 une charte à la hauteur du prix du sang versé par ces chrétiens d’Orient au service de la France : « Pour moi et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner à vous et à tout votre peuple notre protection spéciale comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. » Cette tradition, à considérer en tant que telle, révèle un privilège rare et remarquable qui se muera hélas, du fait de la défaite des croisés, en une protection plus ou moins efficiente sur les chrétiens d’Orient.
L’héritage de saint Louis
Tout aurait pu s’arrêter dès la chute de Saint-Jean-d’Acre, en 1291. En effet, la conquête de la ville par les musulmans mettait un terme définitif au rêve de reconquête des Lieux saints, en dépit de quelques projets de nouvelle croisade toujours restés sans lendemain. Si, depuis François Ier (1494-1547), nos rois cultivent l’alliance turque, ils sauront s’en servir comme d’un moyen d’imposer aux Ottomans une protection française de fait sur les minorités chrétiennes. Protection qui, jusqu’à une date récente, ne sera jamais remis en cause.
Accordées à la France en 1536 par le sultan ottoman Soliman le Magnifique, les « Capitulations » – des concessions – assurent à la France, outre des avantages commerciaux, la garantie de la sécurité de ses ressortissants, la garde des Lieux saints et, officieusement, un rôle de protectrice des minorités opprimées. Henri IV obtient en 1609 d’étendre cette protection à tous les pèlerins de Terre sainte. En 1625, le Père Joseph, capucin, à la tête de la diplomatie de Louis XIII, est autorisé à envoyer des missionnaires à Alep. Grâce à cela, les consuls français tissent sur place un réseau d’influences dont l’une des raisons d’être est de concrétiser cette protection française sur les chrétiens orientaux, tenu bientôt pour officiel, comme le rappelle une lettre de Louis XIV du 28 avril 1649.
Il n’en faut pas davantage, comme en témoignent des voyageurs et missionnaires de l’époque, pour que les chrétiens d’Orient idéalisent cet appui français, purement symbolique et fondent leur espérance d’être un jour délivrés du joug islamique par un roi de France. Pour les maronites, la France devient ainsi l’« Oum al huldu », la « tendre mère » qui, de loin, veille sur eux. Tout cela relève d’autant plus du rêve que le siècle des Lumières, la Révolution, puis la chute de la monarchie, ne favorisent pas l’intérêt pour les maronites, qui se définissent d’abord comme chrétiens et sont attachés à une forme de régime féodal.
L’enthousiasme des écrivains
Or, contre toute attente, c’est précisément cette détermination d’une minorité chrétienne persécutée à sauver son âme et survivre coûte que coûte qui permet, à l’aube du XIXe siècle, l’éclosion en France d’un courant littéraire et politique prêt à s’enthousiasmer pour elle, au point de s’engager en faveur du nationalisme libanais et du projet d’un État indépendant du Liban. Peu importe que ces écrivains – à commencer par Chateaubriand et Lamartine –, journalistes, et rares hommes politiques, aient eu une vision tout aussi déformée et idéalisée des chrétiens libanais que celle qu’ils ont eux-mêmes de la France : le malentendu sera constructif.
C’est pour arracher la « tendre mère » à son attentisme face à la montée des tensions, qu’un prélat maronite, Mgr Murad, se rend à Paris et entreprend de travailler l’opinion française en faveur de son peuple. Il est sûr qu’un sentiment identitaire et nationaliste maronite s’affirme de plus en plus. Il prend assez d’ampleur pour qu’en 1856, le sultan ottoman Abdulmecid Ier en finisse avec la « dhimmitude » imposée aux chrétiens par l’islam. Non seulement il supprime ce statut discriminatoire, mais il confère aux chrétiens les mêmes droits qu’aux musulmans… et davantage qu’aux druzes – ces derniers, placés sous la protection de la Couronne britannique, confessent une religion proche de l’ismaélisme.
L’explosion ne tarde pas : en mars-avril 1856, les druzes pillent un couvent, y tuent un prêtre puis assassinent trois chrétiens, sans réaction des autorités, car le pacha de Beyrouth leur est acquis. Des représailles maronites suivent, qui déclenchent en mai un massacre général des chrétiens. Les flottes occidentales évacuent quelques milliers de réfugiés, puis la pression internationale oblige les autorités turques à s’interposer. Promesse est faite aux chrétiens d’assurer leur protection, en échange de l’impunité de leurs assassins et de la renonciation aux biens qui leur ont été volés.
L’intervention de Napoléon III
De nouvelles violences, aussi sanglantes, reprennent en 1860, tant au Liban qu’en Syrie. L’on parle de plus de 11 000 maronites massacrés dans des conditions atroces, de femmes et jeunes filles enlevées et données comme esclaves à des musulmans. Mais les temps ont changé : si la France intervient, ce n’est pas tant à la suite des articles enflammés du journal catholique L’Ami de la religion, mais poussée par les intérêts politiques du dirigeant français d’alors, Napoléon III. L’empereur s’était en effet aliéné l’opinion catholique par son soutien à la cause de l’indépendance italienne et donc à la disparition des États pontificaux. Une intervention en faveur des chrétiens du Liban est ainsi vite perçue par Napoléon III comme un moyen de redorer son blason. En 1861, des troupes sont envoyées sous le commandement du général de Hautpoul. Si elle ne dure que quelques mois, cette présence française entraîne la création de l’embryon d’un futur État libanais : la province autonome du Mont-Liban, dont le gouverneur est un chrétien, mais non-libanais.
Par la suite, la IIIe République verra, elle aussi, son intérêt à maintenir une influence française forte dans la région. Bien qu’elle se moque de protéger les minorités chrétiennes, elle appuie l’obtention d’un statut pour les établissements latins du Levant, ce qui lui vaut les félicitations de Léon XIII qui salue en 1896 « la mission à part conférée par la Providence à la France » !
Martyrs de la liberté et de la foi
La Première Guerre mondiale semble porter un coup d’arrêt à cette politique, la Turquie, toujours présente au Liban, s’étant rangée côté allemand. Dans ces conditions, le prêt de plusieurs millions or accordé par la France au patriarcat maronite, seul véritable représentant des nationalistes libanais, n’est pas désintéressé. Rien d’étonnant à ce que les partisans de la France soient traités en ennemis de l’intérieur, traqués, dénoncés, arrêtés et exécutés, tels en 1915 et 1916, les frères Khezenet et le R. P. Hayek, qui meurt en criant « Vive la France ! ». Tenus pour des martyrs de la liberté et de la foi, ces militants nationalistes permettent de justifier la présence du patriarche maronite Elias Hayek à Versailles lors des discussions de paix et, en 1921, lors de la signature du traité de Sèvres, qui place un État du Grand-Liban autonome sous mandat français au prix d’une partition de la Syrie – non sans conséquences à long terme.
Si tout ne sera pas idyllique durant ce mandat français, qui prend fin en 1943, les Libanais peuvent au moins remercier la France de les avoir dotés d’une constitution. Tout comme ils peuvent se féliciter d’établissements d’enseignement prestigieux, telle l’université jésuite Saint-Joseph de Beyrouth, ou les plus humbles collèges des lazaristes, maristes, carmes, capucins qui éduquèrent des générations de jeunes chrétiens, donnant naissance à l’expression « savant comme un maronite ».
L’abandon de Giscard
La fin du mandat français voit cependant se déconstruire l’ancienne amitié franco-libanaise. Certes, en 1968, De Gaulle prend des mesures contre Israël à la suite des bombardements de l’aéroport de Beyrouth. Mais en 1975, quand éclate la guerre « civile » libanaise – fruit de la déstabilisation depuis 1948 de ce petit pays par l’installation de centaines de milliers de réfugiés palestiniens en majorité musulmans – Giscard préférera choisir le camp des puissances arabes, en pleine crise pétrolière. Même l’atroce massacre des chrétiens de Damour par des milices palestiniennes appuyées par des soldats syriens en 1976, qui fait des centaines de victimes et bouleverse l’opinion, n’y changera rien.
Ainsi, le Liban ne serait-il plus qu’un souvenir encombrant et de moins en moins utile, alors que la France elle-même se déchristianise et s’écarte de son passé chrétien, et que les maronites quittent leur pays choisissant l’exil ? Méditer sur le sort du pays du Cèdre serait pourtant riche d’enseignements urgents concernant notre propre avenir.