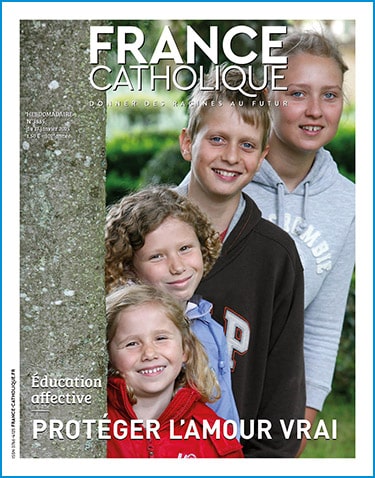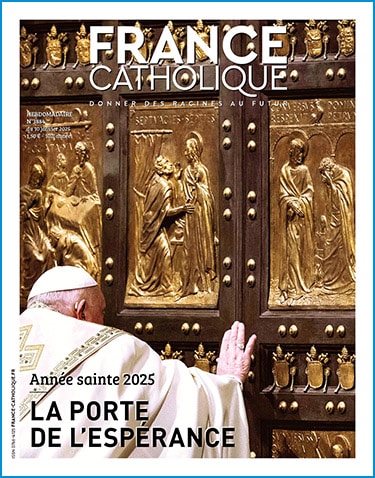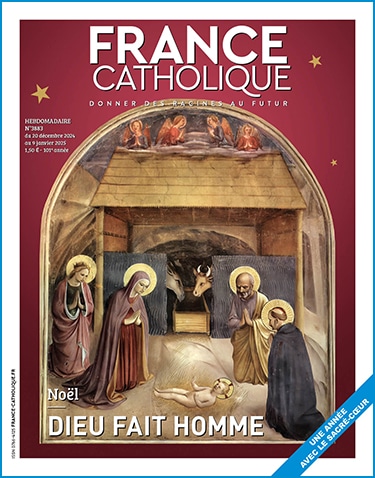L’enthousiasme des historiens laïcs à l’égard de la Renaissance devrait éveiller chez les catholiques une certaine méfiance, tout comme, d’ailleurs, cette appellation de Renaissance, tardivement apparue sous la plume de l’historien et peintre Giorgio Vasari (1511-1574), dans un strict contexte artistique de retour aux techniques des maîtres antiques, mais dévoyée par la suite.
S’il y eut renaissance, il faut bien, en effet, qu’il y ait eu mort et qu’un printemps prometteur ait succédé à un trop long hiver, « arrachement au tombeau de la nuit médiévale » (Daniel-Rops). Autrement dit, une rupture assumée et définitive avec ce Moyen Âge qui vit naître et grandir la chrétienté, univers mental, politique et social où tout tournait autour de Dieu.
Malgré ses splendides réalisations, ses génies, ses chefs-d’œuvre, la Renaissance aura donc été d’abord un changement de paradigme qui imposa la primauté de l’homme sur son Créateur.
Tout cela ne s’est pas fait en un jour, n’en déplaise aux simplificateurs et la crise polymorphe qui aboutit, au XIVe siècle en Italie, au XVe siècle en France, à cette véritable révolution intellectuelle et morale vient de loin.
Peste, guerres et crises
Faut-il l’attribuer à la peste noire qui, en cinq ans (1347-1352), tue entre 30 et 60 % de la population européenne et provoque un vide démographique impossible à combler, brisant ainsi l’élan vital ? À la guerre de Cent Ans ? À une crise de l’autorité qui atteint les gouvernements laïcs mais davantage encore le pouvoir spirituel avec le Grand Schisme d’Occident et une papauté éloignée de Rome prêtant le dos aux scandales en tous genres ? À une rupture d’unité encore inédite dans le tissu chrétien avec les précurseurs du protestantisme, Wiclef en Angleterre, Huss en Europe centrale, puis la perte pourtant annoncée de l’empire byzantin à laquelle les princes chrétiens ne sauront rien opposer d’efficace en temps utile ? À une rupture dans les façons d’être, prévisible dès le XIIIe siècle, avec le monde féodal, le modèle chevaleresque dépassé par une vision plus pragmatique des affaires de ce temps, se laissant subvertir par une morale de commerçants et grands bourgeois incarnée par les banquiers lombards et les marchands toscans ? À l’émergence des États-Nations qui feront passer leurs intérêts propres avant ceux de la chrétienté et refuseront la tutelle du pape ? Ou plutôt à tout cela en même temps…
Divorce entre la foi et la raison
L’Occident se laïcise et l’idéal chrétien partagé et vécu ne survivra pas à la dislocation en cours. Une soif d’émancipation travaille des souverains qui veulent régner sans que le pape leur dicte sa loi, tout comme des penseurs et des scientifiques qui veulent réfléchir hors les cadres du catholicisme. L’homme veut reprendre son destin en main et se soustraire à la Providence et à ses intentions. L’intelligence se prétend désormais autonome, moderne, coupée de ses racines chrétiennes qui l’immobiliseraient.
Paradoxalement, la devotio moderna, courant de piété admirable qui, avec son amour du Christ et de sa sainte humanité, incite au contraire les fidèles au plein abandon à la volonté divine, participe à la démolition ambiante. On lui reprochera, en effet, d’éloigner les intelligences de la raison, de sorte que les mystiques – meilleurs éléments d’une Église trop souvent scandaleuse, en manque de personnalités fortes et charismatiques – seront accusés d’être éloignés des préoccupations de l’époque, et d’en détourner ceux qui aspirent à des réformes. Ainsi serait déjà acté le divorce entre foi et raison.
Faiblesses du clergé
Il faudrait à l’Église, pour lutter contre ce phénomène, ou du moins pour le contrôler, des chefs et des saints qui soient des hommes de terrain. Or ils n’existent pas, et ceux qui voient venir le péril ne savent quoi lui opposer. Les faiblesses du clergé s’étendent au peuple, mal gouverné, outré de certains comportements cléricaux et qui rompt peu à peu avec la morale et la pratique chrétiennes. Tout est prêt pour le basculement du monde occidental hors de la sphère d’influence du Christ.
Telle est, en fait, la Renaissance, et cela explique pourquoi elle plaît tant à nos époques déchristianisées, qui voient en elle le début de cette libération de l’humanité – ses admirateurs préférant mettre en valeur son « singulier éclat », la splendeur de ses créations, la beauté de ses œuvres d’art, faits incontestables qui dissimulent un projet vieux comme le diable de faire de l’homme un dieu décidé à prendre la place du Vrai. Cela ne se verra pas tout de suite.
L’orgueil des princes
La Renaissance est d’abord et fondamentalement un produit de l’Italie du Quattrocento (XVe siècle), de ses cités-États en lutte permanente entre elles, où les princes, qu’ils soient papes ou banquiers, les deux parfois, veulent par tous les moyens prendre le pas sur leurs rivaux et laisser dans l’histoire leur marque. Pour y parvenir, il faut de l’argent, beaucoup, et le mécénat qui permettra cette grandiose floraison artistique porte en lui sa propre corruption car il détourne la plupart des artistes de ce qui était autrefois le but de l’Art : une glorification quasiment gratuite de Dieu à travers leurs œuvres. Les bâtisseurs de cathédrales n’étaient pas vénaux, ni en quête de gloire terrestre. Le nom des prodigieux sculpteurs qui firent jaillir de la pierre le Beau Dieu d’Amiens ou l’Ange au Sourire de Reims, voire l’énigmatique Madone inachevée de Saint-Germain-des-Prés, jetée au rebut car jugée manquée, sont restés anonymes. Les mécènes italiens vont corrompre cette pureté et, glorifiant le génie des peintres, sculpteurs, architectes qu’ils emploient, les pousser à une très lucrative course à la gloire et à la fortune.
Il faut un Fra Angelico pour n’y pas succomber, protégé par son vœu de pauvreté, qui importe manifestement beaucoup moins à Filippo Lippi, moine pourtant, qui ne voit pas obstacle à faire poser pour ses Vierges à l’Enfant ses peu chastes maîtresses. Cet art-là, en dépit des apparences, quand même ses artistes se croient encore chrétiens, l’est-il vraiment ? Est-ce la gloire de Dieu qu’ils cherchent, ou la leur ? Et s’ils pensent encore œuvrer pour Dieu, ce n’est pas pour lui seul.
Les somptueux tombeaux qui viennent encombrer les sanctuaires ne témoignent pas d’une espérance de ceux qui y reposent en l’éternité bienheureuse mais de leur désir païen de survivre dans les mémoires humaines. Rien d’étonnant à ce que l’on construise plus de palais que d’églises.
Cette débauche de luxe et de splendeur cache la misère de populations que les puissants, emportés par leurs rêves, ne regardent plus. Le premier fruit de cette émancipation de la morale chrétienne est d’oublier ses devoirs et ses obligations. Très vite, plus rien ne sera soumis au souci du bien commun ; un égoïsme féroce s’empare des hommes ; l’individualisme triomphe et la volonté de s’imposer, à n’importe quel prix, façon de voir les choses dont le Florentin Machiavel est l’observateur lucide, non l’inventeur. « Le vice est partout », dit-il à raison.
Tout semble désormais permis, tant sur le plan des mœurs, avec un renouveau assumé d’une littérature élégamment pornographique, que sur celui de la pensée qui remet tout en cause, jusqu’aux Évangiles et aux dogmes, sous prétexte d’observation et d’esprit critique.
La redécouverte – surfaite car le Moyen Âge ne s’en était jamais détourné – de la littérature antique permet, certes, au grec et au latin de rayonner sur le monde intellectuel, mais, dans le même temps, le latin, langage universel de la chrétienté, est banni afin de permettre aux langues nationales de s’imposer. Encore cet engouement pour les auteurs païens est-il trop souvent prétexte à mettre en avant l’homme d’avant le Christ, l’homme privé de la grâce et qui n’en avait prétendument pas besoin. La nature doit être suivie plutôt que les commandements. Ce sera la devise de Rabelais.
De curieux humanistes
Certains n’y voient pas malice, qui pensent pouvoir concilier l’inconciliable, le christianisme et le paganisme, voire ne plus croire qu’en celui-là. Il est révélateur que les « humanistes » Le Pogge (1380-1459) et Ange Politien (1454-1494), qui comptent parmi les pires contempteurs de l’Église et de ses dogmes, soient aussi, et demeurent toute leur vie, employés de l’administration pontificale.
Réaction théocratique
Faut-il supposer que le ver est dans le fruit ? Beaucoup, bien avant Luther, le pensent. Comment s’étonner, quand papes et prélats ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, qu’à Florence, le dominicain Savonarole fulmine contre ce perpétuel scandale, l’amoralité radicale de l’époque et finisse par imposer une tyrannie théocratique dans la ville des Médicis, à grand renfort de bûchers des vanités et châtiments publics des pécheurs ? Excès incontestables mais qu’une véritable volonté de Rome de contrôler les dérives de l’époque, et d’accompagner ce qu’elle avait de bon, facilement réconciliable avec la foi et Dieu, eût évités.
Quand, enfin, l’Église s’y essaiera, le coup d’État aura eu lieu depuis longtemps et nul n’y pourra plus rien : l’homme aura pris la place de Dieu. Aux dernières nouvelles, et malgré les brillants résultats de son usurpation, il ne l’a toujours pas rendue.
Pour aller plus loin :
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- Vladimir Ghika : le contexte politique avant la guerre de 1914-1918
- La France et le cœur de Jésus et Marie
- LA « MODERNITÉ » : UN CENTENAIRE OUBLIÉ
- Liste des ouvriers pastoraux, Evêques, Prêtres, Religieux, Religieuses et Laics tués en 2011 et 2010