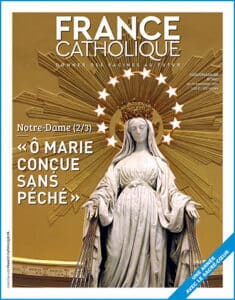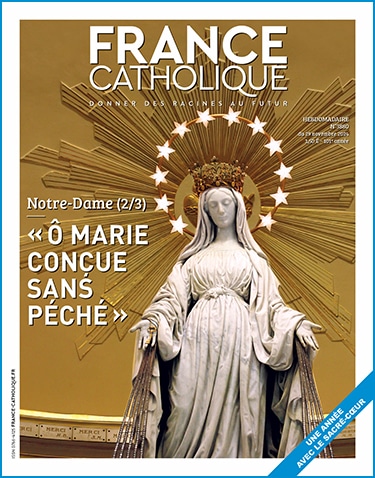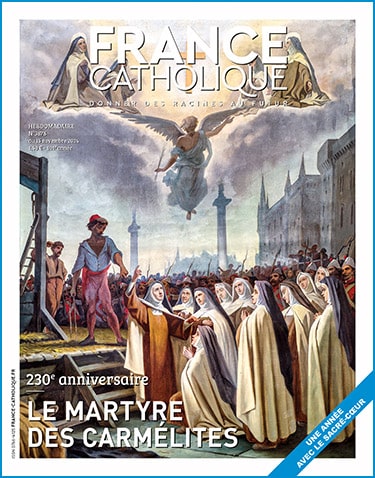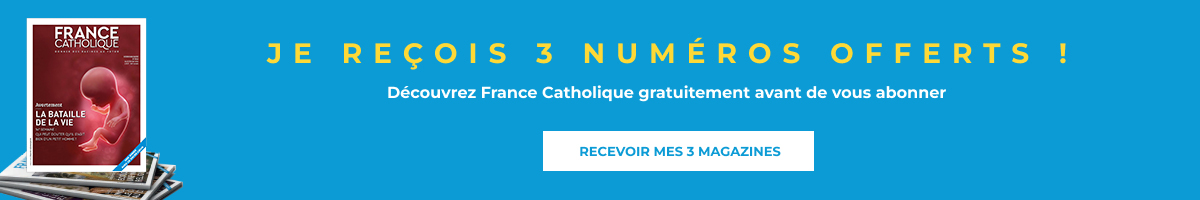La satire est un métier coûteux. Cela m’a été rappelé pendant « les vacances », alors que je me replongeai dans Wyndham Lewis, un auteur qu’on ne lit plus beaucoup.
En effet, les sujets de ses livres sont considérés comme « obsolètes ». Même dans ses romans, il recrée des personnages et des situations d’une autre époque (un longue période, qui recouvre la première moitié du siècle dernier).
Tous les livres font cela, y compris ceux de Platon et de Shakespeare ; tous les livres sont obsolètes, ce qui explique peut-être pourquoi peu en lisent encore. La littérature est généralement en retard. Il y a des livres pour aujourd’hui, mais il serait trompeur de les appeler « littérature ».
Pourtant, Lewis sera mon exemple. Il était toujours publié, il y a une quarantaine d’années, un quart de siècle après sa mort. Ce n’était pas parce qu’il était alors accepté comme Immortel, mais parce que les petits éditeurs en Angleterre trouvaient encore un petit marché pour ce qui était bien écrit dans les années 1920 et 1930, mais non publiable à l’époque.
C’était parce qu’il était considéré comme calomnieux. Il se moquait de personnes importantes et célèbres, et pire encore, touchait à l’industrie du livre elle-même. Qu’il l’exposât comme une « industrie » fut sa première erreur.
Comment se font les réputations ? Comment les livres sont vendus, grâce à l’emphase des critiques ? Comment le goût du public est toujours décontracté, et le monde protégé pour les « best-sellers » ? Qui sont les pivots de l’art littéraire et comment peuvent-ils s’offrir des yachts à vapeur ?
À quelques exceptions intentionnelles près, qui n’auraient pas été gênés de poursuivre, les livres n’étaient pas vraiment calomnieux. Là où il y avait des personnes réelles parmi les personnages, elles étaient combinées et recombinées. Ils étaient vraiment imaginaires.
Mais « les petites gens » pouvaient penser, précisément parce qu’il le faisait si bien, qu’ils avaient été personnellement diffamés, alors qu’en réalité ils n’étaient que des « types », dépeints avec précision. Ils devineraient que l’auteur ou son éditeur avait de l’argent, et ils iraient voir un avocat.
Et puis les accusés devraient engager un avocat, de sorte que même si l’auteur et l’éditeur gagnaient, il pourrait y avoir d’affreuses dépenses.
Je remarque dans les Évangiles que le Christ lui-même met en garde contre les poursuites judiciaires (Matthieu 5:25, etc.), et cela est anticipé dans les Proverbes. « Mets-toi rapidement d’accord avec ton adversaire. »
C’est un bon conseil pratique. Les libraires le suivent en réglant la plupart des poursuites à l’amiable. Les avocats eux-mêmes indiquent que, comme dans d’autres formes de capitalisme, l’accusé paiera sur l’heure pour éviter les poursuites judiciaires – même lorsqu’il sait qu’il a raison.
Mais je doute qu’une religion qui a produit tant de martyrs soit tout à fait pacifique. Sur certaines questions, nous prenons position.
Notez cependant que cette position n’est pas personnelle. Le pied fléchit quand on nous demande de renier le Christ ou de retirer notre affirmation de Lui. À ce stade, nous sommes au-delà de la simple compétition avec un adversaire avide et hargneux dans un procès d’argent. Le diable doit payer, pourrait-on dire ; ou, nous devons payer le diable de nos vies. Et notre avocat nous dit de payer joyeusement.
Cet aparté a été inséré pour indiquer clairement que Wyndham Lewis n’était pas un martyr. Il n’était que la victime d’une injustice conventionnelle, maintenant enterré décemment dans le passé qui s’éloigne.
Il a payé en restant pauvre. Alors que d’autres de sa stature (son génie et son originalité, à la fois dans les lettres et dans la peinture) l’emportaient enfin, et que certains mouraient riches au-delà des rêves d’avare, Lewis et sa femme vivaient au jour le jour, puis retombaient, au fil des décennies.
Sa répugnance à prendre conseil était, comme pour d’autres satiristes, le secret de sa pauvreté. Comparez, par exemple, son fidèle ami T. S. Eliot qui, à ma connaissance, n’a jamais affronté un adversaire qui pourrait le blesser gravement et a soigneusement évité les plaisanteries satiriques.
Comparez, encore une fois, Ezra Pound, dont le génie l’a amené à l’hôpital (psychiatrique) de Sainte Elizabeth, au lieu de se faire pendre comme traître. (Ne choisissez jamais le côté perdant dans une grande guerre.)
Alors que Wyndham Lewis choisissait le côté perdant dans de petites guerres, avec très peu de couverture médiatique. Et parce qu’il était pauvre, même s’il était plutôt célèbre, il était facilement abattu. Des livres comme Unlucky for Pringle, The Roaring Queen, Mrs Duke’s Millions – qui sont hystériquement drôles, entre autres mérites – pouvaient être discrètement supprimés simplement parce qu’ils interféraient avec la vanité de personnes maintenant totalement oubliées.
Paradoxalement, on pourrait se souvenir de leurs noms si, comme les ennemis d’Alexandre Pope, ses livres avaient vu le jour. On pense, par exemple, à Arnold Bennett, dont les propres œuvres autrefois à succès, n’ont pas conservé longtemps un quelconque intérêt.
Mais alors quoi ? D’après ce que je peux comprendre, Wyndham Lewis n’a jamais fait un gros problème des livres non publiés. Il a pris ses bosses et est parti. Par une sorte de miracle, lui et sa femme sans enfant Froanna ont continué à manger, la plupart du temps, et ses dettes ont été payées pour l’essentiel. Parmi ses amis, il y en avait de vrais, et bien que ses misères fussent également réelles, il mourut en leur ayant survécu.
Il est mort en 1957 : vieux, faible, aveugle, et écrivant assidûment ce qui a pu être le meilleur de sa série Human Age (« L’Âge des hommes »), qui avait commencé avec The Childermass dans les années 1920, mais se termine par des fragments brillants ; parmi des images de création et de crucifixion.
À la fois artiste et écrivain – de romans, d’histoires et de mémoires, ainsi que d’essais grossièrement choquants – il a laissé ce qui semble maintenant être une tournée encyclopédique du « modernisme » et de toute sa folie, avec des allusions à la sagesse dans son envers.
Curieusement, il est catalogué comme le moderniste qu’il a rejeté ; c’est pourquoi la chaleur de sa rébellion est trop souvent manquée. (Il est pris pour mécanique alors qu’il est anti-mécanique.)
Je le célèbre en tant que patron à demi-saint des politiquement incorrects ; pas un prophète ni le fils d’un prophète, pour ainsi dire, mais l’un des irritants nécessaires qui ont marqué notre parcours, et ont même rendu le « courant dominant », contre lequel il a « fustigé et bombardé », en quelque sorte supportable.