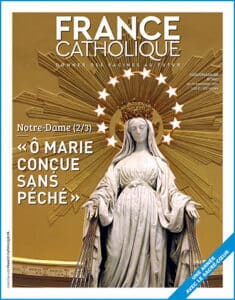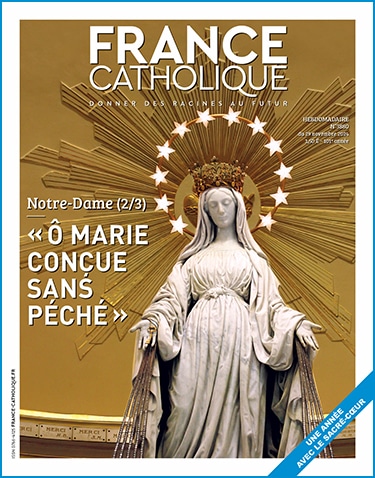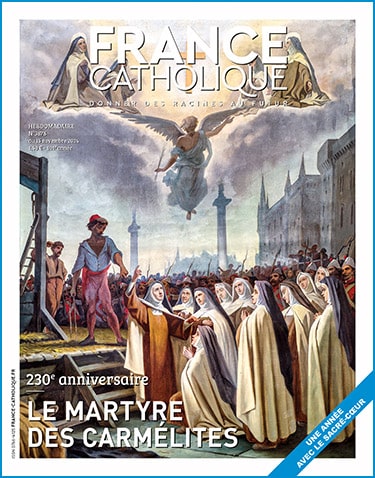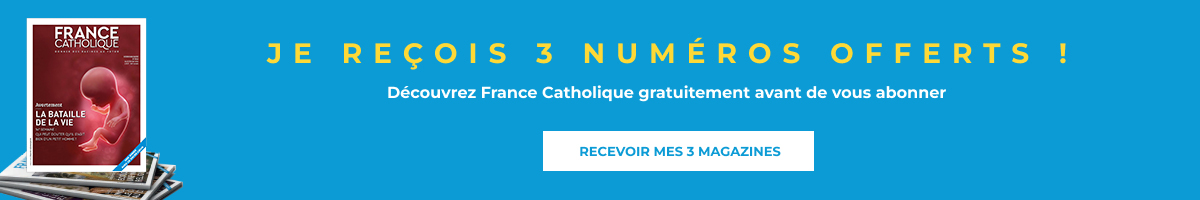L’Église est parfois mieux préparée à s’occuper des pécheurs qu’à aider ceux qui sont blessés par le péché.
Si vous consacrez suffisamment de temps à l’étude de la crise des abus dans l’Église catholique – c’est-à-dire si vous lisez assez de vieux reportages ou écoutez des témoignages de survivants – certains schémas se dégagent. Certains d’entre eux sont déroutants, d’autres tout simplement exaspérants : un manque de prise au sérieux des allégations ; une tendance à sous-estimer le traumatisme causé aux enfants par les abus sexuels; un instinct puissant pour protéger la réputation et les biens de l’institution, même au prix de nuisances aux victimes et de mise en danger d’autres personnes ; une volonté de faire confiance aux experts qui ont donné de mauvais conseils, en particulier sur le retour en sécurité des délinquants « réhabilités » au ministère.
Comme de nombreux survivants d’abus ne le savent que trop bien, l’Église a souvent fait preuve de plus de sollicitude pour les prêtres accusés – même les agresseurs avérés – que pour leurs victimes. Pendant des décennies, un prêtre agresseur (à condition qu’il ne soit pas réduit à l’état laïc ou en prison) pouvait s’attendre à ce que son diocèse ou son ordre religieux l’envoie suivre une thérapie, recevoir des conseils et – selon le type d’infraction qu’il avait commise – être réhabilité. En bref, le coupable pouvait être retiré de son ministère ou voir son ministère restreint, mais ses besoins physiques, mentaux et spirituels étaient satisfaits de toutes les manières possibles. Son accusateur, en revanche, devait aller voir un avocat.
Il convient cependant de noter que cela a changé depuis longtemps. Depuis 2002, les diocèses offrent des services de conseil beaucoup plus efficaces aux personnes qui ont porté plainte pour abus. La Charte de Dallas stipule clairement que « la première obligation de l’Église à l’égard des victimes est la guérison et la réconciliation ». Chaque diocèse des États-Unis doit désigner un coordinateur de l’aide aux victimes afin de s’assurer que les survivants d’abus ne se perdent pas dans une machine bureaucratique qui se met en marche lorsqu’une allégation d’abus est faite.
L’Église apprend à traiter les survivants d’abus comme des personnes blessées, plutôt que comme de simples dettes. De nombreux diocèses s’orientent vers un modèle d’interaction moins conflictuel avec les personnes ayant subi des abus.
Au printemps dernier, le pape François a explicitement souligné la nécessité pour les autorités ecclésiastiques du monde entier de veiller à ce que les personnes qui ont subi des sévices soient « traitées avec dignité et respect » et qu’elles soient « accueillies, écoutées et soutenues, notamment par la fourniture de services spécifiques ; l’offre d’une assistance spirituelle ; l’offre d’une assistance médicale, y compris une assistance thérapeutique et psychologique, selon les besoins de chaque cas spécifique ».
On entend souvent parler de l’importance de « faire passer les victimes en premier » ou de s’assurer que l’Église est « à l’écoute des survivants ». Pour la plupart des catholiques, je pense que c’est évident. Si évident, en fait, que de tels truismes – à certains moments et venant de certaines personnes – peuvent ressembler à des tentatives de détourner l’attention d’autres questions urgentes ou embarrassantes. Il y a des moments où « il s’agit des victimes » apparaît comme l’équivalent ecclésiastique de « ne pas faire attention à l’homme derrière le rideau ».
Donner la priorité aux victimes d’abus peut être facile et évident dans l’abstrait, mais cela peut être assez difficile dans la réalité. Même si nous pouvions éliminer les derniers obstacles institutionnels qui entravent la relation de l’Église avec les survivants d’abus – cléricalisme persistant, inertie bureaucratique, autoprotection institutionnelle, etc. – de véritables obstacles subsisteraient.
D’une part, il est beaucoup plus facile pour l’Église de condescendre (dans le meilleur sens du terme) envers les pécheurs – même les abuseurs – que de rencontrer ceux qui ont souffert aux mains de l’Église. Ce n’est pas seulement une question de psychologie. L’Église a une grande expérience de la relation avec les pécheurs. Les Écritures sont pleines de paraboles et d’exemples donnés par le Christ lui-même : le Bon Pasteur, le fils prodigue, la femme au puits, la femme surprise en adultère, l’appel de Zachée, le commandement de pardonner soixante-dix fois sept fois.
Nous avons tout un sacrement consacré au pardon des péchés et à la réconciliation du pécheur avec le Christ et Son Corps. Mais dans chacun de ces cas, c’est l’Église qui pardonne, l’Église est le vecteur de la miséricorde, l’Église qui devient semblable au Christ. Jésus n’a jamais eu à demander pardon.
Et puis il y a le fait inéluctable qu’une personne qui a subi un traumatisme grave est, par le fait même de ce traumatisme, mise à part. Pensez au soldat qui rentre chez lui après les horreurs de la guerre, ou aux parents qui doivent reconstruire leur vie après avoir enterré un jeune enfant. Ceux d’entre nous qui n’ont pas vécu de telles épreuves poignantes ont souvent du mal à savoir comment interagir avec ceux qui en ont vécu.
Il ne sert à rien de prétendre que le traumatisme n’a jamais eu lieu, ni de prétendre que nous comprenons la profondeur de ce que les victimes ont vécu. Nous ne pouvons pas leur expliquer ce qui s’est passé ni pourquoi. Nous ne pouvons pas les réparer.
Pour beaucoup d’entre nous, le plus que nous savons offrir est un mot maladroit d’empathie – un mot qui, espérons-le, ne fait pas de mal – suivi du silence.
Le traumatisme peut ouvrir un gouffre social entre celui qui l’a vécu et ceux qui ne l’ont pas vécu. Il n’est pas facile de combler ce fossé, même pour ceux qui en ont la volonté et le désir. Dans le cas des survivants d’abus, le traumatisme peut créer un tabou. Je ne parle pas d’un tabou né de la répugnance, mais de révérence et de crainte qui isolent.
L’Église doit continuer à apprendre à écouter les survivants – être présente aux survivants, être patiente avec les survivants – et ce n’est pas facile, car même notre sollicitude pour eux peut être isolante.
Les blessures non méritées des innocents peuvent nous déconcerter. Elles sont une pierre d’achoppement, un signe de contradiction. En ce temps de Carême, alors que nous contemplons la Croix, il est bon de réfléchir à ce que le péché a fait au Corps du Christ. Regardez celui que nous avons transpercé. Pouvons-nous reconnaître le visage de notre Sauveur ? Pouvons-nous reconnaître sa face dans d’autres visages brisés ?
Ce n’est pas facile, mais nous devons essayer.
Pour aller plus loin :
- Discours final du Pape – Sommet sur la protection des mineurs
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- Les fausses allégations sont rares – et réelles
- Quand le virtuel se rebelle contre le réel, l’irrationnel détruit l’humanité
- Vladimir Ghika : le contexte politique avant la guerre de 1914-1918