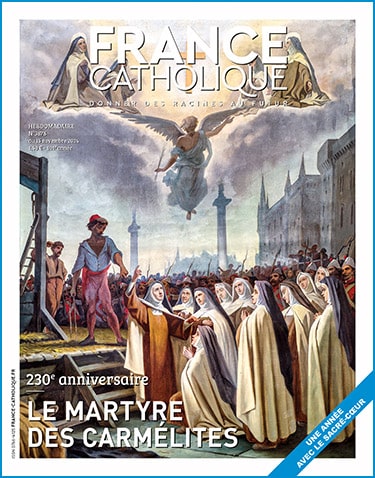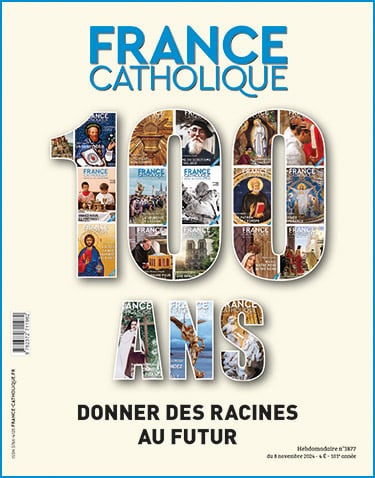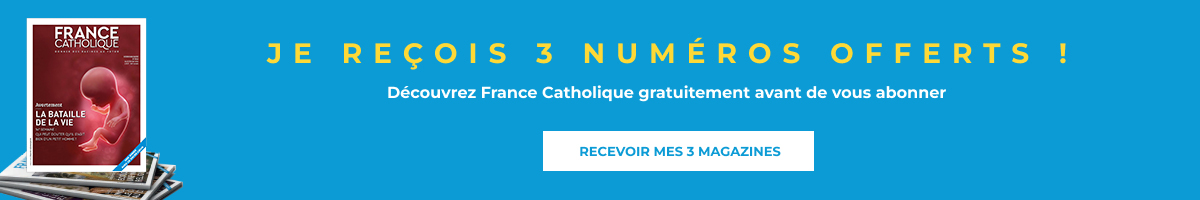Apprenant hier la mort du romancier américain Tom Wolfe, j’ai eu plus qu’un pincement de cœur. Sans vouloir anticiper sur le jugement de la postérité, j’ai le sentiment qu’il restera comme un des plus grands écrivains contemporains, non seulement parmi les Américains, mais aussi à l’échelle de la culture universelle. Il n’était d’ailleurs nullement étranger à notre pays, avouant une particulière dilection pour Émie Zola, dont il se voulait le continuateur en tant qu’observateur de la société de son temps. On pouvait aussi l’apparenter à notre Balzac défini comme « secrétaire de la société ». J’ajouterai qu’avant d’être romancier, Tom Wolfe avait été journaliste et qu’il l’était resté dans sa manière de préférer l’observation précise des mœurs aux grandes théories et aux considérations trop psychologiques.
Cela ne l’empêchait pas d’être un homme de grande culture, prêt à affronter parfois des questions aussi décisives que celles du langage et de l’évolution. J’avais énormément aimé son récent essai intitulé Le règne du langage où, avec une joyeuse alacrité, il démolissait certaines conceptions matérialistes. Non, l’évolution n’expliquait nullement l’apparition du langage humain. Darwin et tous ses continuateurs s’étaient fourvoyés à tenter de le prouver. Dans un entretien au Figaro avec Alexandre Devecchio il déclarait : « Il existe entre l’être humain et l’animal une différence essentielle, une ligne de démarcation aussi escarpée et inamovible qu’une faille géologique : la parole. » Et encore : « Seul le langage permet à l’homme de questionner son existence, de la poursuivre ou d’y renoncer. »
C’est donc que Tom Wolfe était capable d’entreprendre une enquête dans le domaine de l’histoire des idées et même des sciences. Il y révélait, une fois de plus, son absolu indépendance d’esprit. Peu aimable pour la gauche caviar et le politiquement correct, il était suspect de conservatisme. Mais dans son cas, il ne s’agissait nullement de mépris aristocratique pour les humbles. Ses romans prouvent le contraire. Que l’on relise, par exemple, Le bûcher des vanités, ou Moi, Charlotte Simmons et l’on verra comment il découvrait les détresses cachées, attentif à toutes les strates de la sociologie des États-Unis. Il n’était pas tendre pour la classe supérieure. Il ne faut pas avoir peur avec lui des longs romans. On y retrouve le bonheur des grands classiques.