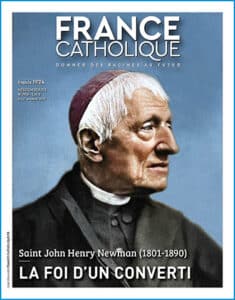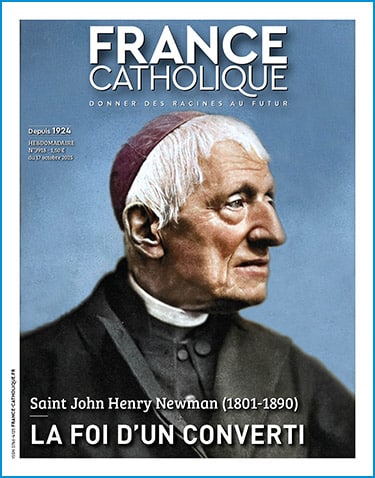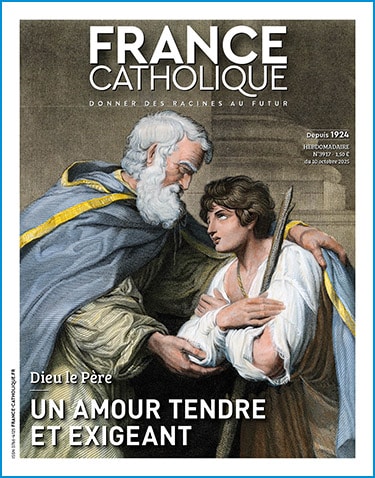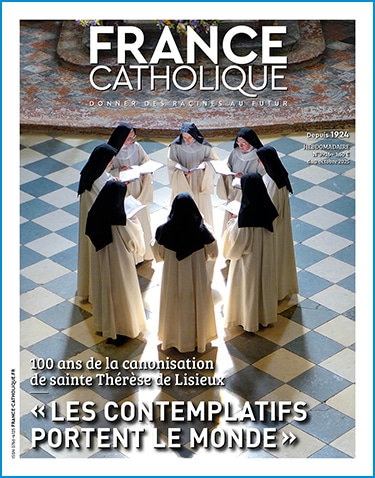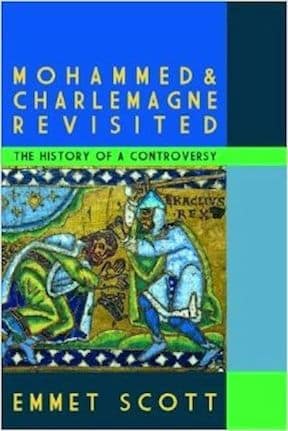Dans ses récits de voyage, V.S. Naipaul utilise à merveille des contacts personnels pour révéler les forces culturelles sous-jacentes qui ont une incidence sur des peuples entiers. Ce qui l’amène souvent à tordre le cou aux idées reçues touchant le multiculturalisme. L’ouvrage Crépuscule sur l’islam : voyage au pays des croyants, par exemple, sonde les profondeurs de la vie dans les terres d’islam, en dépassant les slogans et en plongeant le lecteur dans l’univers quotidien des populations.
Bien que la situation ait considérablement évolué depuis sa parution en 1981, il reste encore beaucoup à tirer de ses conversations dans quatre pays non-arabes : Iran, Pakistan, Malaisie et Indonésie. (Dans la suite publiée en 1998, Jusqu’au bout de la foi, il s’entretient de nouveau avec certains de ses interlocuteurs précédents).
Toujours prenant et incisif (mais pas toujours vertueux), son regard décapant coexiste avec des récits chaleureux de ses contacts personnels. En dépit de cette dernière qualité, l’attribution du Prix Nobel de littérature à ce diagnosticien impitoyable fut une surprise, étant donné que, plus encore que les mérites de sa prose cinglante, certains aspects peu flatteurs de sa vie auraient pu aisément faire dérailler le processus. Compte tenu de ces attaques contre lui, on peut supposer que ses écrits ont une certaine valeur. Ce qui est vrai.
Sous sa plume, les motivations et débats intérieurs de ses interlocuteurs, humbles ou privilégiés, se révèlent clairement, parce qu’il met habilement à jour leur dimension spirituelle. Bien que faisant profession d’athéisme, il comprend que la conscience de soi et le sens de la vie dérivent dans une large mesure de l’orientation religieuse.
L’aliénation de l’individu et le délitement du tissu social sont les thèmes qui dominent ses observations dans ces pays. Avec l’un de ses interlocuteurs, un Sumatranais haut placé ayant étudié aux Etats-Unis, Naipaul parle des magnifiques temples bouddhique et hindou de Borobudur et Prambanan – ces trésors de la culture javanaise. Manifestant un manque d’intérêt total, l’homme répond « qu’il revient à la communauté internationale de s’occuper de ces monuments ». Est-ce qu’un Romain parlerait ainsi du Colisée, un Grec du Parthénon, ou un Péruvien du Machu Picchu ?
L’interlocuteur explique ensuite à Naipaul que son rôle est « de préparer la prochaine génération de dirigeants de l’Indonésie ». Lesquels finiront par « remplacer tout cela », à savoir tout ce qui n’est pas suffisamment islamique. L’essentiel, c’est que les nouveaux dirigeants soient de vrais musulmans. Pour lui, écrit Naipaul, « l’Indonésie avait besoin d’un nettoyage ». Les particularités du pays étaient incompatibles avec sa foi.
Un autre personnage, de condition plus modeste, « vivait entouré des beaux mystères » dans lesquels baignait le riche passé préislamique de son pays, car c’était le seul mode de survie possible de celui-ci. « Des recherches sur son passé », explique Naipaul, « auraient sapé ce qui était devenu sa foi ».
Dans les écoles des villages – les pesantrens – Naipaul observe des garçons n’aspirant qu’à étudier des livres sur le droit islamique et la grammaire arabe. Au lieu d’inclure la tradition ou de fournir une éducation solide, ce curriculum se ramenait à « une rupture avec le passé indonésien ; c’était de l’islamisation ; c’était un abrutissement, plus intense que celui qu’aurait pu entraîner un curriculum de style occidental ». Je me demande si Naipaul pourrait se permettre aujourd’hui ce type d’observation, étant donné qu’un homme politique britannique a été récemment arrêté pour avoir fait une citation de Churchill dans la même veine.
Pour un autre contact encore – un Malaisien – l’apprentissage, la lecture et l’histoire sont des disciplines superflues. Le progrès selon lui se ramène purement et simplement à une orientation religieuse appropriée. Si ses compatriotes malais se concentraient comme lui sur les bons concepts, tout serait pour le mieux. Naipaul fait remarquer que cette attitude revient à instrumentaliser la religion pour détourner l’attention d’autres importants aspects de la vie : une immersion de ce genre, à l’exclusion de tout le reste, n’est-elle pas simplement « une échappatoire facile ? »
A son avis, l’arrivée de l’islam a entraîné un désengagement destructeur, même s’il a aussi servi à évacuer la rage qu’il « sanctifiait ». L’islam de la fin du XXe siècle, affirme Naipaul, « se ressentait de la tare de ses origines – la tare qui s’observe dans toute l’histoire de l’islam : il n’offrait aucune solution politique ou pratique aux questions politiques qu’il soulevait… uniquement le Prophète qui réglerait tout, mais qui avait cessé d’exister… cet islam politique n’était que rage et anarchie. »
Aux autochtones qui avaient perdu leur traditionnel mode de vie il peut avoir fourni quelques repères ou un but dans la vie – en remplacement de formes antérieures d’organisation sociale et religieuse – mais il les a aussi coupés de leurs racines et privés de tout intérêt pour l’ensemble du domaine du développement humain.
L’acculturation est un vaste sujet à lui seul. Qu’il suffise de dire que le christianisme et l’islam ont des approches radicalement différentes sur la question. Il est difficile de ne pas remarquer que l’arrivée du christianisme chez, disons, les populations autochtones des Amériques est en général décrite comme un phénomène négatif et impérialiste, tandis que l’islam tel que Naipaul le présente, comme « le purificateur des Malais », ne suscite pas l’ire des multiculturalistes.
En lisant les pages de Naipaul sur le délitement du tissu social et l’aliénation des individus, on est tenté d’établir un parallèle avec les « générations perdues » de l’Occident socialiste. Elles aussi sont écrasées par un taux de chômage élevé et affligées par leur propre désertification spirituelle. Les textes de Naipaul décrivent également des microcosmes individualisés qui correspondent à ce que Robert Reilley a présenté au niveau macrocosmique : l’islam a démesurément investi dans un concept de Dieu dont les attributs prédominants sont l’omnipotence et l’obstination – en ne laissant de ce fait qu’un rôle marginal à la raison.
Même une obstination capricieuse, permettant l’absence de logique, la violence et la tromperie, peut être compatible avec les desseins insondables de Dieu. Par suite du rejet catégorique de toute influence hellénisante, le développement de la science et de l’éthique a également fléchi. D’où le résultat : une capacité réduite de s’attaquer au monde environnant avec cohérence et énergie.
L’historien belge Henri Pirenne a posé une question connexe : quel phénomène a entraîné la survenue de l’« âge sombre » ? Dans son ouvrage posthume 1 (1939), il conteste l’explication habituelle de la chute de la civilisation classique : la dissolution effective de l’Empire romain d’Occident en 476 après des siècles de décadence a ouvert la voie à une barbarie qui a inexorablement conduit à la période de l’âge sombre qui a sévi à partir du VIIe siècle jusqu’au Xe.
Pirenne fait observer que les barbares au pouvoir ne détruisirent pas les infrastructures romaines et que le mode de vie dans son ensemble continua à prévaloir presque comme avant sa chute, parce que les « barbares » avaient adopté la culture romaine. Ils ne tentèrent pas d’imposer leurs propres langages, lois ou coutumes à Rome.
Selon cet historien, on ne saurait nier que, par sa nature et son orientation, la source de la vitalité de l’Empire romain fut essentiellement méditerranéenne et que cette source demeura intacte pendant une assez longue période. Le commerce occidental resta florissant et relié aux grandes villes de l’Orient où étaient concentrées la prospérité, la population et la science. Les caractéristiques de la vie dans l’ensemble de la région en 600 étaient semblables à celles qui prévalaient en 400.
Ce n’est pas avant l’arrivée de l’islam au VIIe siècle, à ce moment précis, que la destruction se produisit vraiment. Des incursions islamiques récurrentes modifièrent l’orientation même des peuples du littoral ; ils abandonnèrent la Méditerranée et se tournèrent pour la première fois vers le Nord. L’Orient fut coupé de l’Occident, et la Méditerranée jusque-là unifiée, « étant devenue un lac musulman, ne fut plus la grande voie de circulation des marchandises et des idées qu’elle avait toujours été ».
A la différence des envahisseurs germaniques, les Arabes soumettaient tout sur leur passage. C’était une dimension de leurs convictions religieuses. Ils ne recherchaient pas la conversion en tant que telle, mais exigeaient la sujétion, créant une barrière insurmontable entre les peuples conquis et les musulmans : « Quel contraste entre eux [les Arabes] et Théodoric [le Grand] qui se plaçait au service de ceux qu’il avait conquis et s’efforçait de s’assimiler à eux ! » La région tout entière fut ainsi transformée, les Arabes inaugurant « une rupture complète avec le passé ».
Les papyri égyptiens qui avaient été largement diffusés en Occident (et un indicateur fiable du taux d’alphabétisme) disparurent, ainsi que les pièces de monnaie en usage jusqu’à la conquête arabe, ce qui entraîna le recours à un système de troc. Mais en dépit des sources littéraires et archéologiques, les arguments de Pirenne furent écartés au profit de l’idée que l’islam avait été une force de progrès (à la différence du christianisme qualifié de « répressif »).
Dans son ouvrage Mohammed and Charlemagne Revisited (2012), Emmet Scott a repris la thèse de Pirenne. Bien qu’il s’intéresse surtout à la controverse, il n’hésite pas à rendre le verdict suivant : « les recherches sont désormais parvenues à plusieurs conclusions qui sont vraiment incontestables et qui tendent à fournir un appui décisif aux thèses de Pirenne. »
A la fin du VIe siècle et au début du VIIe, la civilisation classique était intacte et prospère, voire en expansion. En fait, certaines régions étaient « plus que jamais florissantes » ; l’Espagne en particulier (ainsi que la Gaule) bénéficiait d’un regain tardif de culture classique.
Scott attire l’attention sur les centaines de monuments connus de l’époque des Wisigoths, soulignant même qu’au début du VIIe siècle les architectes utilisaient à nouveau des pierres méticuleusement taillées ; ces monuments, fait observer Scott, étaient « largement supérieurs, sur les plans technique et artistique, à leurs successeurs romans du Xe siècle ». En fait, le riche patrimoine architectural wisigothique est en contradiction manifeste avec « l’absence virtuellement complète de tout vestige archéologique datant des deux premiers siècles de l’époque islamique ». Ce n’est qu’au milieu du Xe siècle que réapparaissent des ouvrages d’art.
Les grandes villes d’Orient – en Syrie et en Asie Mineure – furent victimes de violentes destructions de la part des Arabes au début du VIIe siècle. Des destructions durant une guerre, pourrait-on rétorquer, sont monnaie courante ; mais ces villes ne furent jamais reconstruites. En fait, dans tout le bassin méditerranéen ainsi que dans les régions du Moyen-Orient (échappant à l’influence romaine) d’importants vestiges archéologiques semblent avoir entièrement disparu pendant les trois siècles suivants.
La construction – sans parler de la préservation – n’était pas un concept de l’islam. A propos de l’Egypte, Scott écrit que le changement imposé à ce pays au début du VIIe siècle « ne peut être qualifié que de catastrophique »
Les pays islamisés, comme Naipaul le raconte avec des détails tirés de ses entretiens, ont tous peu ou prou connu ce que l’Egypte a subi si intensément : la perte de sa propre histoire. En outre, une autre caractéristique révélatrice fait désormais partie des données archéologiques : une couche sédimentaire présente dans tout le pourtour méditerranéen et connue sous le nom de «Younger Fill » [strate récente]. Cette strate du sous-sol qui n’est pas limitée à la Méditerranée mais se rencontre dans toutes les zones littorales occupées par les musulmans constitue la « signature géographique de la fin de la civilisation gréco-romaine ».
Ce sous-sol s’est déposé entre le milieu du VIIe siècle et le milieu du Xe, période qui coïncide précisément avec cet assourdissant silence archéologique. Ce phénomène s’explique par l’abandon total des systèmes d’irrigation et agricoles par les populations des établissements côtiers qui se réfugièrent dans des zones fortifiées en hauteur pour échapper aux razzias incessantes des musulmans.
Scott reconnaît que l’hypothèse globale de Pirenne demeure contestée.
Le lecteur n’en comprend pas moins que cette thèse était déjà controversée à l’époque de Pirenne pour la même raison qu’aujourd’hui : les adeptes du multiculturalisme de nos jours ne sont pas les premiers à être motivés par la haine de la civilisation européenne. On en est donc réduit à se poser la question (impossible à éviter) : dans quelle mesure les idées reçues sur l’Âge sombre ne serait-elles pas un produit dérivé d’une tendance générale à présenter le catholicisme comme une force rétrograde.
A propos, dans les pays européens, seuls les Anglais utilisent l’expression « Dark Ages » [Âge sombre]1; Henry VIII et ses successeurs avaient des raisons de peindre sous un jour sombre tout ce qui était catholique. Peindre l’histoire de l’islam en termes chaleureux a été un autre moyen de dénigrer la civilisation européenne et en fin de compte la chrétienté.
Par une sorte de curieux paradoxe, des érudits de la Chine communiste ont découvert la vérité. Comme Rodney Stark le raconte dans Le Triomphe de la raison. Pourquoi la réussite du modèle occidental est le fruit du christianisme (2007), des érudits chinois ont entrepris une étude approfondie de ce qui a, en dernière analyse, assuré la prééminence de l’Occident. Après des décennies de recherches, ils en ont conclu que ce n’étaient ni les armements, ni la politique, ni l’économie, facteurs qui selon eux auraient pu être décisifs, mais une cause plus profonde :
Nous avons compris que le cœur de votre culture est votre religion : le christianisme. C’est pourquoi l’Occident est si puissant. Ce sont les fondements chrétiens de la vie sociale et culturelle qui ont permis l’émergence du capitalisme et ensuite l’évolution réussie vers une politique démocratique. Nous n’avons aucun doute à ce sujet.
C’est la traversée des apparences – comme l’ont découvert ces érudits chinois – donne les meilleurs résultats. Nombre de personnes aujourd’hui disent que ce dont l’islam a le plus grand besoin, c’est d’une « réforme ». Mais les mieux informés considèrent ce jugement comme un vœu pieux, étant donné les horreurs qui font les gros titres de nos jours. Le dominicain du XIIIe siècle Maître Eckhart nous a laissé par mégarde un sage précepte : « si Dieu était capable de se détourner de la vérité, je choisirais la vérité plutôt que Dieu ».
Cette affirmation peut sembler un peu subtile ou irrespectueuse. Mais étant donné que la vérité est l’un des nombreux noms de Dieu – tout au moins selon le christianisme – Eckhart ne plaçait rien au-dessus de Dieu. Il soulignait qu’il ne peut y avoir de conflit entre Dieu et la Vérité. Il est étrange que la destinée de peuples entiers – leur prospérité ou leur naufrage – dépende de leur perception de ces principes essentiels.
— –
Source : http://www.thecatholicthing.org/columns/2014/how-islam-set-back-western-civilization.html
— –
Matthew Hanley est chargé de recherche au National Catholic Bioethics Center (NCBC). Il est le coauteur (avec le docteur Jokin de Irala) de l’ouvrage Affirming Love, Avoiding AIDS : What Africa Can Teach the West, qui a récemment reçu un prix du meilleur livre de la Catholic Press Association.
Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de Mr Hanley et n’engagent en rien le NCBC.