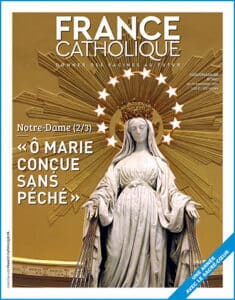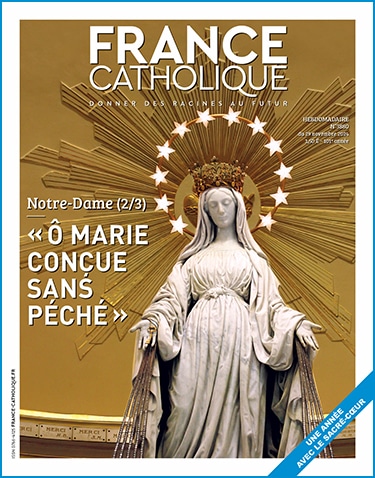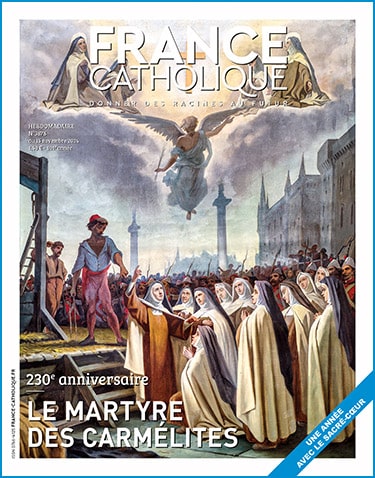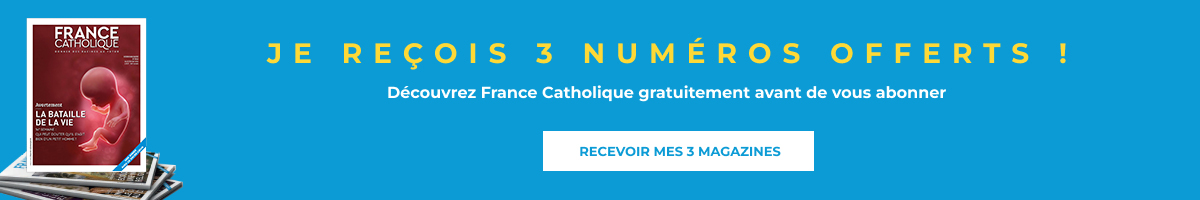Mort de Jean Madiran. Il était né en 1920, l’année de Jean-Paul II. C’est dire son parcours, tout au long du siècle dernier jusqu’à nos jours. Les premières réactions que je saisis sur mon smartphone, depuis ma campagne profonde, vont de la franche hostilité à la gratitude de ceux qui l’ont toujours reconnu pour maître. L’article du Monde se rapporte au vichysme et à l’antisémitisme, ce qui vaut condamnation et exécution immédiate. Que répondre à cette roide justice ? J’aurais du mal à me faire l’avocat d’une cause que je ne puis partager et à laquelle je me suis parfois confronté, lorsque les propos du directeur de Présent me heurtaient profondément. Je ne puis cacher la part de désaccord déterminant qui m’opposait à un homme, que, par ailleurs, je ne pouvais exclure purement et simplement, parce qu’il n’était pas médiocre et parce qu’il représentait tout un secteur de tradition non négligeable.
Ce qui me gène profondément dans certains des textes publiés à l’occasion de sa mort, c’est l’absence d’équité à son propos, cette équité sans laquelle on ne peut parler en vérité, surtout des sujets les plus délicats. Par chance, et même par grâce, j’ai enfin trouvé cette équité dans un article remarquable en tous points, signé Jean-Yves Camus, sous le titre : « Jean Madiran, penseur du catholicisme traditionaliste ».
Première marque de l’équité : l’exactitude scrupuleuse de l’information. Rien n’est affirmé qui n’ait été minutieusement vérifié. Pas question, par exemple, d’un imaginaire secrétariat de Charles Maurras qui aurait supposé au minimum la présence de Madiran à Lyon sous l’occupation, ce qui n’était pas manifestement le cas. De même, l’identifier comme le dernier journaliste de l’Action Française ayant survécu à tous, c’est oublier Michel Déon, toujours bien vivant et qui fut, lui, très réellement, le dernier secrétaire de l’écrivain monarchiste. Jean-Yves Camus s’abstient non seulement d’énoncer de telles sottises, mais rappelle les vraies responsabilités de Jean Arfel (son nom de naissance) durant la période de la guerre : « Dès août 1941, il devient une des plumes qui défendait la Révolution nationale comme une réforme intellectuelle et morale du pays, d’abord dans la revue France, puis de juin 1943 à juin 1944, en tant que fondateur et directeur des Nouveaux cahiers de France, publiés en zone libre. »
Mais le plus important, c’est la mise au point fondamentale sur l’antisémitisme de Madiran, qui à l’instar de celui de Maurras, ne s’est jamais voulu fondé sur un préjugé racial ou un antisémitisme dit de peau, mais se fondait sur la théorie des « quatre États confédérés ». On dirait peut-être aujourd’hui fondée à partir d’intérêts communautaristes. C’est parce qu’il ne voulait pas cohabiter avec Rebatet, antisémite de peau proclamé, qu’il quitta l’hebdomadaire Rivarol. Là où le témoignage de Jean-Yves Camus devient particulièrement précieux, c’est lorsqu’il rappelle ses conversations avec l’intéressé : « J’ai conservé le souvenir d’un homme qui trouvait un intérêt à parler de la France et du patriotisme avec un juif qui s’affirmait comme tel tout en n’étant pas de sa paroisse. » C’est ici que nous retrouvons dans son acuité la question de l’anti-judaïsme au-delà de l’antisémitisme politique : « Jean Madiran n’était pas négationniste. Il adhérait simplement à la théologie préconciliaire sur la question des juifs. Il avait toutefois raconté, dans un opuscule intitulé L’adieu à Israël, la période durant laquelle il crut que cet État représentait un modèle de réenracinement et de renaissance identitaire. » Mais voilà, subsistait chez lui le préjugé d’un groupe de pression hostile aux intérêts français, ce dont il était difficile de le dissuader.
Ce n’est qu’à partir d’une telle mise au point qu’une confrontation, fut-elle posthume, est possible. Je laisserai ici le dossier douloureux de la guerre qui nous entraînerait trop loin dans les élucidations historiques pour m’en tenir aux débats qui ont dominé la période plus contemporaine, celle qui trouve dans Vatican II son point de référence capital et où Jean Madiran a incontestablement joué un rôle de vigie du catholicisme traditionaliste dans sa désinence la plus intransigeante (au sens d’Émile Poulat). Le sujet est à lui seul considérable et je ne puis qu’esquisser quelques remarques.
La première concerne le refus obstiné de l’enseignement conciliaire de Nostra Ætate sur le judaïsme. C’est là où le directeur d’Itinéraires s’est montré le plus conditionné par l’héritage du milieu politico-religieux qui l’avait formé. Bien sûr, cet héritage s’enracinait bien en deçà de la période des XIXe et XXe siècle, au Moyen Age et jusqu’aux origine patristiques. Mais à l’âge moderne, il avait constitué un ethos, une manière de vivre et de se comporter dont certains ont eu le plus grand mal à se débarrasser. Pourtant, la tragédie de la Shoah avait une puissance cathartique propre à remettre radicalement en cause les préjugés les plus tenaces. Pour ma génération en tout cas ce fut déterminant. Il nous était impossible d’endosser une tradition dont l’aboutissement avait été aussi effroyable, quelles que soient les nuances à apporter. Un Maritain avait précédé cette réaction dès les années 30 et toute une élaboration doctrinale avait préparé l’élucidation conciliaire, qui fut véritablement libératrice. Elle n’avait pas échappé elle-même à bien des obstacles, eu égard au conflit israelo-palestinien, très sensible aux chrétiens du Proche-Orient. Je n’ai pas en mémoire, de façon précise, les arguments que Madiran a pu opposer à Nostra Ætate pour autant qu’il ait opéré une analyse directe de la déclaration de Vatican II. Pour l’essentiel, celle-ci reprenait l’enseignement de saint Paul aux Romains, qui, en la matière, constitue la référence scripturaire la plus décisive. Sans doute, craignait-il une excessive ouverture dans la même logique qu’un œcuménisme débridé ou un relativisme généralisé en climat de dialogue inter-religieux. Le résultat fut quand même ce blocage fâcheux, avec toutes ses ambiguïtés, que tous ne pouvaient percevoir avec la généreuse compréhension de Jean-Yves Camus.
Je ne vais pas reprendre ici tout le contentieux traditionaliste à l’égard de l’enseignement de Vatican II. Je l’ai analysé à maintes reprises (et encore dans mon livre Lefebvristes le retour). A posteriori c’est la réception du concile que je mettrais en cause, à la suite de Benoît XVI et de toute la génération de théologiens qui n’a pas admis ce qui s’était déroulé dans les années soixante, soixante-dix. J’entends encore Balthasar à Bâle incriminer la dérive théologique de l’après-concile ! On comprend tout à fait qu’une contestation se soit dressée contre ce que beaucoup considéraient à juste titre comme un naufrage de la foi, par ailleurs évident dans l’effondrement de pans entiers de l’édifice ecclésial. Jean-Yves Camus rappelle opportunément le mot d’ordre que Madiran lança en 1972 : « Rendez-nous l’Écriture, le catéchisme et la messe. » Certes, il y aurait beaucoup à dire à propos de ce triptyque, la seule question de la Liturgie ouvrant à des perspectives si vastes. Mais il ne fait pas de doute que la rédaction du catéchisme de l’Église catholique, qui répondait au vœu explicite de l’épiscopat mondial, correspondait à l’immense dépression doctrinale de l’époque. Le plan même du catéchisme était conforme à ce qu’énonçait précisément Madiran : le pater, le credo, les commandements…
Jean-Yves Camus rappelle encore : « Par obéissance, esprit de discipline autant que conviction tactique il préférait agir au sein de l’Église, avec les prêtres de la fraternité saint Pierre, tout comme ceux dont il se sentait le plus proche : le centre Charlier et Chrétienté-Solidarité de son ami Bernard Antony ; le monastère du Barroux et Dom Gérard Calvet. » Et encore : « Jean Madiran s’était en partie retrouvé dans les orientations des papes Jean-Paul II et Benoît XVI puis dans les premières orientations du pontificat de François. Il y retrouvait les références à la doctrine sociale de l’Église, le refus du relativisme, la volonté d’affirmation politique des catholiques et l’avancée consentie par le Motu proprio Summorum pontificum du 7 juillet 2007, qui validait l’usage du missel antérieur à 1970. » Oui, il est vrai que, comme Louis Veuillot, l’ancien directeur d’Itinéraires était un ultramontain et que les sacres épiscopaux illégitimes de Mgr Lefebvre constituaient l’épreuve limite à laquelle il ne pouvait se résoudre, à l’instar de Dom Gérard Calvet.
Mais il faut un événement comme celui de la disparition d’un personnage aussi symbolique pour mesurer la difficulté presque décourageante des conflits qui s’enracinent si profond dans les méandres de l’histoire, les guerres civiles, les incompréhensions intellectuelles et même les rancunes quasi tribales… Mais c’est le lot de notre condition, et à reprendre le fil de la seule histoire du christianisme, on retrouverait à chaque époque les mêmes défis de l’incompréhension, de l’hostilité, de la rupture apparemment sans remède. Cela commence dès les origines et se perpétue à chaque époque. Pour les chrétiens, il y a un point de repère qui permet de surmonter les vertiges de la division, c’est la référence à la Tradition, ce grand fleuve qui traverse les siècles et ne cesse de rendre vivantes et actuelles les coordonnées de la foi. C’est ce que Benoît XVI a rappelé avec force dans sa fameuse allocution sur la réception du Concile dans la continuité et non dans la rupture.
Jean Madiran ne pouvait que se retrouver dans cette perspective, bien que sa conception de la Tradition correspondit à sa sensibilité particulière. Je n’ai pas le sentiment qu’il ait eu beaucoup d’affinités avec la pensée du cardinal John Newman, dont Jean Guitton a établi que l’inspiration était au cœur de Vatican II. Ayant profondément intégré une part de l’héritage, il ne se reconnaissait pas avec la même intensité dans d’autres domaines que le ressourcement de la théologie contemporaine avait remis en valeur. On peut s’en désoler. Ne convient-il pas plutôt d’essayer d’en tirer le meilleur ? Il est heureux que dans la période la plus récente, toute une sensibilité ait été mieux reconnue, qu’elle ait mieux trouvé graduellement sa place dans la communion ecclésiale. Ce peut être d’ailleurs la condition d’un autre climat propice aux échanges qui, progressivement, nous éloigneraient des incompréhensions mutuelles et des excommunications définitives.
On peut garder cette dernière image célébrée dans la chapelle des armées à Versailles par le jeune père-abbé du Barroux, l’héritier direct de Dom Gérard Calvet, son ami de toujours. J’imagine la très belle orchestration grégorienne, avec l’intensité des chants (Subvenite, Dies Irae, In Paradisum) à laquelle la nouvelle liturgie n’a pas réussi à trouver d’équivalent pour ne pas dire plus… Qui n’est pas rentré dans ce modèle que j’identifierais volontiers au rameau bénédictin, est dans l’incapacité de comprendre les raisons et le fond culturel, spirituel, qui ont irréductiblement attaché un Madiran et les siens à tout un trésor qu’ils estiment être en péril et qui était, de surcroit pour eux, solidaire de l’orthodoxie théologique et de l’identité même du christianisme.
On peut évidemment se sentir en sympathie ou en empathie avec cette famille, tout en exprimant des réserves critiques, notamment lorsque les choix politiques semblent trop mêlés à un ethos global. Encore faudrait-il pouvoir opérer les discernements nécessaires en se gardant des polémiques empoisonnées. C’est ouvrir un registre immense qui requiert toute une culture, en sachant qu’on ne dénouera jamais complètement les nœuds des contradictions. Louis Veuillot n’a jamais été conciliable avec les catholiques libéraux ! Encore y aurait-il lieu de ne pas trop se fixer sur nos rétroviseurs. D’autres tâches nous requièrent, qui pourraient bien redessiner les configurations et les problématiques intellectuelles, loin de celles des dernières décennies.
Sur le terrain proprement théologique, il faudra bien avancer, après que les obstacles les plus lourds aient été levés. Jean Madiran a-t-il eu le temps de lire la dernière encyclique papale. (Lumen Fidei) dont la rédaction revient à Benoît XVI – elle a complètement son style et sa démarche ! J’aurais aimé connaître sa lecture. Aurait-elle été foncièrement différente de celle de la Fraternité Saint-Pie-X, dont j’ai pris connaissance sans guère d’étonnement, mais tout de même avec un peu d’impatience, me rendant compte qu’on ne bougeait pas d’un pouce par rapport à des positions figées qui se veulent traditionnelles et qui ne le sont guère, pour peu qu’on se réfère à une Tradition bien antérieure à certaines ambiguïtés ou erreurs liées à la période moderniste. Ne pas avoir perçu la force et la beauté de ce texte du Magistère, y dénoncer des relents d’immanentisme subjectiviste, c’est manifester une incompréhension tenace, même si elle s’explique par un passé compliqué. Attention à ce que le bienfait providentiel du pontificat d’un pape, si profond théologien, n’ait pas été inutile à la cause de ceux qui se veulent fidèles à la grande Tradition de l’Église.
Pour aller plus loin :
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- Jean-Paul Hyvernat
- EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE « AFRICAE MUNUS » DU PAPE BENOÎT XVI
- Liste des ouvriers pastoraux, Evêques, Prêtres, Religieux, Religieuses et Laics tués en 2011 et 2010
- LE MINISTERE DE MGR GHIKA EN ROUMANIE (1940 – 1954)