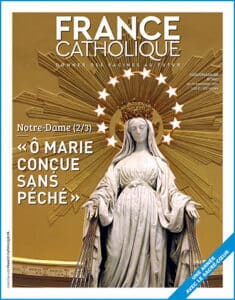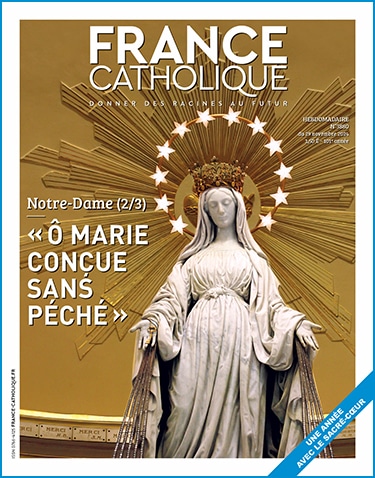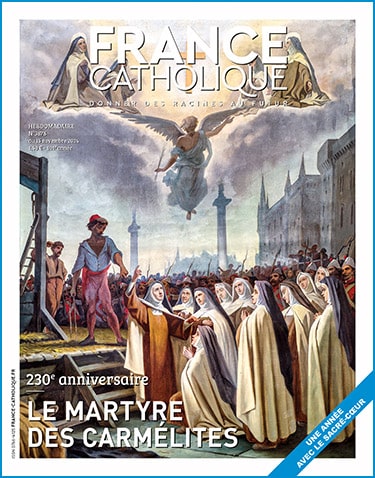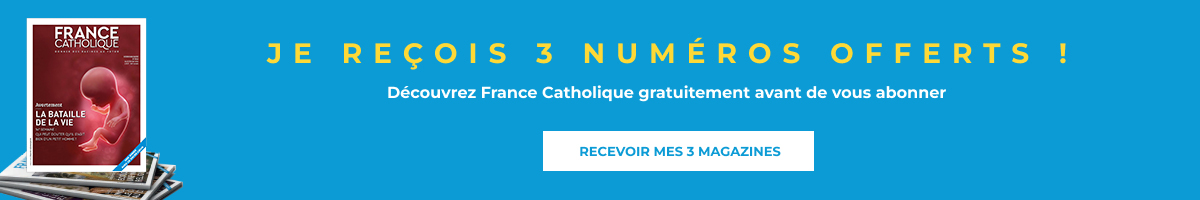Le monde lacustre, sylvestre, où la brume des matins de septembre n’était pas toute dissoute quand arrivait midi, pourrait-il se prêter encore à une autre exploration ?
Ce trésor des mots, d’où sortaient, comme des armoires de Sylvie ou des Grand Meaulne, des trouvailles d’une jeunesse déconcertante pêle-mêle avec des parures ironiquement fanées, des diamants si négligemment attachés qu’on risquait de les prendre pour du strass, et puis des verroteries d’enfants qui se mettaient à luire comme des étoiles, y puiserait-on encore dans la lumière dure du milieu de la vie ?
La réponse est devant nous. Qu’elle en déconcerte beaucoup, on le comprend. Notre époque de production surabondante est dure pour les pauvres critiques ; mieux que jamais, ils souhaitent des auteurs sans surprises.
La critique d’un de nos journaux « bien-pensant » s’empresse de nous avertir que ce poète chrétien est démodé avant d’être lu, puisque ce qu’il écrit veut dire quelque chose, alors que tous les journalistes catholiques à la page (ayant lu Lautréamont dans les morceaux choisis bien expliqués de Seghers) savent que cela ne se fait plus. La Tour du Pin est donc, en quelque sorte, en retard même sur Saint John Perse : fi pour des chrétiens noosphériques !
L’homme du vingtième siècle devant l’hiver qui s’est abattu sur le monde
En fait, ce que nous avons sous les yeux est peut-être bien ce que notre temps pouvait donner qui correspondit le mieux à ce que d’autres temps mirent en forme d’épopée. Est-ce une Odyssée ou une Enéïde spirituelle ? Je ne sais, car si le pays paternel y est retrouvé après une longue errance, il se redécouvre tellement transfiguré par cet exode qu’il en est devenu le foyer nuptial. Entre ces deux, l’exode, évidemment, c’était la croix, mais pas la croix dressée devant les yeux : la croix du cœur que la vie a ouvert en le brisant.
Dans ce périple, André Vincentenaire (l’Homme du vingtième siècle après le Christ – on s’excuse de traduire un rébus aussi ingénument déchiffrable, mais les gens qui « snobent » la poésie signifiante paraissent avoir tant de peine à saisir sa signification qu’on ose malgré tout), André Vincentenaire, dis-je, est bien autrement seul qu’on pouvait l’être dans la vie recluse à l’école de Tess.
Il est seul, en effet, de cette solitude qu’on ne découvre qu’en rentrant en soi-même et en y parvenant à cette zone indécise où l’on ne sait plus si ce qu’on touche dans l’ombre est toujours de nous ou bien des mains divines qui nous tiennent encore parce qu’elles achèvent seulement de nous façonner. Que sont Didier, Denis, David qu’il rencontrera dans la forêt magique où il vient de retourner l’échiquier à travers lequel le diable lui disputait l’enjeu de sa propre vie, sinon cette trinité où nous rejoignons Dieu dans l’image de lui-même qu’il projette en notre miroir le plus intérieur ?
Et la table qui les rassemblera dans son moi total reconstitué, autel vide au sommet de la Passion et où il faut que lui-même s’étende, est aussi la seule table possible d’orientation dans son univers intérieur. Après cela, le retour souterrain par la caverne virginal et les sources du baptême, dont l’eau se révèle au matin toute teinte de son propre sang, le rend à lui-même en même temps qu’à un univers devenu fraternel enfin pour celui qui n’a pas craint de rejoindre seul le Christ seul sur sa croix.
A première vue, il semble que l’hiver se soit abattu sur le monde, si étrangement à la fois printanier et automnal, de la Quête de joie. Non seulement son bestiaire angélique est mort, ou en fuite, non seulement son humanité multiple, chatoyante, charmante, cocasse, n’y survit plus que dans quelques enfants perdus, quelques vieillards faussement narquois, en réalité frissonnants de la crainte de ne pas dire aux autres, avant qu’il soit trop tard, le mot décisif, sans jamais oublier la foule anonyme au loin, crispée de souffrance et de désespoir dans ses villes aveugles – mais les couleurs diaprées se sont volontairement amorties dans une nuées nocturne de création ou d’apocalypse.
Le concert de tant de voix juvéniles s’est tu, et voici qu’une voix qui semble nouvelle monte dans le silence et l’emplit sans le profaner. Car elle a fait sienne une pureté terriblement exigeante qui lui manquait encore et elle dit en des mots de cristal, suffisamment invisibles pour que le soleil du Verbe y rayonne comme à nu, ce qui touche si directement la chair de l’humanité que le cœur y est d’emblée atteint.
Le chant d’un homme qui dit le mystère du monde
On nous engage au départ dans un récit familier : l’aventure apparemment bourgeoise du père qui semble couver son fils plus que de raison, mais qui, peut-être, l’incite lui-même à ce départ où les psychanalystes dépisteront sans peine toutes les traces du meurtre du père. Vraiment né enfin, mais dans la conscience de sa faute originelle, le fils, pour la première fois peut-être, entend la vraie voix de ce père qu’il écoutait avec agacement, la veille, secouer sa pipe froide après avoir exprimé pour lui une pensée encore inaccessible dans le cahier accusateur…
Mais, attention ! Nous sommes déjà largués de cet univers confortable où nous croyons nous mouvoir : où il y a des problèmes « embêtants », mais pas de mystères qui gênent au-delà d’une certaine zone de sécurité ; on nous a prévenus qu’il passe par là des cours d’eaux souterrains et que nous étions dans une île sans le savoir. Après cela, c’est tout naturellement que le récit bonhomme, d’une ironie qui évoquait déjà Tieck, voire Novalis, va s’avouer pour ce qu’il est : un véritable conte dont la littérature française n’avait pas jusque là de si exact équivalent.
Les poèmes y fleurissent, qui tantôt semblent cristalliser le souffle du chercheur en des arbres de givre, jalonnant, éclairant sa route d’autant de stèles translucides. Tantôt, au contraire, leur jaillissement subit traduira la percée enfin réussie, à travers les cheminements, tortueux peut-être mais toujours dénoués vers la lumière, de coulées intérieures rendue par le baptême à leur vitalité créatrice.
Dans cette forme nouvelle, encore une fois si épurée d’exigence que le bleu de son firmament s’y assombrit à l’entour de constellations vues de si près qu’elles ne scintillent même plus, tout chant du monde se tait dans le chant d’un homme seul où passe une autre voix que la sienne. Quand on gravit ainsi le mont de la Passion, l’atmosphère qui, d’abord avait grisé d’une exaltation insolite, paraît bientôt irrespirable. L’humanité ne s’est-elle pas perdue dans cette nouvelle quête qui l’entraîne si évidemment, à travers elle-même, au-delà d’elle-même ?
Une œuvre chrétienne dans toutes ses fibres
La réponse nous sera donnée dans cette paradoxale préface qui conclut le livre (ou plutôt l’unique poème, baignant dans les eaux-mères de son mythe, de son Maerchen baptismal). Préface doit s’entendre ici au sens eucharistique, de la découverte exultante du mystère nuptial où l’être se retrouve quand il a enfin consenti à sa perte, et celle de tous êtres avec lui, qui ne sont pas l’être seul embrassé dans le Christ en croix.
Cette préface, après l’austérité de ce deuxième chant, semble annoncer, inaugurer déjà la nouvelle création qui doit naître du mystère accepté comme celui du Christ. La couleur, le mouvement primesautier de la Quête de soi nous sont-ils rendus ? Plutôt, la mélodie dépouillée du Second Jeu y évoque en final une autre symphonie, qui n’est plus celle où les voix au bord du ruisseau s’accordaient dans un amusant désaccord, mais le grand chœur qui va conclure par l’hymne d’une autre joie : où l’Homme du vingtième siècle et touts les hommes qu’il portait avec lui, en lui, seront réconciliés avec le Père, dans l’étreinte nuptiale avec le Christ, son Christ et leur Christ : le Fils unique du Père, le seul Epoux de l’Eglise et de l’âme baptisée.
Faut-il situer une telle œuvre ? Chrétienne dans toutes ses fibres, humaine non moins, elle est malgré cela aux antipodes du baroque claudélien. Il y a bien d’autres ressemblances pourtant, à commencer par cette impression première d’obscurité, qui n’est sans doute que celle de la nouveauté. Mais la différence essentielle est qu’il n’y a pas ici vision, peinture, sculpture d’un univers qui se projette à grands coups de pinceaux, de ciseau. C’est au contraire une germination irrésistible, mais au long de successifs dépouillements, du grain qui ne multiplie que mort en sa terre.
Louis BOUYER