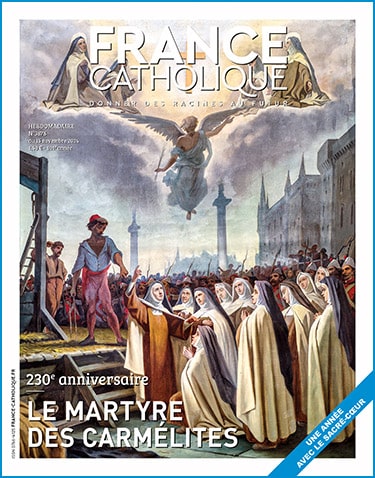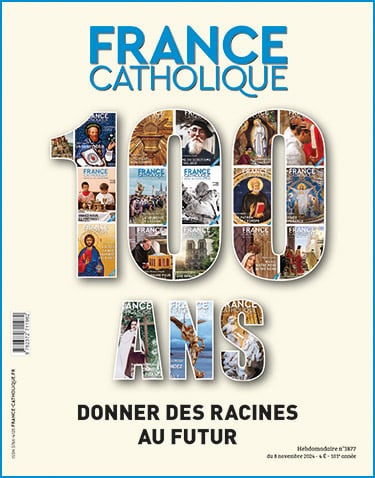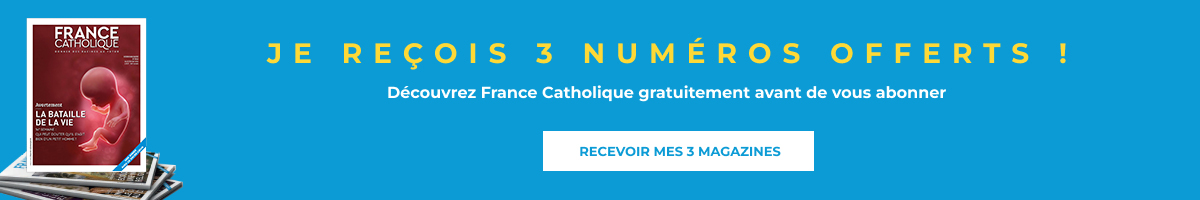L’armée française est arrivée en Afghanistan en 2001, après la victoire de la coalition sur le régime installé à Kaboul par les Talibans. À l’époque, cet engagement avait été largement approuvé. Jacques Chirac et Lionel Jospin partageaient le même point de vue, l’intervention militaire était justifiée en droit international et c’est avec une prudence toute politique que les troupes françaises avaient été installées en divers points de l’Afghanistan.
Depuis 2003 cependant, la situation ne cesse de se dégrader. Le président Karzaï ne parvient pas à établir son autorité sur l’ensemble du pays, la corruption sévit, la culture du pavot s’étend, le commerce de la drogue prospère et les Talibans, défaits mais non détruits, ont reconquis chaque année un peu plus de terrain. Alors que Jacques Chirac avait placé nos avions de chasse au Tadjikistan puis retiré nos troupes spéciales, Nicolas Sarkozy a envoyé nos Mirage à Kandahar, sur une base de l’OTAN, et augmenté le nombre de nos soldats qui, à la différence des Allemands, accomplissent de nombreuses missions périlleuses.
C’est dans ce contexte qu’une patrouille française est tombée dans une embuscade, le 18 août 2008 à Uzbin. Le livre de Jean-Dominique Merchet (1) commence par le récit, fondé sur des sources incontestables, de ces longues heures de combat au cours desquelles dix soldats français ont été tués. Pour ce journaliste de Libération, qui anime un blog très apprécié par les militaires (2), il ne s’agit pas de faire du sensationnel ni d’exploiter la veine compassionnelle. L’embuscade d’Uzbin est un événement de première importance car il confronte soudain les Français à la cruelle réalité d’une guerre lointaine qui leur paraissait jusqu’alors fort abstraite. Et c’est parce que beaucoup de nos concitoyens cherchent depuis le 18 août à comprendre ce que nous faisons là-bas que Jean-Dominique Merchet s’est efforcé de leur présenter des explications jamais simplifiées mais aussi simples que possible.
D’abord comprendre. Rude tâche pour laquelle il faut mobiliser, quand on n’est pas soi-même spécialiste, géographes et linguistes, anthropologues et historiens… Pour résumer, disons que l’Afghanistan est une « anti-nation » selon la définition de René de Planhol. Dans cette zone tampon entre plusieurs mondes (Inde, Pakistan, Asie centrale, Iran) qui n’a jamais été colonisée, un État se constitua au XVIIIe siècle sous la forme d’une monarchie débonnaire qui avait la sagesse de peu gouverner ce pays ingouvernable. L’Afghanistan n’est pas une nation parce que son unité est très fragile – dans le meilleur des cas – et inexistante dans l’esprit de nombreux Afghans qui ne forment pas un seul peuple mais un assemblage instable de groupes sociaux que ni l’Islam ni la langue ne parviennent pas à souder.
Les Pachtounes forment le groupe majoritaire, de religion sunnite, de langue persane mais ce n’est pas une ethnie : est Pachtoune celui qui respecte la loi pachtoune, le pachtoun-wali. Viennent ensuite les Tadjiks qui sont très différents des citoyens du Tadjikistan, marqués par l’influence russe puis soviétique. Les Tadjiks d’Afghanistan professent l’islam sunnite, parlent le persan et sont très connus en Europe grâce au commandant Massoud. Ajoutons les Ouzbeks, sunnites de langue turcique, les Hazaras, musulmans chiites duodécimains, les chiites ismaéliens qui reconnaissent en l’Agha Khan le descendant du Prophète. N’oublions pas que les membres de ces groupes se distinguent encore selon leur tribu et la vallée qu’ils habitent.
À la fin du XXe siècle, on vit apparaître les talibans, mouvement religieux ultapuritain qui n’a pas été fabriqué par les services secrets pakistanais comme on le dit parfois mais qui s’inspire de l’école musulmane déobandie qui existait dans les Indes britanniques et qui est très influente dans l’actuel Pakistan. Les talibans ne sont pas des révolutionnaires mais des partisans de l’application de la charia. Au contraire, les hommes d’Al-Qaïda sont des révolutionnaires et des terroristes mais ce ne sont pas des Afghans. Tel est le terrain anthropologique sur lequel évoluent les troupes françaises et les autres soldats de la coalition.
Le contexte politique n’est pas des plus simples.
On se souvient que le roi Zaher Shah a été renversé par un coup d’État organisé par le prince Daoud (17 juillet 1973) et que les communistes prirent le pouvoir le 27 avril 1978 ce qui déclencha la guerre civile et l’intervention soviétique (24 décembre 1979) dans un pays qui entretenait d’excellentes relations avec Moscou depuis la victoire des bolcheviques. Les Afghans sont donc en guerre avec eux-mêmes et avec les autres depuis trente-cinq ans : des hommes mûrs n’ont connu que la violence depuis leur enfance et le pays est dévasté.
Jean-Dominique Merchet analyse ces guerres successives et en tire deux enseignements majeurs.
La première est que, depuis la chute de la monarchie, les Afghans se sont montrés incapables de se donner un régime politique stable garantissant la paix civile et la sécurité de chacun. Parvenus au pouvoir, les communistes étaient divisés en deux factions rivales ; après la chute du régime communiste, Massoud prit le pouvoir à Kaboul mais se heurta à un autre seigneur de la guerre, Hekmatiar : la guerre civile dura quatre années et de nombreux quartiers de Kaboul, coupée en deux, furent alors complètement détruits. Les talibans prirent le pouvoir en 1996, remirent de l’ordre avec le fanatisme que l’on sait mais se heurtèrent à l’Alliance du Nord dans une nouvelle guerre civile qui se termina par la défaite des ultrareligieux en 2001. Depuis, se mêle la résistance pachtoune et talibane aux armées venues d’Occident mais aussi la guerre entre l’armée nationale afghane et les forces qui s’opposent au président Karzaï. Ces affrontements passés et présents augurent mal de l’avenir.
Le deuxième enseignement est tiré de l’intervention soviétique en Afghanistan. Cet épisode appartient à l’Histoire et Jean-Dominique Merchet en dresse un bilan sans complaisance mais complètement dégagé des passions du temps de la guerre froide. Ce qu’il dit est beaucoup plus intéressant que les sempiternels règlements de compte et devrait mettre en alerte les dirigeants français. Pourquoi ?
Parce que, mutatis mutandis, les Américains, les Anglais et maintenant les Français sont en train de refaire tout le chemin parcouru par les soviétiques.
Mêmes doutes au début. Les archives prouvent que le politburo était divisé et que beaucoup de généraux russes étaient hostiles à l’intervention ; en France aussi, l’intervention militaire a été critiquée, sans doute par une minorité, mais avec pertinence.
Mêmes objectifs ou presque. Il va sans dire que les justifications idéologiques sont contraires : l’internationalisme prolétarien hier, les droits de l’homme et la démocratie libérale aujourd’hui. Mais, comme les Soviétiques, les coalisés prétendent apporter la prospérité à l’Afghanistan, le moderniser et y créer un régime politique assez fort pour que les dirigeants puissent gouverner après le départ des troupes étrangères. Ce qui suppose que l’on afghanise le conflit.
Mêmes déconvenues militaires. Malgré leur puissance de feu, les Soviétiques ont vérifié ce que les Britanniques avaient compris au XIXe siècle : on ne peut pas réussir la conquête militaire de l’Afghanistan. Les Anglais perdirent les trois guerres qu’ils y menèrent et ils se souviennent du massacre des 16 000 hommes de la colonne commandée par le major général Elphinstone en janvier 1842. Les Russes subirent de lourdes pertes dans les premiers mois de leur intervention mais surent tirer les enseignements de leurs échecs : réorganisés en commandos de chasse, ils obtinrent de nombreux succès tactiques que les Américains ont reconnus mais dont ils n’ont pas tiré les leçons. Trop peu nombreux pour contrôler le pays (c’est aussi le cas des troupes de la coalition) les Soviétiques réussirent à tenir les grandes villes et à contrôler les principaux axes routiers (mieux que les Occidentaux actuellement) tout en formant au combat une armée nationale afghane (ce qui est à nouveau tenté aujourd’hui).
Même confusion politique. Communiste ou pro-occidental, le gouvernement de Kaboul ne contrôle pas le pays et dans les années quatre-vingt comme depuis 2001, les armées étrangères n’ont pas affaire à une insurrection nationale : elles affrontent des forces religieuses, des groupes sociaux (Pachtounes, Ouzbeks), des seigneurs de la guerre, de simples brigands.
Même rôle joué par le Pakistan. Ce pays qui vit dans la peur de son voisin indien et qui s’oppose à lui sur la question du Cachemire doit se concentrer sur son front Est et être tranquille sur ses arrières à l’Ouest. Il veut donc que le régime de Kaboul lui soit favorable. C’est pourquoi il a soutenu la résistance afghane anti-communiste, puis les Talibans. Comme le tracé frontalier entre l’Afghanistan et le Pakistan (la ligne Durand) coupe en deux le pays pachtoune, comme le pouvoir central pakistanais ne contrôle pas les zones tribales pachtounes, les insurgés en ont fait leur base arrière d’où ils peuvent monter leurs opérations dans une relative sécurité.
Après une longue guerre, les Soviétiques avaient fini par retirer leurs troupes. Ils avaient perdu 14 453 soldats, soit deux fois plus que les Américains en Irak mais deux fois moins que les pertes de l’armée française en Algérie. L’armée soviétique se replia en bon ordre et Jean-Dominique Merchet souligne à juste titre que le pouvoir communiste qu’elle avait installé parvint à se maintenir trois ans face aux Moudjahidines anticommunistes. Il n’est pas sûr que les Américains puissent obtenir cette modeste réussite.
Aujourd’hui, les forces de la coalition sont dans une situation critique : les insurgés contrôlent une grande partie du territoire et de nombreux axes de communication, les villes ne sont pas sûres, le pays n’est pas reconstruit et il tire le principal de sa richesse de l’exportation de la drogue et de divers autres trafics. Les militaires mettent en œuvre une stratégie inadaptée et contre-productive : les bombardements tuent beaucoup de civils et tournent la population contre ses prétendus bienfaiteurs. De surcroît, il est manifeste qu’on ne peut vaincre le terrorisme par des moyens militaires classiques. En matière de droits de l’homme, les progrès sont infimes : les femmes portent toujours la burqa et un jeune homme, Sayed Perwiz Kambakhsh a été condamné à mort en 2007 pour « blasphème et diffusion de propos diffamatoires à l’encontre de l’islam ».
Manifestement, la guerre est perdue et les soldats français se trouvent dans un guêpier. Jean-Dominique Merchet est sévère pour Nicolas Sarkozy qui a décidé de participer plus activement au conflit sans donner à nos troupes les moyens nécessaires et sans discuter les objectifs et la stratégie des Américains. Il commit en outre la faute de privatiser la mort des soldats tués en août dernier (elle fut traitée comme un accident de la circulation) et d’offrir aux insurgés une formidable victoire politique : tuer dix soldats et obtenir qu’un puissant chef d’État se déplace, voilà qui incite à renouveler le sanglant exploit !
La conclusion de Jean-Dominique Merchet doit être méditée : il ne faut pas exposer plus longtemps la vie des soldats français dans une « lutte contre le terrorisme » qui a échoué (justifiée, elle suppose de tout autres méthodes) et pour donner des gages à des alliés américains qui, comme les Anglais, comme les Russes, seront contraints de rapatrier leurs troupes.
Il nous faut partir. Vite, mais sans précipitation. Rapatrier nos soldats qui servent admirablement leur pays sans pour autant renoncer à toute présence politique et économique en Afghanistan et en Asie centrale. Nos échecs ne seront pas une défaite si notre diplomatie est repensée à temps.
Alexandre