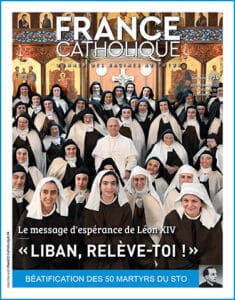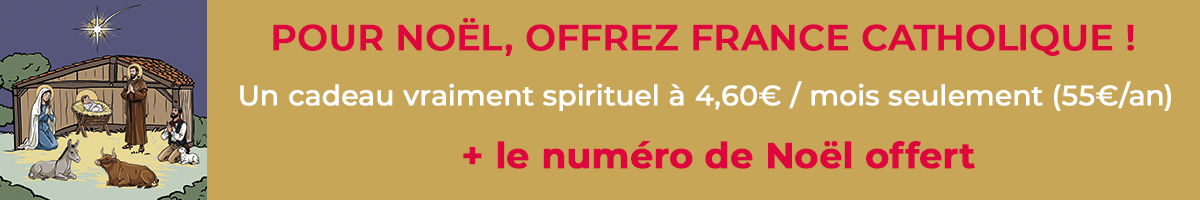6 novembre
C’est une idée tenace, et qui, parfois, s’énonce en aphorismes populaires : les religions sont dangereuses et nuisibles, elles portent la violence comme la nuée l’orage. Par chance, les Lumières sont intervenues pour faire obstacle à cette violence et inventer cette merveille qu’est la laïcité pour rendre le religieux enfin inefficace et anodin. Les libelles antireligieux abondent en citation des livres saints pour démontrer cette foncière perversité. Et s’il est singulièrement difficile de tirer le Nouveau Testament du côté de la vindicte meurtrière, on finit quand même par trouver une citation isolée pour conforter la thèse. Lisez quelqu’un comme Pena-Ruiz et vous serez bien documenté là-dessus. Il est vrai qu’il s’agit d’un spécialiste. Mais il n’est pas rare que de plus modérés s’engagent sur ce même chemin. Ainsi, Elie Barnavi, il y a deux ans, avait publié un essai intitulé Les religions meurtrières (Café Voltaire-Flammarion) qui professait que « toutes les religions, les plus iréniques y compris, portent la violence ». Il est vrai qu’il ajoutait : « Que les conditions sociales s’y prêtent, et elles y donneront libre cours. » Était-ce vraiment une circonstance atténuante ?
Le ressort, selon Barnavi, d’une telle fatalité ? La prétention à détenir « une vérité transcendante et absolue, exclusive de toute autre ». À partir de là, le politique est pris en otage comme moyen de coercition pour imposer cette vérité à laquelle on ne saurait échapper. Sauf, grâce à la laïcité précisément. Il est vrai que Barnavi est d’abord historien et que ses démonstrations épousent la sinuosité de l’histoire. Il lui arrive de nuancer ses affirmations qu’on peut, par ailleurs, contester par une contre-argumentation sur son terrain. Il faudrait discuter longuement, surtout sur la notion de laïcité que je n’admets pour ma part que comme une sorte de compromis empirique qui a le mérite de permettre la liberté religieuse, parfois à l’encontre des persécutions laïques.
Mais il faut revenir au sujet central, la prétendue violence inhérente aux religions. Elie Barnavi n’est pas prêt de se laisser convaincre par les textes : « Des textes ? Mais les textes, on l’a vu, ne disent que ce qu’on veut bien leur faire dire ». Précisons quand même. C’est la manière dont les textes sont vécus qui compte d’abord et qui pose un problème politique. Tout serait donc piégé, et il faudrait partir des lignes de fractures, la principale traçant la ligne entre fanatiques et esprits éclairés. J’admets cette façon de poser le problème. Mais elle n’exclut pas la question de fond du message religieux et du sens des textes. Il n’est pas vrai que tout soit objet de manipulation. Encore faut-il cet espace de sérénité, d’ascèse intellectuelle, de rectitude spirituelle qui permet d’entrer dans la compréhension d’un message. Message religieux certes, mais qui concerne, si on n’est pas religieux soi- même, le trésor culturel et spirituel de l’humanité.
Il y a une réelle difficulté à convaincre des gens comme Barnavi qui ont leur idée a priori du religieux et des religions forcément meurtrières. Mais n’est ce pas la loi commune du dialogue possible ou impossible ? Philosophiquement il faut du temps pour argumenter, sans être sûr de convaincre. Religieusement, théologiquement, ce peut être encore plus difficile, du moins si on argumente avec un non-croyant, un sceptique radical, qui au surplus, croit qu’il sait. Il faut prendre son temps pour lire la Bible et se confronter à cette question sans fond de la violence humaine et décider s’il faut en exonérer la Providence. Lorsque René Girard dévoila le troisième volet de sa pensée sur la spécificité de la révélation biblique, après avoir exposé la théorie mimétique et celle du bouc émissaire, il fut vivement contesté. Je me souviens qu’Alain de Benoist, chef de file d’une nouvelle droite néopaïenne, traita d’imposture, l’idée selon laquelle, l’Ancien Testament formulait une voie de sortie de la violence. Certes, il n’avait pas de difficultés à citer les pages particulièrement violentes de la Bible, notamment le livre de Josué si souvent dénoncé.
De ce point de vue, l’essai d’André Wénin, bibliste et professeur à Louvain, apporte un éclairage tout à fait bienvenu (La Bible ou la violence surmontée, Desclée de Brouwer). L’Écriture sainte ne consiste pas en un récit religieux ordonné comme un catéchisme ou un manuel de morale, même si elle mêle tous les genres. Il ne faut pas s’étonner qu’elle ne cesse de nous jeter la violence à la figure comme une des réalités de la vie : « Au fond, la présence de la violence dans la Bible pourrait constituer une invitation à la lire autrement, à développer une façon de lire où le lecteur entre dans un corps à corps avec le texte, s’impliquant avec tout ce qui fait son expérience humaine. De la sorte, le sens serait le résultat du dialogue qu’il entretient avec le livre lorsqu’il veille à le lire avec attention et respect. »
Déjà, René Girard, nous donnait à comprendre le texte biblique d’une façon qui le problématisait, le tirait d’une superficialité littérale pour percer un sens qu’il recélait à condition de le saisir à fond, lui faire avouer en quelque sorte son secret. La méthode d’André Wénin n’est pas exactement celle de René Girard, bien qu’elle la recoupe. Je le cite : « Pour trouver le chemin de la vie, les pièges sont à éviter, et donc d’abord à démasquer. Le premier est la convoitise qui empoisonne la vie à sa source même. Car si le désir n’est pas correctement ajusté à la limite qui le suscite, il fait violence à ces relations qui me fondent, démentant la promesse de vie qu’il recèle. » Ce n’est pas exactement le désir mimétique de René Girard avec sa force destructrice omniprésente, mais cela y ressemble quand même pas mal.
De même, si René Girard voit dans la figure centrale du Serviteur souffrant, du prophète Isaïe, un exemple typique de bouc émissaire mis à mort pour exorciser la violence générée par l’emballement mimétique, André Wénin, sans exclure cette interprétation, privilégie la déclaration d’Adonaï proclamant que son serviteur triomphera et sera exalté. Il n’empêche qu’ainsi l’un et l’autre convergent vers la révélation de la dilection divine pour la victime innocente non reconnue comme telle, mais au contraire démonisée. À l’encontre de l’opinion commune qui veut que les victimes expriment la malédiction divine qui est tombée sur elle, la Bible rétablit l’ordre de la justice. Il est nullement étonnant qu’à cinquante reprises le Nouveau Testament se réfère à cette figure du Serviteur où il voit Jésus humilié et injustement condamné en sa Passion. L’attitude de Jésus qui se tait sous l’outrage ressemble aussi à celle du Serviteur qui « se refuse à rejeter sur d’autres la violence dont on l’accable, pour faire barrage au mal plutôt que de lui offrir un relais qui relancerait son mécanisme en l’amplifiant. Quant à Adonaï, s’il s’est tu à ce moment-là, c’est qu’il a voulu qu’il en soit ainsi. Non que Dieu ait frappé le serviteur pour sa faute comme les gens l’ont cru à ce moment. Mais plutôt qu’Adonaï a accepté que le mal des violents qui s’ignoraient atteigne le Serviteur, en vue de leur salut. »
Il faut être très attentif pour saisir ainsi cette pédagogie qui nous éloigne de la convoitise et de l’idolâtrie pour nous déprendre de la violence. Ce n’est d’ailleurs qu’une étape préliminaire à celle qui nous fait choisir le bonheur par un chemin de résurrection. Les citations bibliques abondent, pleines de saveur, pour justifier un tel chemin. Encore faut-il aller les chercher, comme le bibliste qui cultive en même temps culture savante des textes et méditation savoureuse de ce qui est une vraie nourriture.
Non, Elie Barnavi, on ne fait pas dire aux textes ce que l’on veut, sinon par fraude, violence, injustice. Que des fanatiques s’en emparent pour ériger leur fureur en droit de Dieu, ce n’est que trop réel. Mais les textes dont ils se sont emparés les condamnent. Comment le reconnaîtraient-ils alors que le trouble des passions les submerge et brouille leur intelligence ? Invraisemblable contradiction. Alors que la Bible ne cesse de provoquer aux changements profonds, à la conversion, à la défense du juste écrasé par l’injustice et les méchants, la voilà brandie au service de la cause des impies ! J’ouvre un petit livre de Martin Buber, Le Juste et l’Injuste, Bayard) qui consiste en un commentaire de cinq psaumes, et j’y trouve mon sujet directement traité, notamment à propos de ce point si délicat qui est celui de l’appropriation de la Vérité.
Selon Elie Barnavi, le danger religieux réside dans cette appropriation qui confère tous les droits, y compris celui d’exterminer ses adversaires prétendus. Or, selon le psalmiste, la Vérité concerne d’abord celui qui entretient en lui le mensonge et refuse de reconnaître la Vérité qui l’accuse. Le chemin de la conversion, loin d’être facile et évident, doit passer à travers les obstacles de la désillusion. Seule l’aide de Dieu permet la délivrance : « En même temps que le cœur, l’œil se métamorphose, et, dans ce qui jusqu’alors, paraissait absurde, se fait jour, pour le regard neuf, le sens. » Tout repose sur cette transformation intérieure : c’est à partir d’elle seulement que le monde change. » Buber nous entraîne fort loin des religions meurtrières, du terrorisme du Bien et de l’écrasement de tous sous le poids d’une Vérité toute puissante. Dieu est du côté du juste opprimé qu’il veut sauver de la main du criminel. Et sa Vérité libère, loin d’opprimer.
7 novembre
Ce n’est pas seulement Elie Barnavi qui se distingue par la phobie de l’appropriation de la Vérité. Cette phobie est largement partagée par une opinion qui y voit la cause de toutes les catastrophes, la première s’identifiant au fondamentalisme religieux. Beaucoup de chrétiens participent de cette mentalité frileuse qui conduit à se méfier ou à prendre ses distances par rapport à de convictions fortes. Sous le pontificat de Jean-Paul II il y eut ainsi toute une offensive concertée contre le « retour des certitudes » avec dénonciation d’une mentalité de reconquête du terrain contre la sécularisation. Il m’est arrivé de contrer assez vigoureusement cette mentalité dont les effets étaient pernicieux à plusieurs égards.
Mais il est utile de revenir sur les données d’une réelle difficulté. Par exemple, on ne cesse de dénoncer toute tentative de prosélytisme en discernant une menace qui n’est sans doute pas illusoire. Il y a dans certaines méthodes pour convertir des procédés discutables de persuasion. Cela ne veut pas dire qu’il faut renoncer à persuader. Il est d’ailleurs assez comique d’observer notre univers médiatique, commercial, publicitaire où les techniques pour circonvenir le consommateur voire le citoyen, sont légion. En contraste, le langage des hommes d’Église apparaît, en général d’une extrême discrétion et d’une rare prudence pour le respect des interlocuteurs.
C’est une question d’époque. Nous ne sommes plus au temps de Clovis où, d’autorité, les guerriers étaient baptisés avec leur chef. Nous ne sommes même plus au temps de François Xavier ou encore des missionnaires du Père Lavigerie. Un ami qui fait partie de cette congrégation me racontait la réaction d’un évêque d’Afrique du Nord sur une possibilité d’évangélisation dans la région, qui lui paraissait s’ouvrir aujourd’hui : « Malheureusement, les Pères Blancs ont pris leur retraite, et je ne vois pas qui pourrait s’en occuper… » Il est vrai que l’action des évangélistes dans certains secteurs d’Algérie donne à penser. C’est qu’il y a une réelle paralysie missionnaire aujourd’hui, fondée sur de nombreux scrupules moraux. Pourtant, Dieu sait si on a souvent repris les fameux propos de saint Paul chez nous : « Malheur à moi si je n’évangélise pas. »
La notion de prosélytisme donne déjà à penser. À l’origine le mot n’avait pas la connotation péjorative qu’il a acquise. Le prosélyte était le païen qui avait acquis la religion juive. Pour le Littré, prosélytisme se dit le plus souvent en mauvaise part. Les autorités de l’orthodoxie russe craignent le zèle indiscret de missionnaires étrangers sur leur territoire pastoral. Les juif se montrent très sourcilleux à l’égard de l’évocation de reconnaissance du Christ de leur part (voir l’affaire de la Prière du Vendredi Saint dans le rite extraordinaire). Plus généralement il y a la phobie de l’interventionnisme spirituel, de toute action qui viendrait troubler la conscience dans son intimité, avec le soupçon que celui qui se prévaut de la Vérité pour convaincre, est lui-même dans un rapport équivoque avec cette Vérité qu’il s’approprie et qui le justifie, y compris dans sa volonté de puissance.
Alors que je remuais ces pensées, un petit livre du Père Maurice Bellet m’est tombé entre les mains et je ne suis pas arrivé à m’en défaire tant il ramenait en moi tous les scrupules imaginables (Le meurtre de la parole ou l’épreuve du dialogue, Bayard 2006). Je ne l’exposerai ni le commenterai dans son ensemble car il me renvoie à une interrogation dont j’ai du mal à sortir. C’est vrai que penser cette affaire du dialogue à quelque chose de vertigineux, qu’elle nous engage dans une ascèse de désappropriaton de la Vérité au terme de quoi nous ne pourrons plus nous conduire en conquérant ou en dominateur. Mais implicitement c’est un procès qui est ainsi fait au christianisme d’hier dont on propose « l’élimination créatrice », indispensable parce qu’il « ne tolère pas la désappropriation, il en est incapable ; il se fait possession et savoir de la voie ineffable. L’autre, vraiment l’autre, il ne peut que l’exclure ».
Ce type de formules a sa légitimité, mais aussi ses limites. Et on retrouve dans la théorie de la désappropriation les impasses de la théologie kénotique, telle que l’explique le Père Descouvemont. Exemple : « Le passage de l’universel impérial a l’espace du dialogue peut être l’occasion pour les chrétiens de mener plus loin ce processus de l’intuition évangélique, se déchargeant de tout ce qui l’a encombré, se livrant sans craintes à cette parole échangée qui ne sait que servir la Vérité au lieu de croire la posséder. Autrement dit, le travail de désappropriation immanente au dialogue réel coïnciderait en fait avec cette élimination créatrice. » Il me semble qu’il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais aussi quelque chose qui lui est mêlé et qui peut en compromettre le sens.
La Vérité ne saurait être un enjeu de pouvoir, un levier pour une volonté de puissance. N’empêche qu’elle est revêtue d’une auctoritas qui me surplombe et requiert mon adhésion. Le danger est que l’auctoritas passe du côté de l’autoritarisme. Mais la différence évangélique – là je suis d’accord avec Maurice Bellet – intervient pour « éliminer » toute morgue et tout processus de captation perverse et la désappropriation est conversion, possibilité donnée à la grâce de nous transformer comme nous ne nous y attendions pas. Et là, j’ai tous mes modèles en tête. Saint Paul, cité par Bellet, Saint Augustin au bout d’un long périple, Newman, au terme de quelles crises intérieures ! Mais revenons à la kénose, celle qui correspond à la radicalité du dialogue, avec l’abaissement, « l’anéantissement de celui par qui vient au monde le règne tant attendu ». Hélas, écrit Maurice Bellet : « Cela s’est trouvé diminué par le souci d’historicité, la piété, la spéculation théologique elle-même, en sorte qu’on n’y comprend plus rien. C’est au moins le risque trop certain. Mais, par rapport à la nécessité humaine et à l’enjeu du dialogue à chacun de voir ce qui se donne et se montre là. C’est une prodigieuse déception des disciples et du peuple. Ils attendent de Lui qu’il soit précisément le support des principes de ce qui sera le règne de la Vérité : le grand Pouvoir enfin va se manifester au monde, réunir et dominer tout ! Et tout s’effondre dans la mort. »
J’ai dit que je ne voulais pas exposer l’argument de l’essai, et m’y voilà presque contraint, puisque citant ce qui est au cœur de la pensée, je ne puis me dérober à une discussion paradoxale, dès lors que nous sommes invités, nous aussi lecteurs, à méditer « le meurtre de la parole » en quoi consisterait la Passion du Seigneur. « Si tel est le cœur de la foi chrétienne, alors se défait, dans la communion à Lui, toute espèce de prétention de Pouvoir, toute âpreté à dominer, à faire obéir, à faire taire ! Si jamais une parole sort de là, ce ne pourra être qu’une parole infiniment humble, servante, obéissante, de la seule obéissance qui vaut en ce lieu-là : d’obéir à cette Vérité qui est don et encore don, générosité envers tout humain, désir, immense désir que tout soit sauf. »
Je ne nie pas ce qu’un tel langage peut avoir de salutaire, comment il peut conduire à une mystique du détachement, d’une imitation christique jusqu’au fond de la déréliction. Mais j’exprime aussi des réserves. Pourquoi, en effet, cet assaut contre la théologie ? Serait-ce qu’elle aussi serait un lieu de pouvoir ? Ou que ces spéculations nous entraineraient sur une voie d’un Dieu pervers jadis dénoncé par l’auteur ? Là-dessus, je demande à voir, à examiner et même à contester. Mes trois modèles, Paul, Augustin et Newman se sont abandonnés au mouvement intime de conversion le plus intense qu’il soit possible d’imaginer. Mais ce sont aussi des maîtres en Vérité, qui expriment la doctrine avec l’autorité que requiert la révélation du Dieu vivant et vrai.
Si l’essai de Maurice Bellet m’a retenu de façon si insistante, c’est qu’il pose des questions auxquelles on ne se dérobe pas. Je lui oppose, cependant, une résistance qui doit sans doute se référer à de hautes raisons dans ce débat où il nous entraîne avec une conviction qui s’enracine dans tout ce parcours de penseurs de l’intériorité. La principale de ces raisons tient à cette notion d’élimination créatrice qui renvoie à la mutation ecclésiale, tant convoitée par tout une génération post-conciliaire. C’est la psychanalyse, qui, de longue date a marqué la démarche du Père Bellet et qui, semble t-il, a orienté sa conception de l’Église. Je retrouve à la fin de La postérité spirituelle de Joachin de Flore, dans le chapitre intitulé Neojoachinismes contemporains, une citation de l’intéressé, qui avait paru au Père de Lubac très caractéristique du grand mythe de la nouvelle Église : « Ne sommes-nous pas à ce moment où toute une « figure structurelle » de l’Église doit faire place à quelque chose de neuf ? La psychanalyse ne serait alors qu’un des aspects (peut-être le plus impitoyable) où cette mort d’un système s’annonce. Tout un univers mental où la foi a pu trouver à se dire, non sans d’inévitables ambiguïtés, serait en train de s’engloutir… »
Ce texte date de 1973. Trente-cinq ans après, il n’est pas contredit mais repris. Sa thématique, n’est-ce pas ce que son auteur appelait sa « quatrième hypothèse » à propos de L’avenir du christianisme (DDB, 2001). Mon désaccord est profond, comme l’était celui du Père de Lubac à l’égard des Néojoachinismes. Mais Maurice Bellet donne toujours à réfléchir mais j’avais lu avec intérêt La traversée de l’en-bas (Bayard, 2005) où son regard de clinicien me paraissait heureusement confirmer son regard théologique sur l’expérience radicale du mal.
Pour aller plus loin :
- Rencontre avec Mgr Fellay (paru dans FC n°3151 du 6 fév. 2009)
- Affaire Williamson (suite) (paru dans FC n°3152 du 13 fév. 2009)
- Emmanuel Todd et la mort de Dieu (paru dans FC n°3147 du 9 janvier 2009)
- Vitorio Mancuso (paru dans FC n°3155 du 6 mars 2009)
- Les confessions de Sœur Emmanuelle (paru dans FC n°3148 du 16 janvier 2009)