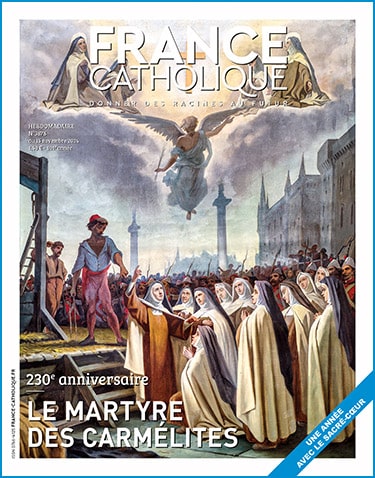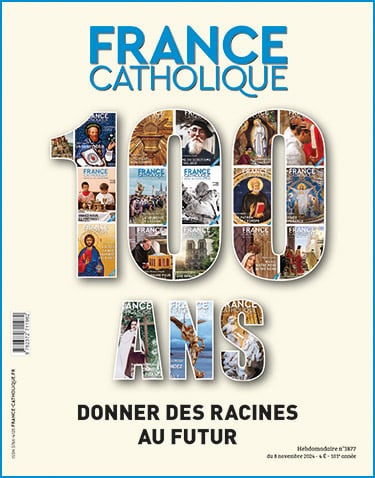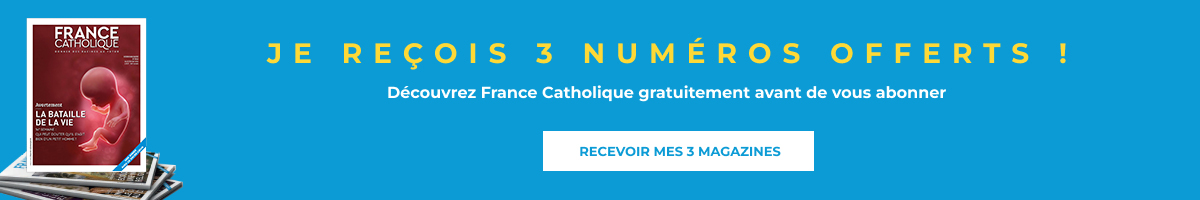25 février
Mesure-t-on assez la grâce étonnante de l’éclosion de ces génies littéraires chrétiens que sont Bloy, Claudel et Péguy, Bernanos et quelques autres ? J’y pense avec le soixantième anniversaire de la mort de Georges Bernanos auquel le centre du même nom à Paris donne toute son importance avec un beau programme de conférences et de manifestations. Mais il y a aussi la réédition du Claudel et Péguy co-écrit par le père de Lubac et Jean Bastaire dans le cadre des œuvres complètes du grand théologien. Je suis témoin que c’était une préoccupation majeure de celui-ci. Il y avait pour lui une étonnante continuité de cette Tradition dans laquelle il était complètement immergé qui permettait de merveilleux surgeons, comme Péguy. C’était aussi la conviction de Balthasar qui n’a pas hésité à inscrire le poète du Mystère de la charité au terme de sa grande galerie des génies chrétiens qui commence par Irénée de Lyon. « Dans son problème central, écrit-il de Péguy, il lutte pour surmonter un certain augustinisme du Moyen Âge, de la Réforme et du jansénisme : il pense en confrontation avec Pascal et le Dante de L’Inferno et veut, dans ses mystères, ouvrir la théologie chrétienne au point de la rendre de nouveau intelligible à l’humanité à venir. »
C’est tout à fait cela ! Et c’est bien ce que veut faire entendre le père de Lubac à propos du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc. Pourquoi Claudel, Maritain, et quelques-uns des premiers critiques n’avaient-ils pas compris cela, et sans sous-estimer la beauté du texte avaient chipoté sur son orthodoxie ? Pourquoi Maritain avait-il pu parler de littérature à l’intéressé pour souligner la différence d’avec l’expression de la foi véritable ? Claudel lui-même, dans un premier mouvement, s’était étonné de ce qu’il considérait comme une curieuse duplicité. Quoi ! Cet anarchiste, ce compagnon des anticléricaux avait pu écrire « ce livre au plus délicat sentiment chrétien ». Et puis il y avait cette querelle d’interprétation que Claudel n’était pas le seul à agiter : « J’aime mieux madame Gervaise que Jeannette dont il a fait une sorte de protestante têtue, ne sachant que faire des reproches au bon Dieu. Ce n’est pas l’esprit de la bonne Lorraine. »
Romain Rolland de son côté, pour cette même raison, prenait le parti inverse, en faveur de la « protestante » Jeanne contre la catholique Hauviette. Et de trop bons censeurs de faire chorus, de faire la leçon à un poète déclaré hétérodoxe. Ils avaient tous leurs préjugés et la plupart ne savaient pas à quel point Charles Péguy avait prodigieusement avancé sur la route de l’Évangile et des saints.
Peut-être est-ce parce que nous avons le recul et connaissons tous les secrets, que nous comprenons mal aujourd’hui ces préventions et ces chicanes. J’ai souvenir d’au moins trois représentations du Mysère de la charité de Jeanne d’Arc : aux Thermes de Cluny, au théâtre de l’Odéon et au chevet de la basilique de Paray-le-Monial. A chaque fois ce fut le même bonheur, le même moment intense, et il ne pouvait y avoir de doute dans ma tête. Ces dialogues s’unifiaient dans le seul dialogue intérieur de Péguy qui répondait lui-même aux interrogations de l’âme croyante. Et celles-ci étaient nécessairement nourries par l’histoire du christianisme évoqué par Balthasar, à propos du salut et de l’enfer. Le père de Lubac exprime exactement les choses : « En réalité, dans les moments où elles s’affrontent, Jeannette et madame Gervaise (pour ne rien dire ici d’Hauviette) incarnent chacune l’un des deux sentiments fondamentaux de Péguy. Elles traduisent deux pentes de son cœur, en ces années qui suivent son retour à la foi chrétienne sans lui avoir encore apporté la sérénité. »
La contribution de Jean Bastaire, qui concerne les rapports proprement dits entre les deux « géants » est aussi captivante. Claudel a abandonné assez vite ses préventions à l’égard de Péguy et ne doute plus de l’authenticité de son christianisme. Pourtant, il demeure des incompatibilités qui ne sont pas seulement d’humeur entre les deux poètes. Péguy n’avait pas aimé L’otage, il n’aimera pas plus L’annonce faite à Marie, « une pièce grossière où l’effet est obtenu à l’aide de procédés analogue à ceux de Marion Delorme ou d’Angelo tyran de Padoue. C’est régressif (…) d’une façon générale, le catholicisme de Claudel manque de charité. Claudel est un grand artiste mais il n’est pas intelligent. » Eh bien ! C’est Ernest Psichari qui s’est fait l’écho de cette déclaration directe. Henri Massis rapportera aussi d’autres propos plus apaisés, mais qui montrent la différence de sensibilité : « Claudel manque de simplicité. Il recherche l’extrême, le périlleux, l’exceptionnel… Il lui faut toujours franchir des abîmes sur la corde raide… Son christianisme a quelque chose de provoquant. » Péguy ne veut pas pourtant, anathémiser celui qu’il considère comme une sorte d’alter ego, comme poète et comme chrétien. Mais lui se veut « homme de la plaine… Je marche avec la piétaille, moi, je prends le chemin de tout le monde, avec tout ce peuple qui vit, c’est le cas de le dire, à la grâce de Dieu… Et je n’ai pas pour mon salut d’autres armes que les siennes qui sont la contrition, l’espérance et la prière. »
Jean Bastaire a raison d’affirmer qu’au terme les deux sont infiniment beaucoup plus proches qu’opposés par les aspects contrastés de leur génies. L’essentiel est ce qu’ils apportent à l’intelligence supérieure du christianisme, a ses trésors spirituels et mystiques qu’ils rendent comme physiquement présents. On est à mille lieux du stéréotype de « l’écrivain catholique » ou du « romancier catholique » qui a laissé derrière lui comme des relents de pharisaïsme et de conventionnalisme. Ce n’est pas l’étiquette, c’est le génie qui fait éclater le mystère. Le père de Lubac montre ainsi que Péguy a restitué toute sa grâce évangélique au mot de charité que l’on avait laissé dévoyer et qui se trouve par sa force singulière rehaussé jusqu’à sa tonalité d’une tendresse ineffable. Il était bon, il était salutaire que ces deux génies de la théologie que furent Lubac et Balthasar vinssent restituer Claudel, Péguy et Bernanos dans le fleuve ininterrompu de la grande tradition, c’est-à-dire celui qui ne cesse d’emporter les merveilles d’une révélation toujours vivante et dont la beauté fait de chaque jour une aube nouvelle.
Il n’y a donc pas d’opposition à dénoncer entre cette tradition et la Parole de Dieu où il faut toujours revenir comme à la source. Les prêtres de mon enfance, dont les prédications étaient remplies de citations de Péguy et de Bernanos, échappaient au blâme de préférer la littérature à l’Écriture Sainte. Ils n’avaient recours à leurs écrivains favoris que pour illustrer de la façon la plus actuelle la nouveauté du message. Par ailleurs, Balthasar, en consacrant une partie importante de son travail à la traduction des grands auteurs chrétiens, en écrivant un livre entier sur Bernanos, savait parfaitement ce qu’il voulait. Il nous l’avait exprimé à Philippe Delaroche et à moi-même lors d’une visite que nous lui avions faite à Bâle en 1985 – me semble-t-il – en insistant sur la complémentarité de la recherche des secrets saisis par les écrivains de la culture profonde avec la théologie. Si le Dieu de la Révélation avait voulu se livrer tout entier à l’humanité, c’est que celle-ci était en attente, en désir de cette Révélation : dans la figure irremplaçable du Christ dans le salut qu’il apporte et dans sa parole. L’apparition du Dieu homme, la tragédie de la croix, l’enseignement évangélique ne sont pas des objets étranges, ils concernent une humanité créée pour cela, inexplicable sans cela.
28 février
Grégory Solari, le courageux et sagace directeur des éditions Ad Solem a entrepris de rééditer toute l’œuvre du grand Newman. Comme je l’en remercie ! à l’unisson de tous ceux qui savent l’importance de ce théologien anglais du dix-neuvième siècle, converti au catholicisme après avoir tenté, avec ses amis d’Oxford la réforme de l’anglicanisme. Desclée de Brouwer avait lancé, dans les années soixante, la collection des textes newmaniens dans une fort belle formule reliée dont je possède la plupart des volumes à l’exception de l’Idée d’université que je viens de recevoir puisque Ad Solem a repris à son compte la réédition de cette série indispensable à la compréhension de la pensée chrétienne contemporaine.
A nouveau donc, me voici aux prises avec cet auteur dont le charme et la puissance conjugués m’ont toujours séduits. Jean Guitton, qui l’avait beaucoup pratiqué, estimait qu’à certains égards il pouvait être incompréhensible notamment dans cette Grammaire de l’assentiment pourtant si aiguë dans la perception de la psychologie de la foi. Il exagérait sans doute, mais il est vrai que Newman est un auteur souvent complexe, dont la manière propre est fort bien caractérisée par Edmond Robillard dans son introduction à L’idée d’université : « Il n’utilise pas l’anglais, il le crée. Il pousse sans cesse sur la langue, imprimant aux mots des significations et orientations nouvelles, qui comportent à la fois un retour au sens étymologique et un départ vers des perspectives qu’il ne leur a jamais été donné de cerner jusque-là. Ajoutons qu’il y a chez Newman, à la fois du Pascal ou du Bergson, et du Bernanos. S’il écrit avec beaucoup de soin, il n’écrit jamais pour écrire. La phrase est toujours correcte, le rythme parfait, mais l’ensemble fait lourd, en vertu de sa densité. De plus – cela fait d’ailleurs partie de son système – il va à chaque idée armé d’une synthèse, et le poids de l’érudition qu’il traîne derrière lui a souvent de quoi nous écraser. Il dit bien ce qu’il dit, mais encore, pour le comprendre, faut-il avoir déjà l’idée de tout ce qu’il ne dit pas et qui est indispensable à l’intelligence de ce qu’il dit. Entre le sujet et le prédicat jetés sur le papier, il y a toujours ce troisième terme évanescent, qui les relie, et qui est le sous-entendu d’une culture immense, tenue en veilleuse par artifice littéraire, par considération pour le lecteur qui serait ennuyé qu’on lui souffle les mots, et parfois par paresse, parce qu’il serait vraiment trop long et trop onéreux de tout expliquer et justifier. »
Cela me fait penser à la manière de Pierre Boutang, ce philosophe dont l’immense culture conférait à chacun de ses livres une densité qui renvoyait le lecteur à l’image d’un Himalaya d’érudition à franchir : « Vous avez lu Le purgatoire ? me disait Gustave Thibon presqu’avec indignation. C’est insupportable. Chaque phrase renvoie à plusieurs registres de culture et il faudrait à la fois se ressouvenir de toute La divine comédie, de Machiavel et d’Edgar Poe. », mais c’était aussi un motif d’admiration sans fin. Jean Lacroix et François Perroux, l’économiste majeur, pouvait échanger sur L’ontologie du secret qu’ils hissaient très haut par rapport à ce qui avait paru dans l’après-guerre.
Si cette comparaison me vient spontanément, c’est qu’il y a chez Newman et Boutang la même volonté d’annoncer la foi à partir du meilleur de ce que peut offrir la culture de l’esprit. Et c’est d’ailleurs l’intention première de cet ouvrage, L’idée d’université qui, au-delà des circonstances de son élaboration, vise à mettre en résonance l’acquisition des savoirs et l’intelligence de la foi. Newman avait choisi à dessein de rentrer dans l’Oratoire, cet ordre fondé par saint Phillipe Néri dans le climat de la Renaissance lettrée et celui de son humanisme ressourcé dans l’érudition du côté de l’Antiquité mais aussi de la tradition chrétienne. Plus tard, un Louis Bouyer ne suivrait-il pas la même voie et pour des motifs identiques ?
Pour revenir au fond de cette confrontation culture-foi, nous ne sommes pas très loin de ce qui était en cause avec le grand fleuve de la tradition. Le ressourcement continu qu’elle implique signifie le contraire d’un enfermement dans un passé momifié. On parlera d’un rebondissement, d’une reviviscence où ce qui est transmis apparaît toujours plus jeune et plus éclatant de promesse. Sans compter que le mouvement de la transmission n’ignore pas les paysages inédits qu’il découvre, les problématiques imposées par les courants imprévisibles qu’il rencontre. Péguy avait génialement saisi cela avec la nouveauté du bergsonisme et la chance qu’il représentait pour une compréhension actuelle de la foi sans rupture avec les continuités profondes. Cela n’empêche pas qu’il puisse y avoir des désaccords directs, des antagonismes irrémédiables. Le même Péguy si sensible au mouvement de la vie, nécessaire pour nous tirer des habitudes mortifères avait une aversion irrémissible à l’égard de ce qu’il appelait, avec un mépris abyssal, « le moderne ». Chez Newman, analogiquement, on trouve une identique aversion à l’égard du modernisme (avant la lettre) en théologie.
Une des idées dominantes de cet essai tient dans la nécessité pour l’Église de participer à la culture humaniste, celle qui convient à la formation du gentleman. Mais celle-ci ne saurait suffire à assurer le véritable bonheur, car ce dernier est d’un autre ordre. L’humanisme a pu contribuer « à l’éducation d’un saint François de Sales ou d’un cardinal Pole ; il a pu représenter pour un Shaftesbury et un Gibbon la limite extrême de la perfection contemplée. Basile et Julien furent compagnon d’étude dans les écoles d’Athènes ; l’un est devenu saint et docteur de l’Église, l’autre en a été l’adversaire implacable et railleur. » On aura reconnu dans ces deux prénoms d’un côté le frère de Grégoire de Nysse et l’ami de Grégoire de Naziance, de l’autre l’empereur qui ramena l’empire romain au culte des dieux païens. Basile de Césarée fut appelé le Grand en vertu de ce qu’il y avait de supérieur et d’inégalable en lui, nous dit le patrologue Adalbert Hamman. Quant à Julien l’apostat, il en a fasciné plus d’un. Je me souviens d’avoir lu autrefois, subjugué, la biographie romancée que Luc Estang lui avait consacrée. Régis Debray a écrit une pièce de théâtre sur Julien, lui aussi absolument saisi par ce personnage à contre-courant du torrent du christianisme d’alors.
C’est dire le caractère emblématique des deux personnages que Newman évoque. La culture humaniste, le christianisme l’a adoptée nécessairement, elle lui est indispensable, ne serait-ce que pour être à la hauteur de cette incarnation christique qui suppose que l’humanité entière soit assumée. mais elle n’est pas suffisante, et lorsqu’elle se referme sur elle-même, elle manque le sujet de l’incarnation. C’est qu’il y a un saut de la foi que l’humanisme a lui tout seul est incapable de franchir. Kierkegaard l’a bien compris. Newman : « Niebur peut révolutionner l’histoire ; Lavoisier, la chimie, Newton l’astronomie ; pour ce qui est de la théologie, c’est Dieu lui-même qui en est l’auteur et le sujet. » La Révélation est supérieure à la science humaine. Saint Thomas d’Aquin l’avait indiqué en établissant une césure insurmontable entre ce qui est révélé et ce qui relève de la seule perception de la raison. Etienne Gilson avait même fait de cette distinction un des principes cardinaux du thomisme. Nous la retrouvons chez Newman dans un autre contexte, une autre forme de démonstration. Mais nous pouvons en tirer une même conclusion très actuelle. Humanisme et foi sont inséparables, ils ne vont pas l’un sans l’autre. mais l’humanisme à lui seul ne franchit pas le saut de la foi.