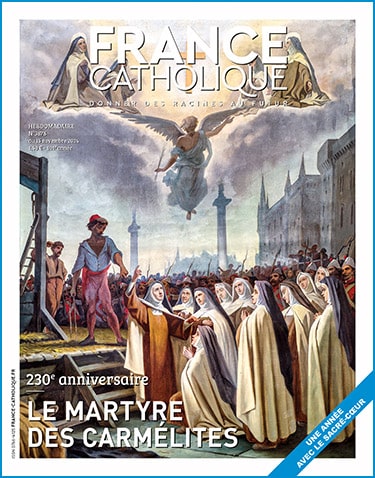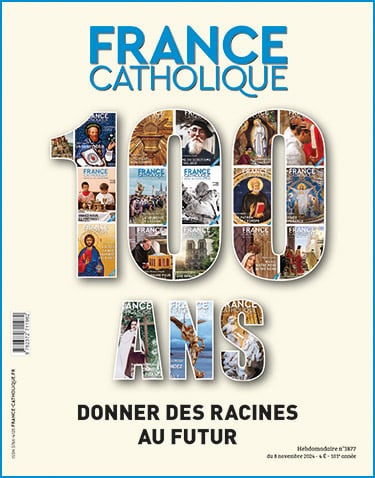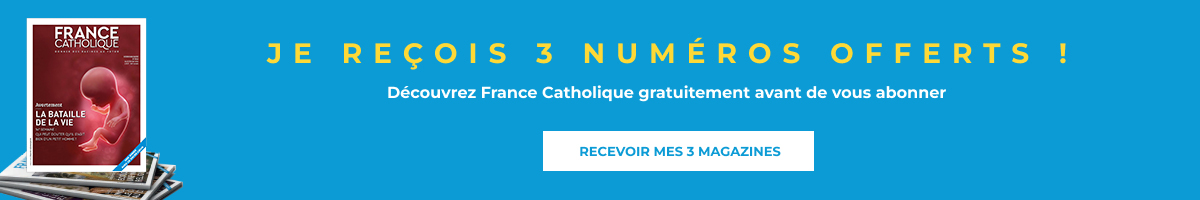26 janvier
Malraux a-t-il, finalement, foulé le sol de la Terre Sainte ? Curieux que cette idée ne m’ait jamais quitté, depuis que j’ai lu en 1973 le beau petit livre du père Pierre Bockel, intitulé L’enfant du rire (Grasset). L’auteur qui devait devenir par la suite archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg (et qui est probablement un parent du maire de Mulhouse, catholique de gauche rallié à Nicolas Sarkozy qui l’a nommé ministre des anciens combattants…), avait été l’aumônier de la brigade Alsace-Lorraine commandée par Malraux à la fin de la guerre. Les deux hommes étaient très proches – c’est le père Bockel qui devait célébrer les funérailles des deux fils Malraux morts accidentellement en voiture. Un jour le prêtre avait proposé à l’écrivain de se rendre à Jérusalem. Celui-ci lui avait répondu : « Je puis aller à Bénarés, à la Mecque ou en tout autre lieu Saint sans aucune gêne. Mais Jérusalem, comprenez-vous, c’est bien autre chose… Aller à Jérusalem impliquerait que j’aille à Géthsémani… Et là il me faudrait prononcer les paroles du Christ. » Voilà qui ne peut s’oublier et qui s’est enfoui en moi comme l’aveu (ou la confidence) le plus précieux de Malraux.
Je suis plus proche, au moins sur ce point, de l’auteur des Noyers de l’Altenbourg que de mon ami Régis Debray qui rapporte de ses pérégrinations au pays de Jésus des carnets bourrés de choses vues (Un Candide en Terre Sainte, Gallimard). Et pourtant tout me passionne dans ces impressions dont j’apprécie la vivacité et l’honnêteté. Mais Régis Debray ne peut s’empêcher de se barder d’une écorce solide de sceptique parfois à la limite de l’ironie voltairienne. Je dis limite parce que je sais qu’il a de fortes réserves à l’égard de l’inventeur de ce Candide dont il a pourtant endossé le costume. Ce n’est pas un voyage mystique qu’il est allé faire à Jérusalem et aux autres lieux saints. C’est un voyage d’observation, un exercice de lucidité, qu’il nous livre, en nous prévenant d’emblée que ce qui l’a retenu plus que tout c’est l’épreuve de réalité où sont soumis là-bas les mystères tombés du Ciel : « J’ai simplement cherché à savoir, non, à regarder et écouter comment les hommes vivent ce qu’ils croient et quels changements apporte le monde aux idées qui ont changé le monde. »
Cette même préface contient une pointe polémique contre le Jésus de Nazareth de Benoît XVI, accusé de s’adonner au douceurs de l’exégèse : « C’est une chose étrange, pour autant qu’un laïque peut en juger, que de célébrer l’Incarnation, saluer l’entrée effective de Dieu dans le temps des hommes, soutenir à juste titre, comme Benoît XVI (…), que « l’histoire, le factuel fait partie de l’essence même de la foi chrétienne », pour se contenter par après d’une subtile paraphrase de paraboles datant d’il y a deux mille ans, sans un regard pour les faits survenus depuis lors à Nazareth ou dans les environs. Est-ce une attitude évangélique que de fermer les yeux sur le sort des pécheurs après l’arrivée de la Bonne Nouvelle ? » Cher Régis, je ne dirai pas que c’est une querelle d’Allemand, au sens ancien, que vous faites à Joseph Ratzinger… Mais, tout de même, vous ne croyez pas que vous êtes tout à fait injuste et que le Pape n’ignore à peu près rien de ce que vous expliquez dans votre relation, qu’il s’en occupe quotidiennement, diplomatiquement, intellectuellement, œcuméniquement ? Et puis Jean-Paul II au mur des lamentations, dans les territoires palestiniens et jusqu’à ce Jourdain du baptême de Jésus par Jean-Baptiste que vous évoquez si bien, ce n’est pas si lointain ! Et surtout, polémique pour polémique, votre façon de parler actualité n’est-ce pas un moyen d’esquiver ce que le pape expose longuement dans son livre sur la personne de Celui qui est venu bouleverser le monde, en osant s’identifier au Je Suis de l’Ancien Testament ?
Autres acidités sous la plume du Candide : « Quand on lit que « Jésus ressortit du territoire de Tyr et vint, par Sidon, vers la mer de Gallilé » (Marc VII, 31), mettant donc cap au nord pour se rendre au sud ou qu’il jette une flopée de porcs démoniaques du haut de Gerasa dans le lac de Tibériade, distant de 50 km, le soupçon nous vient que Marc et Matthieu, pour ne rien dire de Jean, furent tout ce qu’on veut, librettistes talentueux, paroliers percutants, tout sauf des témoins oculaires et directs. à moins que les compagnons de route, arrivés à destination, n’aient oublié la carte. » J’avoue que je n’avais pas repéré jusqu’ici le paradoxe géographique des porcs de Gerasa. Un ami exégète consulté m’en livre la clé. C’est question de manuscrits. Si certains copistes se sont avisés de s’éloigner si fort du lac de Tibériade c’était sans doute pour étendre le champ d’action de Jésus. Mais ce n’est pas le cas de toutes les copies, certaines restituant à la célèbre scène la proximité immédiate du lac. Mais l’exégèse est une aventure sans fin où les objections appellent les corrections, et inversement.
Je ne puis laisser passer non plus l’étrange portrait que Régis Debray trace à un moment du Fils de l’homme, par réaction à ce qu’il dénonce comme une entreprise de reconstruction d’un personnage improbable à l’aune de nos pieuses imaginations : « N’est-ce pas notre enfant ce spectre insaisissable qui a attendu de mourir pour s’habiller de chair, transmise au monde par deux mille années de psalmodie, d’oraisons et d’enluminures ? » Mais il faut prolonger la citation pour en goûter toute la charge redoutable.
« Sans les repeints de l’auto-suggestion, sans tous ces cadeaux de la tendresse et du désir humains, il n’est pas sûr que le Christ de la foi l’emporterait encore sur le Yoshua de l’histoire, et que nous ne broderions pas aujourd’hui, à la place du premier, sur le rabbi extravagant que certains passages nous laissent entrevoir un peu imprudemment : un énergumène qui s’y croit déjà, d’une immodestie rare (Dieu n’est pas son cousin), engueulant ses auditeurs (« engeances de vipères »), désobligeant pour ses disciples (« ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »), dissuadant celui-ci d’aller à l’enterrement de son père, enjoignant à celui-là de haïr sa famille, soupe au lait, cassant, odieux avec sa maman (« Femme qu’y a-t-il de commun entre toi et moi ? »), méchant avec la bonne (quasiment à tes casseroles, ma pauvre Marthe), bref un de ces caractériels « qui n’ont rien d’évident » et dont on répond prudemment dans un dîner en ville quand on est de leurs amis, qu’ils gagnent à être connus. Socrate interroge, répond, écoute, discute poliment. Jésus remet sèchement à leur place ses contradicteurs. Des deux maîtres antiques, qui ont le plus frappé notre imagination, condamnés à mort l’un et l’autre pour forfanterie et impiété par un tribunal de concitoyens, le plus antipathique n’est certainement pas le sagace boute-en-train du Banquet. »
Je n’ai voulu rien omettre de ce joli morceau, ne désirant pas que l’insertion de mes objections n’en altère le mouvement et la vigueur. Le même ami exégète consulté sur Geralsa m’a confié qu’il croyait reconnaître dans pareil propos le parti pris démystifiant que beaucoup de ses confrères – et jusque dans les cénacles savants de Jérusalem – ont jugé opportun de distiller jusqu’en ces dernières années. Quoi qu’il en soit, Régis Debray comprendra qu’on trouve son portrait plus que partisan, caricatural au point de recouvrir l’étonnante personnalité de celui qu’on n’a pas fait mourir pour son mauvais caractère. Peut-être pour son impiété, mais c’était en vertu de ses prétentions messianiques. Le prédicateur des Béatitudes et le révélateur du cantique de la charité qui est en Dieu, celui qui ayant aimé les siens les aima jusqu’à la fin, celui-là nous renvoie à un mystère plus saisissant et infiniment plus dérangeant que l’aimable convive de Platon.
Il m’est arrivé ici même de citer une belle page de Chesterton sur l’aspect terrible du Jésus qui foudroie le mal et nous oblige à convertir notre regard et notre cœur. L’écrivain anglais n’ignore rien des traits retenus par Régis Debray, mais il est beaucoup plus attentif que lui à ce qu’ils ont d’énigmatique, n’étant pas réductibles à une simple explication psychologique. Il y a, dit-il, chez Jésus beaucoup de gestes imprévus dont nous ne voyons pas toujours ce qu’ils veulent signifier : « les colères éclatent comme des orages, mais non point là où nous les attendons : il semble qu’elles aient une météorologie propre. » Et c’est cette météorologie que le converti tente d’explorer à partir du « côté obscur, inquiétant, provoquant et mystérieux des paroles évangéliques ».
Mais au fait, Debray ne serait-il pas plutôt proche de ce Chesterton que dans un premier mouvement je lui aurais opposé ? Le style d’objections du Candide lui aurait mieux convenu qu’une élégante dissertation « moderniste ». Je ne sais si le mot de « franche incrédulité » lui sied vraiment, mais notre Anglais catholique pensait qu’elle pouvait constituer un tribut plus loyal à la vérité, en mettant en relief le scandale plutôt que la fadeur.
Je remarque aussi que mes amis prêtres qui ont lu Candide en Terre Sainte en sont très reconnaissants à l’auteur, parce qu’ils y ont discerné un accent de probité et de farouche indépendance qu’ils jugent plus que nécessaires dans l’imbroglio de ce territoire qu’ils connaissent autant que lui aussi après la Résurrection. Il n’en est pas moins définitivement marqué par le dynamisme de l’espérance qui a vaincu à Pâques.