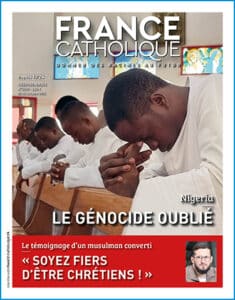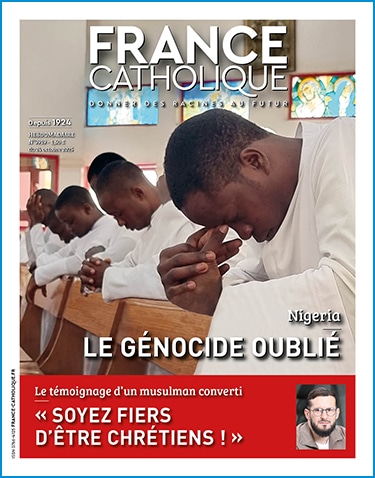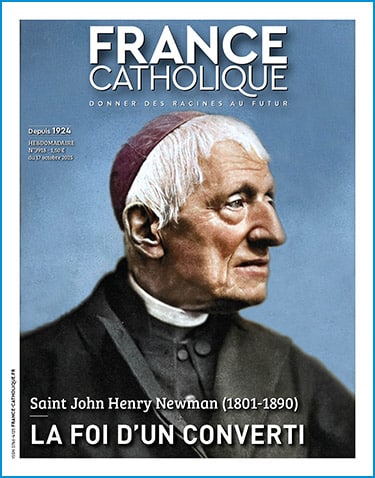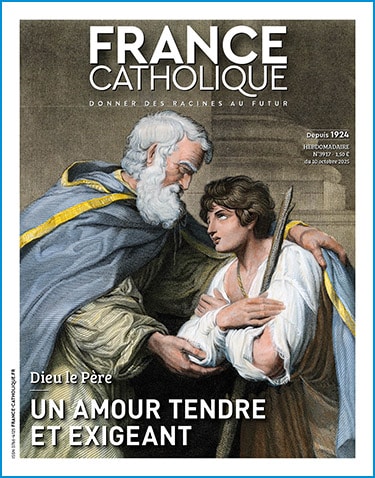4 SEPTEMBRE
Assez déconcerté par les ultima verba de Paul Ricœur, à propos de la pensée de la mort, tels qu’Olivier Abel et Catherine Goldenstein nous les ont transmis dans un petit recueil publié au Seuil (Vivant jusqu’à la mort, 144 p., 25 e). J’avais été alerté par une recension du Père Xavier Tilliette (dans la revue Communio), mais ces textes, en dépit de leur indéniable intérêt, ne parviennent pas à me persuader que l’essentiel est pensé et dit. Ce n’est pas tant sur le thème de la survie que j’attends un penseur chrétien, mais plutôt sur celui de la vraie vie et de la Rencontre.
Paul Ricœur s’est donc posé, jusqu’au terme de sa vie, la question du sacrifice de la Croix et de ce qu’en langage théologique on appelle substitution et satisfaction. Comment s’en étonner et s’en indigner ? Le mystère est si grand et inépuisable. Mais l’étonnement vient de ce qu’il est plus envisagé comme un obstacle que comme une ouverture extrême à ce que Balthasar appelle la dramatique divine, et qui est la seule perspective capable de nous éclairer sur notre propre drame.
7 SEPTEMBRE
L’attente exprimée ici-même d’un recours à l’expérience œcuménique d’Yves Congar se trouve comblée par une somme substantielle d’études en hommage à sa mémoire (sous la direction de Gabriel Flynn, Yves Congar théologien de l’Église, 448 pages, 44 e, Le Cerf). Je m’y suis plongé avec bonheur car j’ai eu le sentiment d’une bonne distance avec les difficultés, les épreuves, les événements vécus par l’homme. Certains jugements critiques, sans aucune acrimonie, aident à y voir plus clair, en rompant trop de connivences avec ce lutteur qui eut trop souvent raison pour ne pas avoir eu quelques fois tort. Ainsi, pour Congar, la menace semble forcément venir de l’intégrisme, jamais de ce qu’on pourrait appeler, trop symétriquement, le progressisme. Certes, les coups dont il souffrit presque toute sa vie lui vinrent de cette bordure ecclésiale toujours prompte à désigner le modernisme renaissant et à démasquer l’hérésie ou la déviance derrière toute recherche théologique.
Congar n’aurait-il pas dû cependant percevoir des périls considérables sur un autre bord ? Oui, mais, d’une certaine manière, il les percevait et n’était pas prêt à se laisser entraîner dans certaines aventures. Très vite, il a perçu qu’il n’était pas du tout sur la ligne d’un Hans Küng, au Concile par exemple. Il y a chez lui une santé théologale qui s’oppose à bien des dérives – il était opposé à un dialogue direct et sans discernement avec les religions non-chrétiennes comme le bouddhisme et l’hindouisme, avec parfois une véhémence qui en surprendrait plus d’un aujourd’hui. Mais, en même temps, il ne discerne pas les causes de l’ébranlement qui, dans les années 60-70, vont provoquer une indéniable catastrophe ecclésiale. Son appréciation optimiste du dialogue œcuménique semble lui en cacher certaines ambiguïtés et certaines impossibilités. Je me réfère là-dessus à la contribution d’un historien, John J. Scarisbrick, Anglais spécialiste du dialogue avec l’anglicanisme, mais aussi ferme défenseur de « la culture de vie ». Sans jamais manquer à la justice, il n’en fait pas moins des remarques très pertinentes qui déstabilisent un peu le système Congar. Sans le délégitimer.
Autres remarques critiques, celles de Jonathan Robinson, un oratorien canadien, à propos de la Tradition. On sait que le théologien a beaucoup publié sur cette notion capitale et on lui fait généralement crédit de l’éclairage qu’il lui a donné et qui était nécessaire, ne serait-ce que pour mieux apprécier à partir de quoi et selon quels principes l’institution ecclésiale doit être réformée. En contestant cette conception de la Tradition, Robinson déstabilise aussi Congar d’une manière à mon sens positive. Il souligne, en effet, le danger de faire de la transmission un en-soi, une dynamique propre certes référée à l’Esprit Saint, mais supérieure aux monuments témoins de la Tradition. Parmi ces monuments, la liturgie, dont le frère Yves Congar reconnaissait volontiers qu’elle était un instrument de communication et de « victoire sur le temps qui dégrade tout. ». Mais alors que penser de ce mot du Père Joseph Gélineau qui déclare, en 1976 : « Il faut le dire sans ambiguïté : le rite romain que nous avons connu n’existe plus. Il a été détruit. » Le récent Motu Proprio de Benoît XVI contredit heureusement cette affirmation et nous permet de comprendre pourquoi il ne saurait y avoir de telle destruction en liturgie, comme en Tradition. Or, tel n’était pas l’avis de Congar, qui rejoignait Gélineau, du moins en partie.
Robinson y voit le défaut de la cuirasse. Certes il affirme que celui qui allait devenir le cardinal Congar était un « chrétien pieux et convaincu ». Mais la façon dont il conçoit la transmission paraît à son critique inadéquate à cette orthodoxie foncière. Il y a d’autres arguments impressionnants dans la démonstration, notamment un qui relève de la morale – on sait que Congar était en désaccord avec Paul VI à propos d’Humanae Vitae. Qu’est-ce à dire ? Souligner certains défauts, certaines imperfections n’équivaut pas à condamnation ou dépréciation d’une œuvre, d’autant que celle-ci est riche et peut à certains égards compenser ses propres faiblesses par ses points forts.
Parmi ces derniers, il y a l’esprit œcuménique tel qu’il s’exprime dans d’autres contributions du volume. Ainsi, le pasteur Bruno Bürki, qui fut l’élève de Congar à Strasbourg, se sent stimulé en liturgie par l’appel à « la réalisation de l’œuvre rédemptrice des hommes et de glorification de Dieu greffée sur le mystère pascal du Christ ». Certaines déficiences de la Réforme sont reconnues et la confrontation fraternelle permet d’envisager les choses vers l’en-avant, plutôt que de se crisper sur des oppositions. Cet en-avant n’est pas de l’ordre d’une utopie, mais de l’ordre quasiment sacramentel qui oblige à réenvisager la liturgie dans son déploiement christologique. Il y aurait, dans la même ligne, une étude à entreprendre sur l’ecclésiologie qui est la pièce maîtresse de notre maître en théologie. La façon dont il envisageait, à travers l’histoire, l’essence de l’Église était exemplaire d’une démarche qui entraînait ses interlocuteurs des autres confessions chrétiennes à choisir le point de vue le plus profond et le plus décisif.
9 SEPTEMBRE
Devant participer dans un mois à un colloque organisé par l’Aide à l’Eglise en Détresse sur le thème « A-t-on encore le droit d’évangéliser ? », l’ouvrage sur Congar m’a particulièrement retenu à propos du rapport aux autres religions et, singulièrement, quant au rôle salvifique de l’Église pour les personnes qui lui sont extérieures ou étrangères. En effet, le père Jacques Dupuis, qui avait été critiqué à ce sujet par la congrégation pour la doctrine de la Foi, s’était réclamé de Congar dans la défense de sa position. Or, répond Terrence William, c’est en grande partie à tort. Il en veut pour preuve une citation très intéressante : « On ne peut nier que pour ceux à qui le Christ et son Église n’ont pas été proposés ou l’ont été de façon insatisfaisante, les religions dans lesquelles ils sont nés, qu’ils pratiquent et qui sont étroitement liées à leur vie sociale concrète, sont d’évidentes médiations de salut. On ne peut en conclure que ces religions soient divinement légitimées en elles-mêmes ou comme telles ; leur valeur dérive des personnes qui les pratiquent. »
La Revue thomiste s’était fermement démarquée des positions de Jacques Dupuis en son temps, à cause du rôle restreint que ce dernier attribuait à la causalité efficiente de l’Église – une causalité qui ne s’appliquait qu’aux seuls membres explicites de l’institution.
Terrence William va dans le même sens lorsqu’il écrit : «dire que le Christ est toujours « impliqué » dans le salut des êtres humains mais que l’Église n’est impliquée que dans le salut des chrétiens serait violer le principe sacramentel (ou d’incarnation) sur lequel l’Église est fondée.»
12 SEPTEMBRE
Beaucoup de philosophie politique en cette rentrée. De Régis Debray à Jean-Claude Michéa, en passant par Jacques Rollet, c’est le socle de notre démocratie européenne qui se trouve bousculé, à tel point que beaucoup protestent sur le thème : vous avez un certain culot de vous plaindre de notre régime actuel. Regretteriez-vous les régimes totalitaires ou dictatoriaux d’hier, à dénoncer sans cesse le relativisme ambiant ? Jean-Claude Michéa a déjà répondu à l’objection. Il est infiniment préférable de vivre dans un système où la liberté de pensée est de règle et où l’on ne vit pas au risque d’un arbitraire policier. Mais il est tout de même permis de poser quelques questions sur le devenir de nos sociétés, sur quelques-unes de leurs dérives et sur le sens déchiffrable d’un indifférentisme moral érigé en principe.
Il est vrai aussi que certains « libéraux » (mais le terme est suffisamment lâche pour désigner des doctrines très différentes) protestent contre une imputation d’amoralisme que la seule référence à Tocqueville suffit à démentir. Mais l’observateur de l’évolution démocratique de nos sociétés n’était pas un théoricien, encore moins un idéologue. Il ne prétendait pas nous donner la formule d’un régime idéal. Il exerçait toute sa sagacité à décrire et à comprendre, en laissant en alerte toutes ses facultés de mise en évidence de périls possibles. Aussi, comme le rappelle Jacques Rollet dans son excellent essai (La tentation relativiste ou la démocratie en danger, DDB) : « Pour Tocqueville, la religion et plus précisément pour lui, le christianisme est nécessaire à la réussite de la démocratie comme régime politique, car elle donne l’assise éthique et une conception de la vie qui dépasse les préoccupations de court terme.»
Or, l’ambition inhérente à la dynamique actuelle de la politique est de se passer radicalement de cette assise éthique, qu’elle soit chrétienne ou pas, pour une raison que Jean-Claude Michéa résume avec une sévère rigueur. Le pari libéral, écrit-il, « repose sur la conviction qu’il demeure toujours possible de conjurer la guerre de tous contre tous et de donner naissance à une société libre, pacifique et prospère, même dans l’hypothèse où les individus n’agiraient qu’en fonction de leur intérêt particulier. Il suffit pour cela de canaliser l’énergie des « vices privés » au profit de la communauté, en déléguant l’harmonisation des conduites individuelles aux mécanismes neutres et impersonnels du Droit et du Marché. Cette solution implique, en contrepartie, que les valeurs morales – dans lesquelles les différentes civilisations du passé avaient usé une partie de leur raison d’être – soient désormais chassées hors de l’espace publique. »
Pour moi, cette remarque désigne la cause souvent éludée de beaucoup des interdits de la conscience européenne contemporaine. Pourquoi, de la part de tant d’hommes politiques et d’intellectuels, ces refus obstinés d’un rappel des « racines chrétiennes de l’Europe » ? ou du rôle considérable du christianisme au cours des vingt derniers siècles ? C’est parce qu’il y a désormais refoulement systématique, conscient ou inconscient, de toute doctrine normative, de ce que John Rawls appelait une doctrine compréhensive, c’est-à-dire une pensée ayant quelque ambition ontologique ou anthropologique. Seuls les points de vue pragmatiques (pour ne pas dire utilitariste) ou purement individualistes sont admis, avec en perspective le seul respect des droits qui ne saurait renvoyer à une indiscible philosophie de l’homme commune.
Loin de moi l’idée de contester radicalement ces garde-fou nécessaires que sont les déclarations des droits et leurs conséquences législatives. C’est là où ils n’existent pas qu’on perçoit le mieux l’avantage de vivre en régime de protection et de sécurité des individus. Mais autant je suis persuadé qu’il y a un acquis juridique – voire démocratique – dont il faut maintenir à tout prix la continuité, autant je perçois les périls d’une désintégration du sens du droit, dès lors qu’il n’est plus fondé que sur l’individualisme et l’indifférence aux requêtes d’une pensée compréhensive. Un droit purement procédural nous projette dans un monde de l’indifférence réciproque, de la neutralité éthique, de l’oubli des valeurs élémentaires du vivre ensemble, celles qui permettent la convivance sociale. Dans une telle logique, l’évocation d’une appartenance religieuse est tout aussi insupportable, puisqu’elle introduit du sens, de la normativité et des convictions là où devrait désormais régner la suspension de jugement, au prix de tous les voiles d’ignorance. ■